Hantz Denis, Abbé
«Je venais d’avoir 15 ans, quand le 1er septembre 1939, le Führer du Grand Reich allemand, Adolf Hitler, vociférait sur les ondes à la face du monde : « Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen. Depuis 5 h 45, -heure allemande – mais 4 h 45 en France - nous ripostons. »
Il ne se doutait peut-être pas qu’il venait de déclencher ce qui devait devenir la guerre la plus meurtrière de l’histoire humaine, à ce jour. Sur son ordre, sa Wehrmacht toute puissante, bardée de divisions blindées se jetait sur la Pologne et l’avalait en dix-huit jours. Son alliée, l’URSS, se partagea le gâteau avec l’Autrichien.
Le 3 septembre à 1l heures, l’Angleterre, puis à 17 heures, la France déclaraient la guerre à l’Allemagne par fidélité à l’engagement qui les liait à la Pologne, mais dans une impréparation totale.
La guerre, j’en avais entendu parler par mon père, ancien combattant de l’Armée du Kaiser en 1914-18.
A 15 ans, elle m’apparaissait comme un jeu, comme une aventure qui allait agrémenter la grisaille du quotidien.
De toutes manières, nous étions à l’abri de la Ligne Maginot, réputée imprenable !
Le 10 mai 1940 mit fin à ce qu’on avait appelé la Drôle-de-guerre. Enfin le choc décisif allait se produire dont l’issue ne faisait pas de doute : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » nous avait-on seriné durant des mois et on avait fini par y croire. « Les Boches tomberont comme des mouches. »
Quand le mardi 18 juin 1940, à 6 heures 30 du matin, la Wehrmacht fit son entrée dans mon village de Marspich (aujourd’hui intégré dans la ville de Hayange) en la personne de deux motocyclistes en manteau de cuir feldgrau, venant de l’Ouest et non... de l’Est, le choc se fit dans nos coeurs. « Ce n’était pas possible. Ce n’était pas vrai. » Et pourtant la réalité était là, en vert-de-gris, sous nos yeux. La France était à genoux. Les slogans n’avaient pas suffi à arrêter les divisions blindées. Le vainqueur allait imposer sa loi et la marée feldgrau marquer le paysage, suivie de la marée brune, véritable peste. Une fois de plus, abandonnée par la France, l’Alsace-Lorraine allait payer un lourd tribut. (Dans la terminologie nazie, l’Elsass-Lothringen représente, en fait, l’Alsace-Moselle, terre des aïeux à réintégrer une fois pour toute dans le IIIème Reich, Ndr).
Le 22 juin l’armistice fut signé, ce fut pour nous l’effondrement. Comment était-ce possible que la France fût à genoux après six semaines seulement de "vraie guerre"?
Nous ne comprenions plus. Je n’avais que 16 ans, mais j’avais le sentiment qu’un monde s’écroulait. Quand les soldats allemands nous distribuèrent le texte de l’armistice entré en vigueur le 25 juin, nous en avons bien vite lu les clauses. Aucune ne faisait allusion au sort futur de l’Alsace-Lorraine. Mais sachant que notre chère Heimat avait été dans le passé ballottée par l’histoire une fois d’un côté et une fois de l’autre, nous pressentions que tôt ou tard l’Allemagne finirait à nouveau par nous annexer.
Mainmise nazie
Devenir un jour Allemand, je ne pouvais pas le concevoir ! Pourtant dès le mois d’août 1940, l’annexion de fait se mit en place. La Moselle fut rattachée au Gau Saar-Pfalz pour devenir le Gau Westmark. Des fonctionnaires allemands remplacèrent les administrateurs français.
A Metz s’installait le Gauleiter Bürckel. Dans toutes les villes cantonales, un Kreisleiter remplaçait le sous-préfet. Dans toutes les communes apparaissaient les Ortsgruppenleiter, les Zellenleiter et Blockleiter du Parti.
Le cordon frontalier fut rétabli sur l’ancienne frontière de 1871-1918 et toute circulation était interrompue avec le reste de la France.
L’argent français était remplacé par l’argent allemand à raison de 20 Francs pour l Reichsmark.
Les timbres postaux s’affranchissaient désormais à l’effigie de Hindenburg ou d’Hitler, avec, provisoirement, la surcharge -Lothringen- apposée dessus. La S.N.C.F devenait la Reichsbahn, les PTT la Reichspost. Cheminots et postiers durent revêtir l’uniforme allemand. Dans les écoles, l’enseignement se faisait désormais en allemand. On germanisa le nom des communes ; les rues furent débaptisées : Adolf Hitlerstrasse, Hermann Göringstrasse, Platz des Führers, etc…. On imposa le salut hitlérien. L’usage du français et le port du béret furent interdits. Partout fleurissaient des affiches : « Denke deutsch, handle deutsch, sprich deutsch ! Pense allemand, agis en allemand, parle l’allemand ! » Le régime introduisit les Lebensmittelkarten et les Bezugsscheine allemands (tickets de rationnement) ainsi que les Raucherkarten (tickets de tabac). Tout semblait indiquer que c’était bien définitif et sans retour d’autant plus que la Wehrmacht paraissait invincible.
Quand le 22 juin 1941, Hitler s’attaqua à l’Union soviétique, l’espoir commença à renaître. A nos yeux, il était clair que jamais l’Allemagne ne viendrait à bout de cet immense empire. Nous avions en mémoire l’aventure de Napoléon.
Fort de sa victoire sur la France en 1940, Hitler pensait mettre très rapidement l’URSS par terre par un Blitzkrieg pour ne pas avoir sur les bras une guerre sur deux fronts. N’avait-il pas écrit jadis dans son Mein Kampf qu’en aucun cas après l’expérience de 1914-1918, l’Allemagne ne devait se laisser entraîner un jour dans une belligérance sur deux fronts ? Mais en même temps une grande crainte nous habitait. N’allaient-ils pas avoir besoin de beaucoup de chair-à-canon pour mener à bien ces opérations ? N’allaient-ils pas vouloir mobiliser Lorrains et Alsaciens ? Bürckel, le Gauleiter, avait déclaré, même encore après l’entrée en guerre contre l’URSS que l’introduction du service militaire ne serait pas envisagée avant la signature du traité de paix avec la France.
Durant un discours pour lequel tout le village avait été rassemblé, j’ai entendu moi-même le Kreisleiter de Thionville proclamer : « Le jour où nous aurons besoin de vous pour faire la guerre, l’Allemagne sera perdue. » Paroles ô combien prophétiques !
En mai 1942, le maréchal Keitel, commandant en chef d’une Wehrmacht dont les réserves s’épuisaient, avait envisagé de mobiliser Lorrains, Alsaciens et Luxembourgeois. A cette époque, les trois Gauleiter, Bürckel, Wagner et Simon étaient réticents. Présents sur le terrain, ils sentaient la température de leurs jeunes et craignaient de contaminer leurs troupes allemandes avec des éléments aussi peu sûrs !
Mais le 8 août 1942, les trois larrons furent convoqués au Quartier général de Hitler à Winniza en Ukraine -je devais passer à Winniza, étant en route pour le front en novembre 1943- et c’est là que fut prise la décision fatale d’imposer le service militaire en Alsace, Moselle et Luxembourg, provisoirement pour les classes 1920 à 1924, mais par la suite, l’éventail s’élargira à d’autres classes.
L’annonce en fut faite solennellement par Bürckel à Metz le 28 août 1942. Selon lui, ce serait un grand honneur pour nous que de participer à la lutte gigantesque de l’Europe contre le bolchevisme. Au jour de notre incorporation nous serait conférée la deutsche Staatsbürgerschaft (citoyenneté allemande) à égalité de droits avec les Reichsdeutsche.
Ce fut la consternation au pays. Le ciel nous tombait dessus. Tout le monde disait : « Tout, mais pas ça ! » Mais que faire pour y échapper ? Franchir clandestinement la frontière qui nous séparait du reste de la France et s’y planquer ? Certains ont fait ce choix. Bien sûr, c’était le saut dans l’inconnu, mais à 18 ans l’aventure ne fait pas peur. Se cacher sur place ? Mais où ? Notre logement comportait trois pièces et la cuisine.
Dans les campagnes, certains ont pu le faire. Les conditions s’y prêtaient mieux. Dans les deux cas, il y avait un gros risque : celui de voir les parents internés et déportés. Beaucoup de parents d’insoumis l’ont été. Certains n’en sont pas revenus.
On a discuté en famille. Mon père m’a dit : « Fais comme tu l’entends. Ta décision sera la nôtre. »
Terrible décision pour les parents. Dans les deux cas, ils se sacrifiaient :
- ou bien le fils partait à la Wehrmacht, en Russie. En reviendrait-il vivant ?
- ou bien c’était l’insoumission et les parents aboutissaient à Schirmeck ou à Dachau, le camp de concentration.
Terrible cas de conscience pour les jeunes :
- ou aller défendre une cause qui n’était pas la leur, revêtir un uniforme détesté, ne parlons pas du reste...
- ou plonger ses parents, les siens dans la détresse et la souffrance et qui sait... en danger de mort.
J’ai choisi la première solution à mon corps défendant. Je crois que les décisions que nous dûmes prendre à cette époque nous ont mûris avant l’âge. Nous n’avons pas eu de vraie jeunesse. De l’âge du gosse, nous avons été catapultés dans les soucis d’adultes.
J’ai été convoqué au conseil de révision à Nilvange le 16 septembre 1942 et bien sûr, déclaré Kriegsverwen-dungsfähig (bon pour le service de guerre, autrement dit bon pour le casse-pipe). Les copains de la classe 1924 étaient partis en octobre au R.A.D., le Reichsarbeitsdienst, le service du travail au Reich. Du fait de mes études, j’ai obtenu un sursis de six mois. Et c’est en février 1943 que j’ai reçu mon appel pour le R.A.D. L’année scolaire n’a pas pu être terminée. On nous a gratifiés d’un certificat de fin d’études (Reife) qui sera homologué après la guerre comme dispense de baccalauréat par les services académiques français.
Après le conseil de révision, on nous remit le Wehrpass (livret militaire). Nous n’avions que 18 ans, donc mineurs, puisqu’à l’époque la majorité légale était établie à 21 ans. Or en-dessous de 18 ans, il était interdit de fumer en public. Un jour que je sortais de la maison, une cigarette au bec, un Schupo en vélo passa devant chez nous. Il me regarda et mit pied à terre. J’en devinais la raison et savourais déjà d’avance sa déconvenue : « Jeune homme, quel âge avez-vous ?
- Achtzehn Jahre ! 18 ans !
- Haben Sie Papiere ? Avez-vous une pièce d’identité ?
- Jawohl ! » Et je lui mis mon Wehrpass sous son nez. Il l’a regardé, a enfourché son vélo et il est reparti sans mot dire. Il a dû penser : « ça doit aller très mal pour nous, si maintenant nous enrôlons des gamins ». Moi, j’en ai jubilé intérieurement.
Au Reichsarbeistsdienst
La grande épreuve allait commencer. Ce n’était pas encore la Wehrmacht mais tout de même l’embrigadement sous l’uniforme. J’ai été appelé le 16 février 1943 à la Reichsarbeitsdienst Abteilung 13/211 à Übach, non loin de Aachen (Aix-la-Chapelle).
Dans le train qui est parti de Thionville, nous n’étions que des Mosellans.
Nous n’avons, bien sûr, parlé qu’en français, malgré la présence de nos accompagnateurs allemands du R.A.D. Ils ont dû comprendre tout de suite à qui ils avaient affaire. Le train nous a amenés jusqu’à Palenberg, d’où nous avons dû poursuivre à pied jusqu’à Übach.
Le camp, situé tout près de la frontière hollandaise, était composé de baraques en bois caractéristiques du R.A.D. Nous avons été répartis en chambrées par dizaine d’individus. Des lits superposés, une armoire pour chacun (Spind), un escabeau (Schemel ou Hocker), une table et un fourneau composaient le mobilier.
Dès le lendemain de notre arrivée nous avons été mis en uniforme et avons perçu tout le barda réglementaire et le service a commencé.
L’horaire était le suivant : lever à 6 heures, toilette, et dans la foulée, petit-déjeuner avec beurre et marmelade.
Puis, jusqu’à 10 heures, éducation politique et musicale, suivie d’une soupe ou d’une assiettée de lait, puisque nous étions mineurs. Ensuite exercice avec la bêche sur la place d’appel du camp.
12 heures 30 : repas, en général assez correct, goulasch, légumes, patates en robe des champs, pouding.
Après le repas : une heure libre, puis travaux au camp, aménagements divers, entretien, etc...
18 heures : souper puis une heure de chant et quartier libre à l’intérieur du camp jusqu’au couvre-feu à 21 heures.
Le R.A.D. était une formation paramilitaire qui n’avait rien à voir avec le Service du Travail Obligatoire en France (le S.T.O.). Il n’y avait pas de maniement d’armes mais manipulation de bêches.
En temps de paix, le R.A.D. était consacré à des travaux divers d’utilité publique. En 1938, étant en vacances chez de la famille en Sarre, une section de R.A.D. travaillait au curage du ruisseau du village où j’étais. Mon frère et moi les regardions faire. L’un de ces jeunes me demanda mon âge et me dit qu’il faudrait qu’un jour je fasse aussi mon service au R.A.D. Je lui dis que non. Un peu ébahi, il me dit : « Comment ça ?
- Je suis Français.
- Dann hast Du aber Glück ! T’en as de la chance ! » C’est dire qu’il n’était pas très enchanté de son état.
Malheureusement, mon Glück aura été de courte durée et j’étais loin de penser qu’un jour j’aurais à revêtir ce même uniforme. En fait, le R.A.D. était déjà une préparation et une mise en forme en vue de la Wehrmacht.
 Le drill et les chicaneries prussiennes étaient les mêmes. Le matin, les lits, des sacs de couchage remplis de paille, devaient être faits au carré. Le soir, les habits nécessitaient leur pliage au carré sur le tabouret devant le lit, depuis la vareuse jusqu’au caleçon (Hockerbau ou Schemelbau). A tour de rôle chaque soir, l’un d’entre nous était chargé du nettoyage de la chambrée (Stubendienst) qui comprenait le balayage, l’époussetage et le nettoyage du fourneau où ne devaient plus subsister ni braises ni cendres.
Le drill et les chicaneries prussiennes étaient les mêmes. Le matin, les lits, des sacs de couchage remplis de paille, devaient être faits au carré. Le soir, les habits nécessitaient leur pliage au carré sur le tabouret devant le lit, depuis la vareuse jusqu’au caleçon (Hockerbau ou Schemelbau). A tour de rôle chaque soir, l’un d’entre nous était chargé du nettoyage de la chambrée (Stubendienst) qui comprenait le balayage, l’époussetage et le nettoyage du fourneau où ne devaient plus subsister ni braises ni cendres.
Un soir, au cours de mon Stubendienst, le chef qui était de ronde mit la main dans le poêle et la ressortit bien sûr noircie de suie. « Was ? Das nennen Sie sauber ? In einer Stunde komme ich wieder ! Quoi ? Vous appelez ça propre ? Je reviens dans une heure. »
Je ne me suis pas amusé à vouloir nettoyer l’intérieur du fourneau. C’était uniquement pour me chicaner qu’il avait fait cela. Quand il est revenu au bout d’une heure, il m’a envoyé au lit sans autre forme de procès.
A cet appel du soir, tous ceux qui étaient au lit étaient censés dormir. Un soir, devant une remarque idiote du chef à celui qui était de corvée, quelques-uns ont ricané sous leurs couvertures. « Was ? Ihr schlaft nicht ? Füsse vorzeigen ! Quoi ? Vous ne dormez pas ? Montrez vos pieds ! » Evidemment, à ses yeux, ils n’étaient pas propres. « Alles in den Waschraum, marsch, marsch ! Tout le monde au lavabo et en vitesse ! » Il fallut sauter du lit, courir en chemise très courte pieds nus au lavabo qui se trouvait dans une autre baraque. N’ayant pas pu emporter de serviette, nous n’avons pas pu sécher nos pieds et c’est avec les pieds mouillés qu’il a fallu traverser la cour recouverte de mâchefer. En revenant à notre baraque, nos pieds étaient vraiment sales. « Was ? Das nennt Ihr Füsse waschen ? Ihr Schweine. Alles in den Waschraum, marsch, marsch ! Vous appelez cela laver les pieds. Cochons que vous êtes ! Tout le monde au lavabo, au pas de course ! » Et le même scénario s’est ainsi répété plusieurs fois jusqu’à ce que les envies de chicaner du chef se fussent calmées. Il fallait absolument nous mater, nous casser, faire de nous des robots marchant à la baguette, briser notre volonté et notre personnalité, nous obliger à obéir machinalement et servilement, ne plus penser personnellement. C’était le drill, le dressage du militarisme prussien. Au réfectoire, quand tout le monde était debout autour des tables, un chef criait : « Ein Spruch ! Une maxime ! » N’importe qui d’entre nous devait la prononcer. Tant qu’elle n’était pas dite, on ne pouvait pas se mettre à table. Si elle ne plaisait pas au chef, il fallait en chercher une autre. Question de drill. Parfois, comme parade, nous disions n’importe quoi en donnant soi-disant comme auteur, un grand du régime, Hitler, Göring, etc... du genre : « Möge Gott wollen dass uns diese Knollen den Schlund hinunter rollen ! Veuille Dieu que ces tubercules nous passent le gosier. » Une citation d’Adolf Hitler ! Personne n’osait désavouer une parole du Führer ! Au camp, la moitié des effectifs était composée d’Allemands, l’autre moitié de Lorrains (en fait des Mosellans que l’autorité allemande appelait Lothringer, Ndr). La cohabitation était très réservée. Les Lorrains se retrouvaient entre eux dans les temps libres et parlaient français, ce qui était strictement interdit. Les chefs étaient de grossiers personnages qui faisaient du zèle pour être bien notés et éviter ainsi d’être versés dans la Wehrmacht et d’aller se faire tuer en Russie. C’étaient des planqués.
Quinze jours après notre arrivée au camp, à l’appel du matin, on demanda : « Wer hat eine gute Handschrift ? Qui a une bonne écriture ? » On se méfiait devant de telles questions, car elles cachaient souvent des traquenards du genre : « Links raus ! Zum Scheisshaus putzen ! A gauche, corvée de chiottes ! » Ce matin-là, je risquai le quitte ou double : corvée de chiottes ou autre chicanerie, c’était pareil. Je levai la main. Un autre compatriote, mécanicien de son métier, en fit autant. La chance nous sourit ce jour-là. « Links raus ! Vous allez préparer votre barda, prendre le train à Palenberg et vous rendre à la Gruppe à Aachen. » La Gruppe était le P.C. qui commandait plusieurs camps (Abteilungen) situés dans la même région. A sa tête, il y avait un Arbeitsführer entouré d’un état-major composé d’Oberfeldmeister, d’Unterfeldmeister, d’un Arbeitsarzt, de secrétaires civils et de chauffeurs. Notre Gruppe 215 de Aachen (Aix-la-Chapelle) était installée dans un château, (jadis propriété des Luttitz, hobereaux prussiens), édifié à la sortie de la ville, vers Eupen en Belgique.
La maison était spacieuse, bien éclairée par de larges baies, entourée d’un grand parc avec surfaces engazonnées et forêts. Nous y étions 9 Arbeitsmänner, 5 Lorrains et 4 Allemands, chargés de tous les services dans la maison : standard téléphonique jour et nuit, chaufferie, cuisine, entretien de la maison et du parc, courses diverses, etc. Nous étions logés dans deux chambres sous les combles, anciennement chambres de bonnes, très confortables, avec eau courante, W.C. et douches sur le palier. Ça ne sentait pas du tout le camp ou la caserne. Pas d’exercices ni de maniement de bêches -nous n’en avions même pas -, pas de séances d’endoctrinement, pas d’appels ni de Hockerbau. La vie de château, quoi ! Nous ne subissions plus les tracasseries que nous avions connues au camp. L’Arbeitsführer était très humain, un bon papa qui n’a jamais cherché à nous chicaner.
La nourriture y était bien meilleure qu’au camp. Et pour cause ! Pas de restrictions, du pain à volonté. L’explication était simple. Tout le ravitaillement des camps était géré par la Gruppe. Ces messieurs y prélevaient d’abord largement pour leur compte. Comme nous étions témoins de ces agissements, ils ne pouvaient pas ne pas nous accorder les mêmes avantages. Il y eut par exemple un jour des arrivages de citrons et d’oranges qui ne parvenaient pas dans les camps. A Übach nous n’en avions jamais vus. A Aachen, on nous en donna même pour envoyer chez nous. Il est facile d’imaginer ce que les chefs envoyaient dans leur famille. La combine existait aussi dans le système du Führer !
Au R.A.D., on ne donnait pas du « Herr » aux chefs comme à l’armée où c’était « Herr General » et même « Herr Gefreiter, Caporal. » Ici, c’était simplement : « Jawohl Arbeitsführer, Jawohl Feldmeister ».
Notre uniforme était erdbraun (kaki). Au bras gauche, nous avions un brassard rouge avec une croix gammée sur fond blanc. Nous étions sanglés d’un ceinturon que nous n’avons pas eu besoin de mettre à Aachen dans nos activités quotidiennes, le calot non plus, ça nous mettait un peu plus à l’aise physiquement. Au camp nous avions été chaussés de brodequins et de guêtres de toile. D’autres Abteilungen portaient des bottes.
En 1943, les bombardements massifs alliés sur les villes allemandes avaient déjà commencé. Nos Abteilungen respectives avaient été à plusieurs reprises en Einsatz de déblaiement à Essen et Düsseldorf. Nous autres à Aachen en étions dispensés. Notre solde était de 1 R.M. par jour. Cela nous suffisait pour nos sorties de fin de semaine en ville. Je me rappelle avoir assisté une fois à la messe au Karlsdom, la cathédrale de Charlemagne. Ce fut la seule messe de toute cette période de R.A.D. Fin mars, nous sommes retournés un dimanche au camp pour la Vereidigung (prestation de serment). Pour nous Lorrains, c’était de toute façon de la rigolade qui ne nous a pas posé de cas de conscience. Normalement, la durée du service était de six mois. Le nôtre n’a porté que sur trois mois. En 1943, ils avaient besoin de main-d’œuvre ailleurs ! Le 10 mai nous avons quitté Aachen pour retourner à Übach où nous avons rendu notre paquetage pour être libérés. Nous sommes rentrés chez nous en uniforme qu’il a fallu renvoyer au camp par la suite. Ces trois mois passés à Aachen ont été les plus relaxes de tout mon embrigadement de trente mois chez les nazis.
Dans les années 1970, j’ai rencontré en Moselle une jeune Allemande originaire de Aachen. Elle m’apprit que la « Haus Luttitz » où j’avais fait mon service, était devenu « Maria Rast im Grindelweg », propriété maintenant du diocèse d’Aachen. Toutes les sessions du diocèse avaient désormais lieu là-bas, de même que les rencontres des évêques de Rhénanie et de la Ruhr. J’avais envie de revoir l’endroit. En avril 1980, j’y ai passé quelques jours. J’ai retrouvé les lieux pratiquement dans l’état où je les avais connus en 1943. La destination en était désormais différente ! Dans le grand escalier d’honneur où naguère avait été accroché le portrait du Führer, il y avait maintenant un beau et grand crucifix. Les pièces qui avaient servi antan de bureaux étaient transformées en salles de réunion. L’ancien mess avait été agrandi et aménagé en chapelle. J’y ai célébré l’Eucharistie avec un prêtre hollandais (la Hollande est toute proche) et j’ai pensé à tous ceux qui jadis hantaient ces lieux. Qu’étaient-ils bien devenus ? Les deux pièces où nous logions sous les combles servaient toujours au personnel de la maison. Pour le reste, une cinquantaine de chambres pour les congressistes avaient été aménagées. J’ai retrouvé la chaufferie où j’avais pelleté des tonnes de coke. Elle fonctionnait maintenant au fuel. L’aspect extérieur de la maison n’avait guère changé. Je me suis laissé photographier sur le perron, au même endroit où jadis l’Arbeitsführer Hahn nous avait pris en photo, - il nous avait d’ailleurs offert un agrandissement signé par lui et que je possède toujours. Le parc était toujours aussi beau.
Revenons à 1943. Si ces trois mois de R.A.D. m’avaient donné un avant-goût de l’embrigadement chez les nazis, ce n’était pourtant rien à côté de ce qui nous attendait. La suite allait être autrement sérieuse et dramatique.
La Wehrmacht : grande rafle et déportation militaire
A peine rentré du R.A.D., je reçus le Gestellungsbefehl (ordre de marche) pour la Wehrmacht. J’avais à me présenter le 21 mai 1943 à 8 heures dans une caserne de Thionville. Nous étions là plusieurs centaines de toute la région. Après l’appel nominatif nous perçûmes du ravitaillement pour trois jours : Kommis, beurre et saucisse. Ce fut notre premier casse-croûte militaire. Nous aurions pu nous en passer, car nos valises contenaient de bien meilleures choses.
A la gare, un train composé de nombreux wagons nous attendait. Les familles étaient sur le quai, les larmes aux yeux. En dehors de quelques timides cocardes bleu-blanc-rouge, il n’y eut aucune manifestation hostile. A quoi bon ? Les dés étaient jetés. A 11 heures ce fut le départ, bien triste. Quand reverrions-nous le pays ? Tout le monde avait le coeur gros. Nous fîmes connaissance les uns avec les autres. Bien que tous originaires du même coin, peu se connaissaient entre eux. Les conversations se faisaient en français. Bientôt on déballa les bonnes affaires de nos valises et on se mit à casse-croûter. Le rouge ne manquait pas ni le schnaps. Presque tous les gars étaient de la classe 1925 plus quelques sursitaires de 1924 comme moi. Bientôt l’atmosphère se réchauffa et les bonnes blagues fusèrent, souvent contreEux. A Metz et à Saint-Avold, d’autres recrues nous rejoignirent.
A Sarreguemines également où le train fut scindé : une partie s’en alla vers Strasbourg pour l’Autriche, l’autre fraction dont je faisais partie, prit la direction de Saarbrücken pour le nord de l’Allemagne.
Durant les deux jours du voyage, on nous distribua, le matin, du café (Ersatz) et le soir, de la soupe, préparés par les services de la Wehrmacht dans les gares où le train s’arrêtait. La nuit, nous avons essayé de dormir, les uns sur les bancs ou dans les filets et les autres par terre. Par Frankfurt, Fulda, Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Apolda, Halle, Magdeburg, Wittenberge, Schwerin et Wismar, nous arrivâmes dans la matinée du dimanche 23 mai à notre destination : Rostock au Mecklenburg.
Nous fûmes dirigés sur la Füsilier Kaserne de l’Inf. Gesch. Ers. Kp. 522 et encasernés par chambrées de 13.
Ce fut un dimanche bien triste. Des recrues allemandes y étaient déjà depuis trois jours, des gars de Poméranie. Dès notre installation, ils se demandaient bien qui pouvaient être ces lascars parlant et chantant français.
Après deux jours et deux nuits passés dans le train, pouvoir s’allonger sur un lit, même si ce n’était qu’une paillasse, nous fit du bien. De quoi avons-nous rêvé ? Je ne le sais plus, mais probablement de notre Lorraine qui était désormais bien loin. En ouvrant une boîte de cirage, je m’étais fait une entaille dans un doigt. On me soigna à l’infirmerie... où l’on me menaça du Kriegsgericht wegen Selbstzerstümmelung, du Conseil de guerre pour automutilation ! Ça commençait bien et le ton était donné.
Vie de caserne
 Dès le lendemain nous perçûmes notre uniforme feldgrau, des bottes et un masque à gaz. Aux pieds, pas de bas mais des Fusslappen (chaussettes russes). On se croyait revenu deux siècles en arrière. On nous vaccina contre le typhus et la variole. Il faut ménager et soigner la chair à canon ! Nous étions là une centaine de Lorrains, autant d’Allemands et quelques dizaines de Luxembourgeois. C’était l’Europe en marche mais une Europe allemande ! Et aussitôt commencèrent, en attendant la réception du fusil, les premiers exercices dans la cour de la caserne « Stillgestanden ! Rechts um ! Links um ! Hinlegen ! Auf, marsch, marsch ! Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein ! Arsch nach vorne ! » Et nous eûmes droit de la part du Feldwebel ou de l’Unteroffizier aux expressions colorées et grossières du militarisme prussien : « Sie Arsch mit Ohren ! Sie Fickbolzen ! Sie blöde Flasche ! Ich bring’ Sie auf d’n Draht dass Ihnen das Wasser im Arsch kocht !… » Bref, des grossièretés qui ne se disent bien qu’en allemand, même si toutes les armées du monde connaissent un peu le même langage. Le soir, en chambrée, nous nous moquions les uns des autres : « Eh ! sale Boche, sale Chleuh... ». N’empêche que nous nous sentions étrangers à nous-mêmes, dans cet uniforme vert-de-gris. En renvoyant à la maison nos effets civils, nous eûmes l’impression d’une rupture. C’était vraiment irréversible !Après huit jours de ce premier contact, ce fut le départ vers les unités où nous fîmes nos classes (Ausbildung). Un tiers des recrues fut dirigé vers Kulm, un second vers Danzig et le dernier, dont j’étais, fut expédié vers Gnesen. Après 24 heures de train, par Stargard, Pasewalk, Kreuz et Posen nous débarquâmes à l’Inf. Gesch. Ausb. Kp. 12 à Gnesen dans le Warthegau, -Gniezno dans l’ancienne Pologne. Il y avait là déjà des Alsaciens incorporés quelques mois avant nous. La caserne était un très vieux bâtiment datant de 1900, ayant servi aux Allemands jusqu’en 1918 puis aux Polonais jusqu’en 1939. Dans ma chambrée, nous étions 8 Lorrains, 1 Luxembourgeois, 3 gars de Pommern, plus le chef de chambre allemand avec le grade de Gefreiter. Ceux-là, nous les mîmes en quarantaine et nous restâmes dans notre coin, parlant français entre nous. Même le Luxembourgeois s’y mit, bien qu’il le parlait très peu. Il ne connaissait que son luxembourgeois et l’allemand. Nous touchâmes les fusils et tout le barda usuel dans toute armée, depuis le caleçon (les slips étaient inconnus) jusqu’au casque et à la toile de tente en passant par tout le reste. Notre unité était une compagnie d’artillerie de campagne dont le rôle consistait à soutenir l’infanterie : c’était la 13ème compagnie d’un régiment d’infanterie. Les pièces étaient de petits canons à tube court, genre obusiers, dont la portée n’était que de 3 km environ. Chaque pièce était servie par six hommes et tractée par deux chevaux, du moins en campagne. Ici nous devions tracter les pièces nous-mêmes, 4 hommes harnachés à l’avant et 2 poussant à l’arrière (sur la photo, je suis le Richtschütze, le pointeur).
Dès le lendemain nous perçûmes notre uniforme feldgrau, des bottes et un masque à gaz. Aux pieds, pas de bas mais des Fusslappen (chaussettes russes). On se croyait revenu deux siècles en arrière. On nous vaccina contre le typhus et la variole. Il faut ménager et soigner la chair à canon ! Nous étions là une centaine de Lorrains, autant d’Allemands et quelques dizaines de Luxembourgeois. C’était l’Europe en marche mais une Europe allemande ! Et aussitôt commencèrent, en attendant la réception du fusil, les premiers exercices dans la cour de la caserne « Stillgestanden ! Rechts um ! Links um ! Hinlegen ! Auf, marsch, marsch ! Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein ! Arsch nach vorne ! » Et nous eûmes droit de la part du Feldwebel ou de l’Unteroffizier aux expressions colorées et grossières du militarisme prussien : « Sie Arsch mit Ohren ! Sie Fickbolzen ! Sie blöde Flasche ! Ich bring’ Sie auf d’n Draht dass Ihnen das Wasser im Arsch kocht !… » Bref, des grossièretés qui ne se disent bien qu’en allemand, même si toutes les armées du monde connaissent un peu le même langage. Le soir, en chambrée, nous nous moquions les uns des autres : « Eh ! sale Boche, sale Chleuh... ». N’empêche que nous nous sentions étrangers à nous-mêmes, dans cet uniforme vert-de-gris. En renvoyant à la maison nos effets civils, nous eûmes l’impression d’une rupture. C’était vraiment irréversible !Après huit jours de ce premier contact, ce fut le départ vers les unités où nous fîmes nos classes (Ausbildung). Un tiers des recrues fut dirigé vers Kulm, un second vers Danzig et le dernier, dont j’étais, fut expédié vers Gnesen. Après 24 heures de train, par Stargard, Pasewalk, Kreuz et Posen nous débarquâmes à l’Inf. Gesch. Ausb. Kp. 12 à Gnesen dans le Warthegau, -Gniezno dans l’ancienne Pologne. Il y avait là déjà des Alsaciens incorporés quelques mois avant nous. La caserne était un très vieux bâtiment datant de 1900, ayant servi aux Allemands jusqu’en 1918 puis aux Polonais jusqu’en 1939. Dans ma chambrée, nous étions 8 Lorrains, 1 Luxembourgeois, 3 gars de Pommern, plus le chef de chambre allemand avec le grade de Gefreiter. Ceux-là, nous les mîmes en quarantaine et nous restâmes dans notre coin, parlant français entre nous. Même le Luxembourgeois s’y mit, bien qu’il le parlait très peu. Il ne connaissait que son luxembourgeois et l’allemand. Nous touchâmes les fusils et tout le barda usuel dans toute armée, depuis le caleçon (les slips étaient inconnus) jusqu’au casque et à la toile de tente en passant par tout le reste. Notre unité était une compagnie d’artillerie de campagne dont le rôle consistait à soutenir l’infanterie : c’était la 13ème compagnie d’un régiment d’infanterie. Les pièces étaient de petits canons à tube court, genre obusiers, dont la portée n’était que de 3 km environ. Chaque pièce était servie par six hommes et tractée par deux chevaux, du moins en campagne. Ici nous devions tracter les pièces nous-mêmes, 4 hommes harnachés à l’avant et 2 poussant à l’arrière (sur la photo, je suis le Richtschütze, le pointeur).
C’était harassant, car les routes étaient revêtues de gros pavés et le terrain de manoeuvre était constitué de sable fin, identique dans toute la région, et on s’y enfonçait jusqu’aux chevilles. La moitié d’entre nous était affectée aux pièces, les autres aux chevaux. On les dénommait les Fahrer (conducteurs). Nos journées étaient pleinement occupées par les exercices de maniement d’armes à pied et des séances d’instruction aux pièces. Le service était très dur et nos instructeurs se comportaient comme des brutes.
Nous étions plus souvent à ramper que debout. Les chicaneries étaient monnaie courante. Le gars qui se faisait remarquer passait son temps libre du soir à exécuter des corvées de chiottes ou à brosser un escalier avec sa brosse à dents ! Nous avions la rage au coeur mais étions impuissants face à ces pratiques humiliantes.
La journée commençait à 5 heures pour se terminer avec l’extinction des feux à 22 heures. Nos paillasses étaient infestées de punaises qui perturbaient nos nuits car ces bestioles nous suçaient le sang au niveau du cou, qui au réveil était tout enflé par les piqûres. C’était insupportable.
Au bout de quelques semaines, nous sommes partis en manoeuvre pour trois jours et pendant ce temps il a été procédé au gazage de toutes les chambres dont nous avons dû au préalable obturer toutes les issues, en y collant des bandes de papier. Les premiers jours après notre retour tout allait bien. Mais très vite la plaie a repris. Les lentes n’étaient pas détruites. Tout notre séjour à Gnesen a été empoisonné, entre autre, par ces parasites.
Tous les deux jours, tous étaient de service dans les écuries (Stalldienst), et cela dès le réveil ! Il fallait nettoyer les chevaux et leurs litières. Pas un brin de paille ne devait rester dans l’allée centrale ni aucune crotte dans la litière, à la fin du travail. Si un cheval avait la mauvaise idée de déféquer à ce moment-là, il fallait accourir avec une pelle sous le derrière de la bête. Si par malheur on n’avait pas tout de suite une pelle sous la main, le sous-off nous ordonnait de prendre notre calot. Durant les classes nous portions rarement l’uniforme. Nous étions en treillis... blanc !
A l’appel du soir, il est arrivé parfois que l’Unteroffizier vom Dienst, l’U.V.D. passe sa mauvaise humeur sur nous. Pour un rien, alors que nous étions déjà tous couchés, sauf le gars de corvée, il criait : « Alles aus den Betten, marsch, marsch ! Auf die Spinde marsch, marsch ! Singen : Vom Himmel hoch da komm ich her...Unter die Betten, marsch, marsch ! Singen : Im tiefen Keller sitz’ ich nun ! Debout sur les armoires ! Marche, marche ! Un chant : Du haut du ciel je viens vers vous ... Sous les lits, en route, en avant ! Un chant : me voilà dans la cave profonde. » C’était de la folie !

La nourriture était lamentable. La plupart du temps, c’était du Eintopf, le plat unique. Nous n’avions un repas chaud qu’à midi. On nous distribuait ensuite une ration unique qui devait nous sustenter pour le soir ainsi que pour le lendemain matin : du pain Kommiss de piètre qualité, toujours sur (acidulé) avec 30 g de beurre et 80 g de saucisse ou de fromage. On aurait bien mangé cela en une fois le soir, mais alors il ne restait plus rien à se mettre sous la dent pour le lendemain matin. On avait toujours faim. Chaque semaine, nous allions au stand de tir pour des tirs à balle réelle. La même chose se déroulait avec les pièces de canon. Les terrains de manoeuvre étaient nombreux autour de la ville pour la raison qu’elle comptait une garnison très importante.

Tous les quinze jours, il y avait une marche d’une ou plusieurs journées. Dans ce cas, nous campions sous tentes. Les dimanches matins étaient occupés au nettoyage et à l’entretien du quartier, pour les uns. D’autres sortaient les chevaux au pacage. C’était moins fatigant et plus intéressant.
Notre solde était de 1 R.M. par jour, mais nous n’avions pas la possibilité de les dépenser, puisqu’avant la prestation de serment, il n’y avait pas de sorties autorisées en ville. Ce qui nous a soutenus, c’était la camaraderie qui existait entre nous, Lorrains. Le soir, après le service, on se retrouvait ensemble, on parlait du pays, on se racontait de bonnes blagues, on échafaudait des projets d’avenir ... si on en revenait. Tout cela était dit en français, ce qui énervait les Allemands de la chambrée qui nous sermonnaient : « Parlez donc allemand. Vous êtes des soldats allemands. »
Tu parles ! Je me souviens, qu’un soir, en évoquant notre avenir, je disais que je songeais à devenir prêtre et que du même coup je devais rester célibataire. Un des copains lorrains me dit : « Tu verras, t’en crèveras ! » Le sujet le plus abordé était bien sûr celui des filles. C’était ce qu’à la Wehrmacht on appelait le Thema eins.
Parmi les Lorrains, il y avait un analphabète un peu "bébête". Originaire des environs d’Hayange, il ne savait ni lire ni écrire et ne parlait pas l’allemand, qu’il comprenait tout de même un peu. Il était incapable d’écrire lui-même ses lettres et de lire celles qu’il recevait. Certains s’en chargeaient pour lui et lui jouaient des tours pendables, quand il s’agissait de lettres reçues ou envoyées à sa "petite". A la caserne, on est parfois sans pitié. Le gars était bon tireur. A la fin de l’instruction, il fut doté d’un fusil à lunette et partit au front comme Scharfschütze (tireur d’élite). C’étaient des gars sacrifiés d’avance. Je ne sais pas s’il en est revenu.
Après trois semaines de classes eut lieu la Vereidigung, le serment de fidélité. Certains incorporés alsaciens-lorrains ont eu des scrupules à propos de ce serment. Certains l’ont ostensiblement refusé, ce qui leur a valu de gros ennuis et la prison. A Gnesen, ce vœu n’a posé de problème à aucun d’entre nous. Il n’avait pour nous aucune importance puisqu’il nous était imposé de force. En le prononçant du bout des lèvres nous avons pensé : « Toi, on t’em… Vive la France et m… à la Prusse ! »
Voici le texte de ce serment instauré le 2 août 1934 : „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Devant Dieu, je prête ce saint serment d’obéir sans condition au Führer du Reich et du peuple allemands, Adolf Hitler, commandant en chef de la Wehrmacht, et d’être prêt, en soldat courageux, à donner ma vie à tout moment, pour ce serment. » De toute façon, avec ou sans ce Eid on était bon pour le casse-pipe.
Désormais nous étions censés être des soldats allemands à part entière. Parmi les chants de marche qu’on nous faisait chanter, il y en avait un que nous aimions beaucoup et que nous chantions avec toute notre conviction.
Il comportait ce passage : « Die Gedanken sind frei. Les pensées sont libres. » C’est la seule liberté qu’ils ne pouvaient pas nous prendre. Cette mascarade de cérémonie n’a rien changé à la vie qu’on nous faisait mener. Mais à partir de ce jour-là, nous avons eu droit aux sorties du samedi et du dimanche après-midi, non sans avoir été avertis par le Spiess, le juteux sur l’attention à prêter aux maladies vénériennes: « Komm’t mir ja keiner mit verbogener Gieskanne zurück. » Parfois le lundi matin il y avait inspection du service sanitaire : « Antreten zur Schwanzparade. Säbel raus. En rang, pour la parade de la queue. Epée au dehors. »
Nous profitions essentiellement de ces sorties pour aller manger à notre faim dans les restaurants avec les tickets de rationnement que nous faisaient parvenir nos familles.
La ville de Gnesen comptait 40 000 habitants, dont 5 000 Allemands venus du Reich pour kolonisieren, comme ils le faisaient chez nous en Moselle. En dehors de la cathédrale, elle ne comportait pas de monuments d’importance. Avant la guerre, l’évêque de Gnesen était le primat de Pologne, comme celui de Lyon en France.
En août, je fus convoqué feldmarschmässig, en tenue de campagne, chez le chef de compagnie, le Leutnant Kosbab-Eick qui me dit : « Ich habe Sie zum R.O.B. (Reserve Offiziers Bewerber) Lehrgang vorgeschlagen.
Je vous ai proposé de suivre une formation d’élève-officier.
- Ach, nein, Herr Leutnant, das mag ich nicht. Non, mon Lieutenant, je ne veux pas.
- Warum ? Gerade Sie als Lothringer. Dann kommen Sie nach dem Krieg nach Hauseund können sagen dass Sie deutscher Offizier waren. Pourquoi pas ? Vous qui êtes Lorrain, vous rentrerez après la guerre au pays et vous pourrez dire que vous étiez officier allemand. » Je me suis dit en moi-même : « Pauv’ c... ! Après la guerre, nous serons à nouveau Français, car la guerre, vous la perdrez et je n’ai aucune envie d’être officier chez vous ! » Mais je ne pouvais pas, bien sûr, lui l’exprimer, sinon j’étais promis au poteau pour Zersetzung der Wehrkraft, pour défaitisme. Alors je lui ai dit : « Das interessiert mich überhaupt nicht, Herr Leutnant ! ça ne m’intéresse absolument pas. » Il a bien compris ce que cette dérobade révélait de ma mentalité et de mon état d’esprit. Il a hurlé : « Scheren Sie sich raus ! Foutez-moi le camp ! » J’ai salué, fait le demi-tour réglementaire et je suis sorti. Par la suite, il n’y fera jamais allusion, mais à son regard, j’ai compris que j’étais pour lui ein Saulothringer, ein Franzosenkopf, un cochon de Lorrain. Certes, en acceptant, j’aurais retardé d’au moins six mois mon départ pour le front, et en 1943, en six mois beaucoup d’évènements étaient possibles. Mais j’aurais agi à l’encontre de mes convictions intimes selon lesquelles je n’étais pas Allemand mais Français.
Les Alliés avaient déjà débarqué en Italie, cependant le débarquement décisif en France se faisait attendre.
En septembre eut lieu la Besichtigung, l’inspection du général qui devait mettre fin à nos classes et signifier que nous étions bons pour le casse-pipe ! Ce fut une journée très dure, avec tir réel au canon, manoeuvres de toutes sortes. Nous y avons mis le paquet... car au bout, il y avait d’abord une permission de 15 jours.
Effectivement, une dizaine de jours plus tard, nous y avons eu droit. Ce furent quinze jours merveilleux de retrouvailles avec les siens et le pays, et l’occasion de raconter comment on était traité à la Wehrmacht. Et lors de mon séjour en terre natale, comme j’étais parti un jour à Thionville en uniforme, dont le port était obligatoire, j’ai été interpellé par un officier... parce que je ne portais pas la Kragenbinde, le cache-col. J’ai dû lui présenter ma perm’ et il m’a menacé de la supprimer. J’ai eu chaud. Je m’en suis sorti de justesse en lui disant qu’elle était au lavage. Les quinze jours ont passé trop vite.
Au soir du 5 octobre, j’ai fait mes adieux à mes parents et à mon frère. Cette fois, ça devenait sérieux car le retour en caserne signifiait aussi le départ pour le front et personne ne se faisait d’illusion : ce ne serait que celui de l’Est, la Russie. De part et d’autre, on se demandait : « Se reverrait-on ? Quand ? Dans quel état ? » Ni mes parents ni moi n’osions formuler la question.
Par Metz, Frankfurt, Berlin et Posen, j’ai rejoint Gnesen le lendemain vers 20 heures. A Frankfurt, le train a été stoppé devant la ville durant trois heures, car elle venait de subir un bombardement allié. La ville était en flammes. Sur des pans de mur pendaient les conduites d’où sortait encore le gaz enflammé. A Berlin aussi nous avons pu constater bien des dégâts.
Au Zapfenstreich (appel du soir), il y avait des manquants. Bien que nous connaissions la cause, nous n’avons rien dit. Le lendemain, sur les 38 Lorrains partis en permission, 10 manquaient. Nous rigolions intérieurement, car nous savions où ils étaient. Les Allemands de la chambrée n’en revenaient pas. « Das ist ja Fahnenflucht ! Die werden zum Tode verurteilt. Mais c’est de la désertion. Ils seront condamnés à mort ! » Les chefs ne disaient rien mais ils se doutaient bien qu’il y avait anguille sous roche.
Au bout de trois jours, on rassembla les 28 revenants lorrains dans une pièce et on nous fit comparaître l’un après l’autre devant le chef de compagnie entouré d’autres officiers. Afin que les premiers interrogés ne puissent pas communiquer avec les suivants, on ne les ramena pas dans la même pièce mais dans une autre. Nous nous étions de toute façon donné le mot : on ne sait rien, un point c’est tout. En fait, on savait très bien que les 10 manquants avaient pris le chemin vers la France ou s’étaient cachés, insoumis, chez eux ou ailleurs.
En effet, le soir du 5 octobre, en gare de Metz, certains permissionnaires étaient là, en civil. La feuille de route de la permission comportait un volet détachable qui restait à la gare de Metz. Nous sommes passés deux fois au portillon de départ, une fois avec notre papier, et, revenus pour un motif quelconque, nous sommes passés une deuxième fois avec celui d’un copain qui prenait le large. L’employé de gare n’a pas tiqué ou, en tant que Mosellan, n’a rien voulu voir. Ainsi, le contrôle pouvait établir que les gars étaient bel et bien partis de Metz, mais qu’ils avaient disparu entre Metz et Gnesen. Ce subterfuge fut utilisé pour couvrir si possible les parents et leur éviter des représailles.
Le chef de compagnie nous demanda à chacun s’il avait vu les absents durant la permission, s’il avait été contacté par des personnes qui lui auraient proposé l’insoumission ou la fuite nach Frankreich, s’il connaissait des passeurs, etc... Tous répondirent invariablement : « On n’a rien vu, rien entendu. » Les chefs étaient fous de rage, car ils se doutaient bien qu’on ne leur disait pas la vérité. Alors ils prirent leur revanche. Le rythme du service est devenu infernal. Tous les deux jours nous étions de garde de nuit dans les écuries (Stallwache).
Il fallait prendre soin des chevaux et le matin, présenter l’écurie dans un état impeccable. Nous nous sommes vengés à notre façon, malheureusement sur le dos des bêtes. Elles étaient allemandes après tout. Quand l’officier de ronde avait fait sa dernière tournée, vers 23 heures, nous avons pris les chevaux l’un après l’autre, les attachant à un pilier et avec un fouet, nous leur avons travaillé le dos et les flancs, en évitant d’aller jusqu’au sang. Au matin, nous avons délicatement passé la brosse à étriller pour faire disparaître toute trace de notre traitement. Quand, dans la matinée, officiers et sous-officiers avaient leur Reitstunde (séance de montage), les chevaux, qui avaient encore mal de la tannée reçue, ruaient et flanquaient plus d’un cavalier par-dessus bord. C’était cruel de notre part mais c’était une manière de leur rendre un petit peu la monnaie de la pièce.
Heureusement nous ne sommes plus restés longtemps à Gnesen. Le 20 octobre nous avons quitté sans regret ces lieux où nous avions trimé et sué durant cinq mois. Il n’y eut ni adieu ni au revoir. En marchant au pas cadencé vers la gare, nous avons chanté : « Wir wollen aus Gnesen ‘raus, aus diesem Irrenhaus, wir haben die Schnauze voll bis oben aus. Nous voulons quitter Gnesen, cette maison de fous, nous en avons ras-le-bol. »
Par Posen et Berlin, sous la conduite de deux sous-officiers, nous devions rejoindre Rostock. A Berlin où nous avions un arrêt de 4 heures, nous avons pu faire un petit tour et admirer quelques monuments de la capitale : Brandenburger Tor, Wilhelmstrasse, neue Reichskanzlei de l’Adolf, Reichstag, Dom, Schloss, etc...
Sur un contre-ordre, on a abouti dans une caserne de Schwerin où personne ne savait que faire de nous. Nous y sommes restés huit jours, nous levant le matin quand nous voulions, sans service aucun, paressant toute la journée à jouer aux cartes et à nous balader. Puis, au bout de huit jours, l’on nous a mis en route vers Rostock où nous ne sommes pas restés longtemps.
Le 6 novembre, nous avons été dirigés sur le camp de Hammerstein. En passant à Stettin, il neigeait déjà. Hammerstein dans le Kreis Schlochau in Pommern était un immense camp d’où partaient les transports vers la Russie. Nous y avons été habillés et équipés tout de neuf, avec un équipement spécial d’hiver. Nous avons perçu une masse de ravitaillement, vin, schnaps, cigarettes, etc... Puis embarquement dans des wagons à bestiaux et le 12 Novembre au soir, départ pour le grand voyage vers l’inconnu de l’inhospitalière Russie. Cette fois, c’était sans retour possible. Les Lorrains avaient été soigneusement répartis à travers tout le long convoi. Nous nous sommes complètement perdus de vue à partir de là et nous nous trouvions bien seuls dans cette marée humaine allemande que nous ne connaissions pas. J’étais triste à mourir. J’avais 19 ans et 5 mois !
Campagne d’Ukraine (hiver 1943-1944)
Les wagons de notre long convoi étaient des wagons de marchandises spécialement aménagés pour le transport de troupes. A droite et à gauche des portes latérales, il y avait de la paille pour le couchage et des râteliers pour les fusils ; en hauteur se trouvaient des étagères pour y caser notre barda, sacs à dos et tout le fourbi. Au milieu trônait un petit fourneau, signe que nous allions vers le froid. Nous ne connaissions pas notre destination précise, mais tout indiquait que c’était l’Est. Partis de Hammerstein au soir du 12 novembre vers Breslau, Posen, Lissa, Kalisch, Krakau, Tarnow, Lemberg, Tarnopol, nous arrivâmes le 16 à Shmerinka, en Roumanie. Des matka, des petites mères, en haillons vinrent nous offrir des oeufs, si en échange nous pouvions leur donner des aiguilles et du fil. Nous disposions d’un ravitaillement abondant, du schnaps et des cigarettes tous les jours. En cours de route, de pauvres gosses polonais stationnaient le long de la voie et mendiaient du pain que nous leur lancions. Par Winniza, le voyage se poursuivit vers Kasatin.
Durant tout le trajet nous devions rester en alerte permanente, à cause des attaques possibles de partisans russes.
La nuit, les portes étaient verrouillées de l’intérieur et dans chaque wagon deux hommes en armes montaient la garde. Deux wagons-plateaux chargés de lourdes pierres étaient poussés par la locomotive pour faire sauter d’éventuelles mines sur la voie. Derrière la locomotive roulait un wagon blindé, muni d’un canon léger et de mitrailleuses. Le long de la voie, tous les 10 km, des blockhaus en rondins surveillaient la voie. A plusieurs reprises, nous avons vu sur les bas-côtés de la voie des carcasses de wagons calcinés. C’était tout ce qui restait des convois attaqués par les partisans. Ce n’était pas très rassurant. Le train roulait à vitesse réduite. C’est la nuit que nous avions surtout très peur.
A Kasatin, nous avons quitté provisoirement le train pour être débarqués dans les dépendances de la gare où nous sommes restés inactifs durant plusieurs jours avant d’embarquer à nouveau dans le train mais y lanterner encore trois jours. On sentait un certain flottement. Quelque chose de grave avait dû se produire dans le coin. C’est là qu’a eu lieu un événement qui, pour nous, est resté mystérieux. (Ce n’est que bien plus tard que nous avons appris la cause de ce séjour prolongé à Kasatin). Voici les circonstances : Un jour, un petit commando de gradés est passé de wagon en wagon : il cherchait des volontaires pour la Luftwaffe en leur faisant miroiter un retour en Allemagne pour y subir un entraînement à l’armée de l’air et recevoir une affectation pour la France. C’était un commando clandestin qui cherchait à racoler et à rafler du monde pour le compte de la Luftwaffe au détriment de l’armée de terre. Nous n’avons jamais compris comment un tel raid fût possible dans une Wehrmacht pourtant si bien organisée et si méthodique. Certains compagnons se sont laissé embarquer. Quelques semaines plus tard, nous avons retrouvé quelques transfuges. En uniforme de la Luftwaffe, ils étaient effectivement retournés en Allemagne mais l’armée de terre avait réussi à les récupérer et à leur faire réintégrer leurs unités d’origine. Pour nous, tout cela traduisait une certaine désorganisation de la belle machine de guerre, jadis si bien huilée. C’était un rayon d’espoir, très menu il est vrai.
Le 7 novembre, l’Armée Rouge avait repris Kiev, passé le Dniepr et poussé jusqu’à Fastov, provoquant une débâcle locale de la Wehrmacht. Nous devions primitivement être dirigés sur Kiev. La poussée russe avait coupé la voie de chemin de fer Kiev-Fastov-Berditschev, important carrefour d’approvisionnement du front Sud.
Ce séjour de huit jours à Kasatin nous avait permis un premier contact avec l’URSS. Ce n’étaient partout que ruines et saletés. Les civils, pratiquement que des femmes, étaient habillés de guenilles et chaussés de chiffons. Les routes goudronnées n’existaient pas. Les Allemands avaient renforcé les chemins de terre, on les appelait des Rollbahnen, des pistes. On était en novembre. A la suite des pluies d’automne, la grasse terre d’Ukraine, le tchernoziom, était devenue un magma de boue, une espèce de purée où l’on s’enfonçait jusqu’aux chevilles, parfois jusqu’aux genoux.
Je devais en refaire la tragique expérience au printemps suivant, où au moment du dégel, se reproduisit le même phénomène, encore plus fortement. C’est ce que les Russes appellent la raspoutitsa. Elle faillit me coûter la vie. Ce fut un choc pour moi de découvrir toutes ces réalités, dont les journaux et revues nous avaient diffusé des photos, mais que je croyais être de la propagande allemande. Par la suite, je devais déchanter encore davantage.
Nous avons quitté définitivement notre train à Popelnja où on nous a débarqués. Nous étions encore six Lorrains à prendre la même route, d’abord jusqu’à Skwira, à 35 km de là, puis le lendemain jusqu’à Bila Zerkwa en ukrainien, Belaja Zerkoff en russe.
Le 3ème jour, il fallut continuer jusqu’à Usin, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev. Tout ce trajet à pied s’était effectué dans une gadoue indescriptible. C’était harassant. On avait peine à avancer, le sac au dos, le fusil à la bretelle, la musette et le masque à gaz vous battant le derrière.
A Usin, on nous a cantonnés dans une usine à sucre abandonnée où l’on marchait sur des montagnes de poudre cristallisée. Nous en avons constitué une bonne provision pour les jours à venir. A Usin se trouvait le P.C. de la division à laquelle nous étions affectés, la 75ème I.D. Ce village est situé à une bonne centaine de kilomètres au sud de Tchernobyl, mais ce nom ne nous disait rien encore de particulier à l’époque.
De là, nous avons été acheminés le lendemain 1er décembre, à Ludwinowka, située 15 km plus loin, et à 3 km des premières lignes. Durant la nuit, le temps avait basculé au gel, la raspoutitsa s’était figée, la neige se mit à tomber et recouvrit de sa blancheur toute la boue et la saleté des jours précédents. C’était la Russie telle que de loin on pouvait se l’imaginer. Mais pour nous, elle était là en grandeur nature.
A Ludwinowka se trouvait le P.C. du Füsilier Regiment 202- F.P.N. 09401 (Feld Post Nummer, secteur postal). La vingtaine que nous restions encore du lot initial venait le renforcer. Quel renfort ! C’est là qu’on nous répartit sur les différentes compagnies que nous devions rejoindre en première ligne la nuit suivante. Tandis que l’Oberst, le colonel, s’apprêtait à commencer cette répartition, un officier s’approcha de lui et lui souffla quelque chose à l’oreille.
S’adressant à nous, l’Oberst demanda : « Wer hat Ahnung von Musik ? Qui s’y connaît en musique ?
Flairant qu’il y avait peut-être là une planque à ne pas rater, je levai la main. Il n’y avait de toutes façons pas de corvée de chiottes à craindre comme à la caserne. De toute manière, ici au front, on pouvait s’y risquer.
« Was sind Sie von Beruf ? Quelle est votre profession ?
- Oberschüler, Herr Oberst ! Lycéen, mon Colonel !
- Links raus ! Sie sind abkommandiert zur Division zu einem Funkerlehrgang. Vous allez retourner à la division pour un stage d’opérateur-radio. »
La chance venait de me sourire. C’était six semaines de sursis pour le front et peut-être six semaines de gagnées sur la mort. J’appris par la suite la raison de ce stage qui devait, au moins pour un temps, décider du changement de mon affectation. Lors de l’attaque-surprise des Russes sur Kiev -ils avaient astucieusement préparé le passage du Dniepr en aménageant des ponts sous la surface de l’eau -et de leur poussée jusque Fastov, l’équipe radio de la division avait été bousculée, décimée. Certains opérateurs étaient tombés, les autres avaient disparu, sans doute prisonniers. Il fallait donc les remplacer.
Avec quelques Allemands et un Luxembourgeois, Franz Georgen de Remich, je retournai à Usin, à 15 km des premières lignes. C’était plus rassurant. Usin était un gros village. La population était restée sur place.
Nous prîmes quartier chez l’habitant, par deux ou trois, selon les maisons. L’ami luxembourgeois et moi, nous nous arrangeâmes pour loger dans la même isba.
Toutes les maisons du village étaient du même type : une construction très basse, sans étage avec des murs en torchis blanchis à la chaux et un épais toit de paille. De la main, on pouvait toucher le toit. De très petites fenêtres à double battant de vitres, à cause du froid. A l’intérieur, une pièce et la cuisine. Pas de plancher mais de la terre battue, cela simplifiait le nettoyage ! Le four occupait la plus grande place de la cuisine. Il remplissait plusieurs fonctions : on y faisait la cuisine dans des pots en terre cuite, il chauffait la petite maison et le dessus servait de chambre à coucher pour tout le monde. On n’avait pas besoin de bouillotte en hiver ! Il n’y avait pas d’électricité. On s’éclairait avec de petits lumignons à huile et on se couchait très tôt, car en hiver, il faisait nuit à 16 heures. Pas d’eau courante non plus. On allait chercher l’eau au puits ; en hiver, on faisait fondre la neige qui était abondante. Dans un coin de la pièce se signalait l’icône qui ne manquait dans aucune isba. Elle était toujours décorée de petites dentelles et de fleurs séchées. Parfois une petite lampe à huile brûlait devant elle. Du temps des Soviets, les gens les avaient cachées et lors de l’arrivée des Allemands les avaient remises à la place d’honneur. En hiver, les poules faisaient bon ménage avec les gens dans la cuisine. Le mobilier se réduisait en général à un bahut où l’on gardait la petite réserve de grains, les oeufs et les quelques habits que l’on possédait. Une table et quelques tabourets ou un banc complétaient ce mobilier rudimentaire. Parfois on y trouvait un lit.
Les gens vivaient pauvrement. Du pain, des kartoschki (patates) qu’on conservait à la cave, qui était en fait un trou dans le jardin recouvert de paille et de planches. Cette paille servait aussi à chauffer le four et à faire la cuisine. Chaque village disposait d’une immense meule de paille longue de plus de 100 mètres et haute de quelques mètres, près du kolkhoze. Chacun venait y faire provision. En hiver, on en entourait les murs extérieurs de l’isba en la mélangeant avec du fumier. C’était une excellente protection contre le froid. Peu d’hommes séjournaient au village. Ils étaient ou à l’Armée rouge ou prisonniers en Allemagne ou... partisans. On ne voyait pratiquement que des femmes, des enfants et des vieillards, tous habillés de guenilles, des chiffons noués aux pieds. Les femmes portaient invariablement, dehors comme dedans, un fichu sur la tête. L’hygiène laissait à désirer. Comme ils couchaient tout habillés sur le four, ça grouillait de poux, qui furent pour nous une plaie.
Chaque soir, à la lueur d’un petit lumignon, nous faisions la chasse aux partisans, comme nous disions, c’est-à-dire aux poux. Le petit coin était un simple trou dans la nature. Dans le premier quartier que nous avons occupé, le Luxembourgeois et moi avons très rapidement essayé d’entrer en contact avec le gens chez qui nous logions : une matka avec ses enfants et un grand-père. Nous commencions à apprendre quelques mots de russe, eux savaient quelques bribes d’allemand. Timidement, car nous ne connaissions pas trop leur mentalité face aux Allemands, la méfiance était de mise chez les uns et chez les autres. Par signes et avec des dessins, nous leur avons fait comprendre que nous n’étions pas des Allemands, mais des incorporés de force français et luxembourgeois, sous cet uniforme. Leur visage s’est éclairé : « Da, da ! » Ils avaient compris. La petite matka, mise en confiance, nous dit un soir : « Stalin nix gut, Hitler (elle prononçait Gitler) nix gut ! » C’était en 1943. La petite paysanne ukrainienne n’a pas attendu 1956 et Khrouchtchev, ni le 22ème Congrès du Parti communiste Français de 1976, pour dénoncer les crimes de Staline ! A partir de ce moment-là, nos relations sont devenues très amicales. Malheureusement, on nous a changés de quartier après quelques semaines.
Dans le nouveau quartier qu’on nous a attribué, vivait une matka avec ses enfants et, réfugié chez elle, un couple d’âge moyen, replié de Woronej, professeurs tous les deux. Nous y avons fait la même approche. Ce fut plus facile, car la réfugiée avait appris le français dans sa jeunesse, au lycée. C’était la première fois depuis 30 ans qu’elle avait l’occasion de le parler à nouveau. Elle en savait encore pas mal, en tout cas suffisamment pour nous comprendre, nous permettre d’expliquer notre situation et lui faire savoir quels étaient nos sentiments.
Cela détendit là aussi l’atmosphère. Par elle nous apprîmes que le mari de notre propriétaire avait été déporté en Sibérie en 1937 lors des grandes purges de Staline et qu’elle en était sans nouvelles depuis. « Pan (monsieur) kaputt ? » nous dit-elle avec un geste d’interrogation. Je leur ai montré une photo de famille faite durant ma dernière permission. « Kapitalist ! » se sont-ils écriés. Mes parents et mon frère étaient tout simplement endimanchés. Quand je leur ai dit que mon père était un petit garde-barrière, ils n’en revenaient pas, c’est dire combien le niveau de vie était minable au pays des Soviets.
Pour Noël, la matka nous fit à tous deux un dessert, une spécialité d’Ukraine faite de je ne sais quels ingrédients que nous n’avons pas du tout trouvée à notre goût. Nous lui avons tout de même dit que c’était bon.
Le professeur réfugié était toujours couché, soi-disant malade. L’était-il vraiment ou le simulait-il pour échapper aux corvées que la Wehrmacht imposait aux rares hommes valides du village ? Nous ne le sûmes jamais.
Durant la journée nous faisions, de 8 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, l’apprentissage de Melder afin de nous familiariser avec les appareils radio. Un vrai horaire d’écolier ! Notre formation consistait donc à apprendre l’alphabet morse, à le décoder puis à recevoir et à envoyer des messages codés du bataillon à la compagnie. Ces cours se pratiquaient dans une maison réquisitionnée et spécialement aménagée par la division. L’endroit était bien chauffé grâce au four alimenté continuellement avec de la paille. Nous ne souffrions pas du froid qui était devenu intense. Une haute couche de neige recouvrait tout. Le ciel était éternellement gris et dans ce pays tout plat d’Ukraine, on ne voyait pas la ligne d’horizon, le ciel et le paysage enneigé ne faisant qu’un.
A midi nous touchions à la roulante du goulasch ainsi que la ration froide du soir et du lendemain matin, et nous allions manger chez nous où notre matka nous faisait cuire des kartoschki à l’eau. Il lui fallait pour cela une bonne partie de la matinée, penchée à l’entrée du four, y enfournant continuellement de la paille et y déplaçant les pots de terre cuite avec un crochet en forme de U. Je dois dire que cette cuisson au four et à la paille donnait un goût agréable aux patates.
A 16 heures nous rentrions au quartier, car la nuit commençait à tomber. Nous avions heureusement des petites chandelles, genre de veilleuses appelées Hindenburglichter. Ces soirées étaient très longues et ramenaient nostalgiquement nos pensées au pays natal. Nous les passions à écrire à la maison, à grignoter des graines de tournesol, à fumer du mahorka, du tabac russe, à parler du pays et surtout à faire la chasse aux poux dont tout notre linge et nos habits étaient infestés. Chaque soir, c’est par centaines que nous les écrasions entre les ongles de nos pouces. Mais nous ne venions pas à bout des lentes. Parfois nous étalions certains habits toute une nuit sur la neige, par un froid de -20° C. Cela ne servait à rien. Nous ne parvenions pas à éliminer ces partisans comme nous appelions ces bestioles maudites qui nous démangeaient jour et nuit. Il n’était pas question de se déshabiller la nuit. Franz et moi avions organisé une carcasse de lit en fer sur laquelle nous avons mis une épaisse couche de paille et nous dormions là-dessus tous les deux comme des princes, à l’abri de la neige et du froid.
Pas très rassurés cependant à cause de la peur des partisans, les vrais cette fois. Chaque nuit, des patrouilles de chez nous montaient la garde au village, à tour de rôle durant deux heures. Nous patrouillions toujours à deux : un soldat et un Hiwi, ein Hilfswilliger. Ces Hiwis étaient des Russes faits prisonniers par les Allemands depuis 1941. Dans les camps, les Allemands avaient recruté des volontaires prêts à collaborer avec eux. Ils étaient habillés comme nous, mais ne portaient ni le Spatz (le moineau par dérision à l’aigle, Adler), ni la croix gammée. Occasionnellement, pour monter la garde, ils étaient armés. On les utilisait pour toutes sortes de travaux à l’arrière, en particulier comme conducteurs des voitures hippomobiles (Panjewagen) qui transportaient ravitaillement et munitions. Ces pauvres bougres s’étaient portés volontaires non par idéologie mais simplement pour survivre. Dans les camps de prisonniers, leur condition de vie était infernale. Des millions y sont morts de faim. Ici au moins, ils avaient à manger. Ils touchaient les mêmes rations que nous. Mais on ne savait pas trop si on pouvait leur faire confiance.
Comme nous Alsaciens-Lorrains, ils étaient en quelque sorte des incorporés de force, mais recrutés sous d’autres conditions. Je n’étais jamais très rassuré de monter la garde durant deux heures dans la nuit à travers le village, avec un Hiwi originaire de Omsk ou de Tomsk en Sibérie. Il savait trois mots d’allemand, moi autant de russe. La conversation était limitée. Bien sûr, j’étais armé, lui aussi. Que se serait-il passé si nous étions tombés dans un guet-apens de partisans ? Quel parti aurait-il pris ? Je n’osais pas trop y penser.
Heureusement, il n’y eut jamais d’incident de ce genre durant ces quatre semaines. Ce qui nous faisait le plus souffrir, c’était le manque de courrier. Nous écrivions presque tous les jours aux nôtres. Ça les rassurait, mais depuis le départ de la caserne, début novembre, aucun courrier ne nous était parvenu. Cela rongeait le moral. Noël approchait et cela allait encore accentuer le cafard. Certes, nous n’étions pas confrontés directement au danger, nous étions vernis, comparés à ceux qui logeaient dans la neige et le froid glacial des premières lignes.
Le ravitaillement était correct, mais nous en avions gros sur le coeur. Il faut ajouter que le paysage russe en hiver, plat, blanc et gris, avec ses longues nuits prédisposait aussi à la nostalgie. Pour Noël, nous avons été gâtés matériellement par un supplément important de boustifaille : petits gâteaux, bonbons et chocolat, biscuit et bûche, schnaps, tabac et cigarettes. Mais nous aurions préféré être à la maison.
Avec quelques autres, des Allemands, nous nous sommes retrouvés ensemble dans leur quartier, la nuit de Noël. Ils avaient un récepteur radio de service. On a pu capter des stations allemandes qui diffusaient des chants de Noël que nous avons fredonnés, les larmes aux yeux. Nous avons grignoté les bonnes choses et puis il y avait le schnaps qui a coulé à flots. Au bout de deux heures, presque tous ronflaient et... cuvaient sous la table. Seul un Berlinois, déjà pas mal éméché, criait encore à tue-tête. Franz et moi nous lui avons encore versé quelques rasades jusqu’à ce qu’il s’écroulât lui aussi. Et alors... nous avons fait quelque chose de pendable. Si nous avions été surpris, c’était le Kriegsgericht, le conseil de guerre. Nous nous sommes amusés à tourner les boutons du poste-radio et sans en connaître jusque-là la longueur d’onde, nous sommes tombés sur le Soldatensender Calais. C’était l’émission de Radio Londres pour la Wehrmacht. Difficile de dire l’impression ressentie en entendant une voix amie sous l’uniforme allemand dans les neiges de Russie. Ça nous a remonté le moral plus que le schnaps. Nous nous sentions moins abandonnés. De retour dans notre quartier, malgré tout, un peu dans les vapeurs, nous avons continué longtemps encore à évoquer des souvenirs en cette première nuit de Noël, loin de chez nous, perdus dans cette maudite Russie, sous notre sapin, en l’occurrence quelques branches sur lesquelles nous avions accroché des morceaux de papier argenté et du coton.
Le lendemain, 26 décembre, à la distribution du courrier, il y avait une lettre de mes parents, très récente puisque datée du 18. Quelle joie ! La première depuis sept semaines. Je ne sais plus combien de fois je l’ai relue. Longtemps après, j’appris qu’un de mes cousins était porté disparu depuis le soir de Noël, dans le secteur où je me trouvais, mais j’ignorais tout de sa présence. C’est seulement 20 ans après la guerre que ses parents apprendront qu’il était tombé lors d’une attaque russe et que son corps n’a pas été retrouvé.
Après Noël, notre formation radio a repris, mais pas pour longtemps. Normalement, elle aurait dû se terminer vers le 15 janvier, mais les Russes en décidèrent autrement.
Historique : L’armée soviétique pénètre en Pologne.
Le 3 janvier 1944, des forces mobiles soviétiques se dirigeant vers l’Ouest s’emparèrent de l’embranchement ferroviaire de Novigrad Volynsk, à 80 kilomètres au-delà de Korosten.
Le lendemain, elles franchissaient la frontière polonaise d’avant-guerre.
Sur le flanc Sud, les Allemands abandonnèrent Byelaya Tserkov et Berditchev pour se replier sur Vinnitsa et le fleuve Boug, afin de protéger la principale ligne ferroviaire latérale Odessa-Varsovie (réseau qui permit à Denis Hantz, rappelons-le, de s’extirper in extremis du guêpier). Le maréchal Manstein réunit aussitôt quelques réserves et tenta une nouvelle contre-attaque. Mais celle-ci n’était pas fortement appuyée, de plus les Soviétiques l’attendaient de pied ferme. Cependant, la réplique allemande put contenir momentanément l’avancée ennemie vers le Boug, mais faute de renforts elle laissa le champ libre aux Russes dont les forces se répandirent latéralement. Depuis Berditchev et Jitomir, les Soviétiques poussaient vers l’Ouest et contournant l’obstacle de Shepetovka, ils s’emparaient le 5 février 1944 de l’important centre de communications polonais de Rovno.
Le même jour, un mouvement tournant leur permettait de s’emparer de Luck, à près de 80 kilomètres de Rovno et à plus de 150 kilomètres au-delà de la frontière soviétique. Les forces allemandes, bloquées entre les têtes-de-pont soviétiques de Kiev et de Tcherkassy par l’ordre d’Adolf Hitler qui leur interdisait toute retraite de leurs positions avancées près du Dniepr, allaient être prises en tenailles. Le 28 janvier 1944, quand les pinces se furent refermées sur eux, des éléments de 6 divisions allemandes se retrouvèrent encerclés.
Grâce aux efforts de deux Corps de Panzer, des tentatives pour secourir les divisions cernées finirent par être couronnées de succès. Sur les 56 000 Allemands assiégés dans la poche de Korsoun, 30 000 purent se sauver en abandonnant leur matériel. 18 000 restèrent pris au piège, prisonniers ou blessés. Mais ces efforts pour délivrer leurs troupes encerclées coûtèrent aux Allemands leur position avancée sur la boucle du Dniepr, plus au Sud.
Et le 8 février 1944, ne disposant plus de forces de soutien sur leurs flancs, ils évacuèrent la région de Nikopol, siège d’un important gisement de minerai de manganèse.
Deux semaines plus tard, les Allemands, placés sous la menace d’un encerclement encore plus grand, durent évacuer la ville de Krivoï Rog. Les profonds saillants ouverts par les Soviétiques dans le front méridional, entre les marais du Pripet et la Mer Noire, avaient allongé le front que les troupes amoindries du Süd Abschnitt devaient tenir. Les pertes du Reich de plus en plus lourdes, en particulier lors de l’offensive de Korsoun, avaient laissé des brèches qu’il était désormais impossible de combler (à comparer au récit de Jean Ernst, Ndr).
Le bon sens préconisait un repli sur une ligne droite mais les ordres rigides d’Adolf Hitler avaient interdit de raccourcir ce front distendu. La conséquence du diktat du Führer entraînera ensuite une retraite bien plus importante que celle envisagée deux mois plus tôt.
La faiblesse de leurs effectifs et l’immensité de l’espace finirent par faire naître un sentiment d’impuissance parmi les troupes allemandes. Cette infériorité était accentuée par les forces impressionnantes de l’armée ennemie nullement affectée par des problèmes de ravitaillement.
Les Soviétiques parvenaient à subsister là où n’importe quelle armée occidentale serait morte de faim, et ils pouvaient continuer d’avancer là où toute autre armée aurait été bloquée sur place à attendre la réparation des voies de communication. Les forces mobiles allemandes qui essayaient de freiner l’avance de l’Armée Rouge en attaquant ses lignes de communications trouvaient rarement une colonne de ravitaillement amie apte à les ressourcer pour tenir tête à la marée rouge…..
La retraite de Russie était bel et bien enclenchée !
Offensive russe
Le 1er janvier le stage fut brusquement interrompu. Les stagiaires devaient regagner leurs unités respectives ; moi je retrouvai le F.R. 202 à Ludwinowka, au P.C. de mon régiment que je ralliai en refaisant tout seul le chemin à pied. Un avion Yak soviétique m’obligea à me coucher à plusieurs reprises dans la haute neige.
Au P.C., c’était le branle-bas de combat en ce début du Nouvel An. Les Russes venaient d’attaquer au nord et au sud, en cherchant à prendre en tenaille toute la région autour de Schaschkov. Avec un traîneau attelé, le copain radio auquel j’étais adjoint et moi, nous allâmes vite enrouler les kilomètres de fil téléphonique qui reliaient le P.C. aux différentes unités du régiment. Puis ce fut le repli car nous risquions l’encerclement. Tantôt nous marchions vers le sud, tantôt vers l’ouest. Nos positions étaient soit orientées vers l’est, soit vers le sud, parfois franchement vers l’ouest. On tournait en rond et nous sentions bien que par moment nous étions totalement encerclés. Ainsi ballottés entre Leschtschinka, Schubowka, Alexandrowka, Bogislaw, Taraschtscha, Medwin, Isaiki, par un froid intense et dans la haute neige, nous échappâmes malgré tout au grand chaudron de Kanew-Korsun, appelé par les Allemands "Kessel von Tcherkassy".
Le ravitaillement ne nous rejoignait plus ni le courrier. C’est là que je vis mes premiers morts. Leur vue donnait un choc, mais on s’y habituait très vite par la force des choses, et on cassait la croûte, assis sur des cadavres russes qui avaient gelé à pierre fendre et qui nous servaient de tabourets dans la neige. Les Russes étaient bien mieux protégés du froid que nous. Ils portaient d’épaisses bottes de feutre, leurs anoraks étaient bien fourrés. Nous, par contre, n’avions que nos bottes de cuir humides et nous ne disposions que de capotes bien légères. Par la suite, on nous distribuera des Zwischenhosen à mettre entre le caleçon et le pantalon. C’était une maigre protection. Nous souffrions atrocement du froid
A Buschanka, début février, nous réussîmes à forcer un encerclement. On y fit des prisonniers. Un ordre sans appel fut donné par un officier : « Umlegen ! A abattre ! » Chaque section dut en prendre une dizaine et les abattre. Ce fut horrible pour moi. Avec un Allemand, j’ai refusé de participer au massacre. Notre sous-off’ n’a pas insisté. Mais qu’aurais-je fait s’il m’en avait donné l’ordre formel ? Je ne sais pas. Je n’avais pas 20 ans. J’aurais peut-être choisi ma vie contre celle de l’autre.
J’ai toujours encore cette scène présente à l’esprit, ces pauvres gars s’affaissant sous les balles qui leur étaient tirées dans le dos. Nous nous étions entretenus quelque peu avec eux auparavant. Ils ne se doutaient de rien. Quand on les a amenés un peu à l’écart, on leur a dit : « Roboti ! au travail. » La plupart venaient d’un bataillon disciplinaire. La matka d’Usin avait bien raison : « Stalin nix gut, Hitler nix gut ! »
Par Rubany, Buki et Krasni nous arrivâmes de nuit devant le village d’Ochmatoff occupé par les Russes. Après un assaut à l’aurore, ils en furent délogés et nous y pénétrâmes... pour en être délogés nous-mêmes quelques heures plus tard. A un moment donné, j’ai dû me jeter dans la neige sur un terrain légèrement en pente.
Une mitrailleuse russe m’avait pris comme cible. En soulevant légèrement la tête, j’ai vu l’impact des balles juste devant moi. J’ai fait le mort. Après une rafale plus longue, subodorant le fait que le tireur avait vidé sa bande et devait la remplacer, j’ai fait un bond jusque derrière une maison vingt mètres plus loin. Mon calcul était le bon, mais j’avais eu très chaud. Dans la journée nous avons repris le village... pour le perdre à nouveau la nuit suivante, la pression ennemie nous forçant à nous replier sous les tirs des katiouchka (orgues de Staline).
Vers le 10 février le front s’est figé dans notre secteur. Nous avons tenu une position plus calme durant trois semaines, près d’un petit lac à Woronoje. L’activité y était réduite, sauf de nuit.
Il arrivait qu’une patrouille russe s’infiltre et s’empare de l’une de nos sentinelles dont on retrouvait le corps le lendemain matin, les yeux crevés.
Le 1er mars la poussée russe reprit et une nouvelle cavalcade recommença pour nous. Les Allemands pratiquèrent la tactique de la terre brûlée. Les villages furent incendiés. Les hommes qui s’y trouvaient encore furent emmenés de force. Au passage par l’une des rares forêts plantées dans le paysage, plusieurs centaines d’entre eux furent rassemblés dans une clairière et passés à la mitrailleuse. J’ai vu un villageois qui réussit à se sauver entre les arbres à une vitesse diabolique. Un officier à cheval se mit à sa poursuite. Je ne sais pas s’il l’a rattrapé. On comprend que les Russes, découvrant à la suite de leurs offensives ces charniers, ne faisaient pas de quartier aux prisonniers allemands.
Durant ma permission de mai 1944, un membre du Parti nazi, un Allemand, que je connaissais, est venu me demander si c’était vrai que leurs troupes fusillaient les prisonniers russes. Je lui ai raconté les deux faits cités plus haut et dont j’avais été témoin. Il en était effondré. « Notre Führer ne sait pas cela ! » me dit-il. Il était de bonne foi mais naïf.
Notre repli s’amplifia. Tout le secteur Sud se mit en mouvement de débandade. Passant à la lisière nord d’Uman, nous étions irrésistiblement poussés par les Russes vers l’Ouest au prix d’une retraite d’au moins 400 km, qu’il fallut faire à pied, toujours talonnés par l’Armée Rouge. Entre Gaïssin et Tultschin, nous arrivâmes au Bug. Pas de pont en vue ! Le temps pressait. On fabriqua un radeau improvisé avec des bidons d’essence vides et quelques planches. De chaque côté du fleuve, un cheval tractait ce radeau de fortune dans un mouvement de va-et-vient. Onze hommes à genoux, à cause de l’équilibre, traversaient à chaque passage. Sous le poids, le radeau était en fait sous l’eau. Pour gagner du temps, l’embarcation n’allait pas jusqu’à la rive. Dès qu’on avait pied, il fallait faire les derniers mètres dans l’eau jusqu’au cou. Nous étions le 14 mars et il gelait encore. Inutile de dire que nous n’avons pas eu de vêtements de rechange ni un bon grog de l’autre côté. Nos frocs ont dû sécher sur la peau, tels quels, les jours suivants. Tout le régiment -ce qui en restait- a pu ainsi retrouver pied ferme sur la rive sécurisante du Bug. En effet nous pensions qu’un moment de répit nous serait donné, le fleuve nous offrant une barrière, au moins provisoire, contre les Russes. Erreur ! Ces derniers avaient déjà réussi à le franchir ailleurs à plusieurs endroits. Un autre ennemi se rajouta : la raspoutitsa, le dégel. Toutes les routes et tous les chemins, toutes les Rollbahnen devinrent des fleuves de boue pires que celles empruntées en novembre. Heureusement, la raspoutitsa ralentissait aussi les copains d’en face. Notre retraite s’effectua dans des conditions épouvantables.
Le ravitaillement régulier ne nous parvenait plus.
On se débrouillait : un cochon par ci, une poule par là. Notre marche s’effectuait de jour, la nuit nous prenions quartier dans un village, où parfois les partisans nous attaquaient. Un jour, en rase campagne, à la sortie d’un village, nous eûmes des chars russes T 34 à nos trousses. Pour leur échapper, il fallut traverser une de ces Rollbahnen, un vrai fleuve de boue ! On devait veiller à n’avoir toujours qu’un pied dans cette fange qui montait jusqu’aux genoux, afin de peser du poids de son corps pour le sortir au moment de faire le pas suivant. A un moment donné, je me suis trouvé les deux jambes dans la bourbe. Impossible d’en sortir. Et ça canardait derrière nous. Seul, j’y serais resté. Je tendis ma carabine à un copain qui se trouvait déjà à un endroit plus ferme. Il me tira de là... mais une de mes bottes resta prisonnière de la gadoue qui s’est aussitôt refermée sur elle. J’ai dû continuer ma route avec un pied botté et l’autre nu. Un Major, rencontré un peu plus loin me regarda et me dit : « Junger, du hast wohl die Kurve zu schnell gekratzt ! Tu as dû prendre le virage trop vite. » Il mit la main dans la poche intérieure de son manteau, en sortit une bouteille de cognac et me dit : « Hier, nimm mal ein’ Schluck ! Tiens, prends-en une gorgée. » J’ai trouvé ça sympa. Un morceau de Kommiss que le gradé a rajouté m’a goûté comme si c’était du gâteau. Quelques heures plus tard, j’ai récupéré une botte sur un cadavre et je l’ai enfilée, sans pouvoir passer mes pieds à la douche. Au bout de quelques jours, mes pieds ont lâché. Le frottement du cuir des bottes sur mes pieds emboués les avait mis à feu et à sang, je n’en pouvais plus. Passant à proximité d’une infirmerie de campagne en train de plier bagage, je pensais pouvoir y être admis et évacué avec eux. L’Oberarzt, le médecin-chef, me dit qu’il n’avait plus assez de véhicules pour sortir tous ses blessés de là et il ajouta : « Versuchen Sie soweit wie möglich nach Westen zu kommen ! Essayez de parvenir aussi loin que possible vers l’Ouest. » Conseil judicieux... mais comment faire ? C’était la débandade totale. La cohésion entre les unités avait disparu. C’était le sauve-qui-peut individuel dans des conditions et un désordre indescriptible. La retraite de Russie ! J’ai réussi à m’emparer d’un petit cheval grand comme un poney, à le monter, sans selle, bien sûr, et à essayer de fuir dans des conditions meilleures qu’à pied. Mais bien vite je me suis rendu compte qu’il était borgne et avait tendance à tourner en rond. J’ai eu bien du mal à le faire avancer dans le bon sens. Une journée là-dessus... et j’avais le derrière en compote, pouvant à peine m’asseoir. J’ai lâché le quadrupède dans la nature et j’ai repris, cahin-caha, ma marche à pied.
J’ai pu faire du stop, grâce à la présence providentielle d’un chauffeur de camion qui fuyait lui aussi, mais au bout de quelques kilomètres son véhicule est tombé en panne d’essence. On l’a incendié et on a continué à clopiner tant bien que mal, la faim au ventre.
C’est dans cet état calamiteux que j’ai atteint le secteur de Moguilev-Podolsk, sur le Dniestr, le 20 mars.
Au passage, j’avais vu un panneau invitant les blessés à se rendre à la gare. Je m’y suis aussitôt dirigé, le fusil me servait de canne. Un soldat roumain, au vu de mon état minable, me donna du sucre et du pain. Un peu plus loin, j’ai refait du stop. Le conducteur d’un Sanka, une voiture sanitaire surchargée de blessés, m’a pris en pitié, je me suis installé sur son capot jusqu’à la gare. Il y avait là effectivement encore un train sous vapeur, déjà bondé de blessés. Je ne pouvais pas y monter, il me fallait présenter une fiche de blessé sinon je risquais de passer pour un déserteur ou un fuyard. J’accostai un médecin sur le quai et lui expliquai mon cas. Le praticien me dit de monter dans le train, qu’il passerait plus tard, qu’il fallait faire vite car d’un instant à l’autre les ponts sur le Dniestr allaient sauter. De fait les Russes s’empareront de Moguilev le même soir.
Le train s’est mis en route. J’ai poussé un soupir de soulagement ! Quand le médecin est passé ensuite pour constater mes blessures, les infirmiers qui l’accompagnaient n’ont pas réussi à m’enlever les bottes. Il a fallu les couper. Les deux pieds étaient profondément infectés et pleins de pus. Après un pansement provisoire, le médecin me délivra un Verwundetenzettel, la fiche de blessé -je l’ai encore -sur lequel je pus lire que notre destination était le Hauptverbandsplatz, l’hôpital de campagne de Lipkany. J’étais provisoirement sauvé, du moins je le pensais.
Le train n’a roulé que quelques dizaines de kilomètres, au ralenti, avant de s’arrêter en rase campagne où il est resté bloqué durant trois jours. Nous en ignorions la raison. De ravitaillement, il n’y en eut point. Nous avons attaqué nos Eiserne Portionen, les rations de fer qui contenaient quelques biscottes et une petite boîte de singe. Nous avons appris plus tard que les Russes, toujours en avance sur nous, avaient coupé la voie. Comme une contre-attaque allemande avait réussi à les déloger, nous avons pu continuer, non plus sur Lipkany déjà occupé par les Russes, mais en passant par Czernowitz jusqu’à Koloméa où nous sommes arrivés le 24 mars et où on nous a débarqués dans un Lazarett.
On m’a mis des gouttières aux deux pieds. On nous a dit de garder l’uniforme au lit. C’était de mauvais augure. Le lendemain, dans l’après-midi, nous avons été intrigués de ne plus voir ni médecins ni infirmières. Les plus valides ont fait le tour de l’hôpital ; tout le personnel avait pris la fuite, ce qui signifiait l’arrivée imminente des Russes. Dans les salles des grands blessés, il y avait sur la table une assiette de cachets. De quelle nature ? Peut-être du cyanure pour leur éviter la captivité ? Tous ceux qui pouvaient encore marcher, dont moi avec mes gouttières, nous nous rendîmes à la gare où une partie du personnel était encore en poste. On nous dit qu’il n’y avait plus d’espoir de trouver un train pour sortir de ce guêpier. Nous sommes néanmoins restés sur place. Dans la nuit, un train sanitaire roumain vide, provenant d’Odessa, est arrivé en gare. Nous l’avons pris d’assaut malgré la réticence des Roumains. C’est grâce à ce dernier train que nous sommes sortis de cet enfer pour arriver à Vienne (Wien) le 29 mars.
Quand on nous a sortis du train, les civils qui étaient là ont hoché la tête, n’en croyant pas leurs yeux. Etait-ce là la fière Wehrmacht ? Jusqu’au ceinturon, mon manteau et mon pantalon étaient recouverts d’une épaisse couche de boue brune. Les frottements continus avaient lissé cette boue comme si mon uniforme était de cuir.
Nous avons été dirigés sur le Reserve Lazarett XI C. Dire la sensation qu’on a éprouvée quand nous avons pu quitter ces frocs qu’on n’avait pas enlevés depuis six mois, quand nous avons été baignés et brossés par de gentilles infirmières, quand on s’est retrouvé dans un lit avec des draps blancs, est impossible à traduire. C’était une véritable jouissance. A cela s’ajoutait la joie d’être revenu en terre civilisée, loin du terrible front.
A cause des risques de bombardements aériens sur Wien, je fus transféré au bout de quelques jours au Res. Laz. Payerbach, près de Reichenau an der Rax, où j’allais rester tout le mois d’avril 1944. Le Lazarett était un hôtel réquisitionné, situé dans les Raxalpen, dans une contrée magnifique. J’y reçus les soins dont mes pieds avaient besoin car ils étaient en très mauvais état. On me découvrit une anémie et une affection rénale. Pas étonnant, après le terrible mois de mars que nous avions vécu ! Le séjour dans ce Lazarett fut très agréable.
Le côté militaire n’y était pas visible. Ce fut surtout un temps de repos et de récupération, car notre déficit de sommeil était grand. Fin avril, je bénéficiais de 15 jours de Genesungsurlaub (convalescence). Cela me fit du bien de me retrouver en famille. En fin de permission, je devais rejoindre ma Ersatz-Kompanie à Rostock.
Le 11 mai je partis donc rejoindre cette unité où avaient débuté mes premiers pas à la Wehrmacht. Au centre de Rostock j’attendais le tram qui devait me conduire à la Füsilier Kaserne. Il me faut vous préciser qu’à la sortie du Lazarett nous avions été habillés très sommairement ; pour ma part, j’étais affublé d’habits qui n’étaient pas à ma taille, un calot trop petit que je ne pouvais pas mettre, je ne disposais pas de ceinturon, bref, j’étais mal fagoté.
Du trottoir d’en face, un civil en manteau de cuir s’est dirigé vers moi, m’a sorti sa carte d’identité et m’a dit : « Ich bin Hauptmann. Mensch, Kerl, wie laufen Sie herum, ohne Koppel ohne Mütze ? Je suis capitaine. Quelle tenue, mon gaillard, vous circulez sans ceinturon ni calot ?
- Ich komme aus Russland über’s Lazarett, Herr Hauptmann, und bin so entlassen worden ! Je reviens de Russie via le lazaret, qui m’a libéré ainsi.
- Dann bitte ich um Entschuldigung und wünsche Ihnen gute Genesung ! Alors excusez-moi et je vous souhaite bon rétablissement. »
J’ai savouré cette petite satisfaction d’avoir eu barre sur un Hauptmann qui voulait faire du zèle parce qu’il trouvait que je donnais une impression minable de sa fière Wehrmacht.
Quand on revient du front, ça fait drôle de se retrouver en caserne. Tous ceux qui étaient là revenaient eux aussi de Russie via le lazaret et attendaient, soit une permission, soit le retour au front. Le service y était très relaxe. On me fit confectionner des semelles orthopédiques pour mes bottes, car mes pieds avaient trop souffert.
Les bombardements alliés étaient fréquents et nous passions souvent la nuit à la cave.
Au bout de trois semaines, fin mai, je pus repartir en Erholungsurlaub, en permission de détente, à laquelle j’avais droit après six mois de présence au front. Elle passa trop vite à mon goût. Elle se termina le 7 juin.
Au soir du 6, on apprit la grande nouvelle du débarquement allié en Normandie. La tentation était grande de filer ou de se cacher. Mais où et comment ? Il était difficile de prévoir comment les évènements allaient se dérouler. Combien de temps faudrait-il aux Alliés pour libérer le pays ? En fait, trois mois plus tard, ils étaient là en Lorraine mais qui pouvait prévoir cela le 6 juin ?
Je repartis donc le coeur très gros, ne sachant pas quand et comment j’en reviendrai.
A Rostock, nous avons repris le service qui consistait essentiellement à monter la garde de nuit dans des dépôts militaires des environs. De ce fait, nos journées étaient libres. Pour chaque garde, nous étions six hommes sous la conduite d’un sous-officier.
On sentait que l’orgueilleuse Wehrmacht de jadis commençait à se décomposer. La guerre durait depuis trop longtemps. Durant certains de ces tours de garde, il se passait des choses pas très militaires. Des femmes ou des filles venaient nous tenir compagnie une partie de la nuit sur les bat-flancs du poste, offrant leurs charmes, pour quelques marks, à qui voulait en profiter. Le sous-off lui-même participait à ce sport. Parmi les gars, certains étaient pourtant mariés... mais à la guerre comme à la guerre !
Dans la compagnie j’ai fait la connaissance d’un autre Lorrain, René Huhn de Thionville et de plusieurs Alsaciens. Ensemble, nous sommes sortis un dimanche à Warnemünde, sur la Baltique qui n’était qu’à quelques kilomètres, bordée par l’Allemagne, par la Norvège occupée par les Allemands et par la Suède, pays neutre. Cette proximité vers la liberté a fait marcher mes méninges !
Le dimanche suivant, je suis sorti en ville avec un sous-officier alsacien. Il provenait d’une classe plus âgée, il avait déjà servi dans l’armée française et son grade de ce fait fut homologué dans la Wehrmacht. Prudemment nous nous sommes tâtés l’un l’autre et très vite nous avons constaté que nous étions du même bord, idéologiquement parlant. Dans le bistrot où nous nous sommes installés, le garçon parlait un drôle d’allemand qui sentait l’accent français. Nous lui avons parlé dans la langue de Voltaire. Il était sidéré devant deux soldats allemands parlant français. On s’est expliqué. C’était un ex-prisonnier de 1940 qui, pour sortir du camp, avait accepté de devenir Freiarbeiter, travailleur libre. Là aussi, il a fallu user de diplomatie pour sonder le gars. Mis en confiance, nous lui avons demandé s’il n’existait pas de filière qui faisait évader des prisonniers par la Baltique vers la Suède. Il nous a avoué que c’était possible mais qu’il devait prendre contact avec l’organisation clandestine qui, de Berlin ! gérait ce trafic. Nous nous sommes portés tous les deux candidats. On devait le re-contacter deux dimanches plus tard. Malheureusement, notre partance pour le front, décidée inopinément entre temps, devait faire avorter cette tentative alléchante.
Certains de ces départs avaient déjà eu lieu auparavant, mais nous n’en faisions pas partie, pour la bonne raison qu’ils s’effectuaient vers le front de l’Ouest et les directives de l’O.K.W. (Oberkommando der Wehrmacht = Grand Quartier Général) étaient formelles : pas d’Alsaciens-Lorrains-Luxembourgeois sur le front Ouest !
Ils savaient pourquoi !
Subitement, le 20 juillet, je fus transféré à Gustrow, à quelques kilomètres de Rostock. Il y régnait une curieuse atmosphère. On sentait qu’il y avait quelque chose de bizarre en l’air. Le soir de ce 20 juillet, il y eut un appel exceptionnel. Au garde-à-vous, nous apprîmes la nouvelle de l’attentat contre Hitler : Eine kleine Klique von Offizieren... On nous apprit que le Führer était sain et sauf et on nous fit entendre par haut-parleur son discours au peuple allemand, dans lequel il cracha toute sa haine contre « cette petite clique d’officiers sans scrupules. »
On nous fit part qu’à partir de ce jour, le salut militaire était remplacé par le salut hitlérien, que nous étions autorisés à abattre sur place, tout défaitiste, fût-il officier.
J’appris plus tard, que dans une unité cantonnée en Italie, un Alsacien, Jean-Pierre Zimmermann de Karspach, entendant que Hitler avait échappé à cet attentat, avait dit devant d’autres, ce seul mot : « Schade ! Dommage ! » Dénoncé, il fut traduit en cours martiale, condamné à mort et pendu aussitôt. Son père fut torturé par la Gestapo parce qu’il avait pleuré en recevant l’avis de décès. (Henry Allainmat et Betty Truck reproduisent dans leur livre La nuit des parias- Presses de la Cité-, le fac-similé de la lettre du tribunal militaire aux parents- page 256).
« Hitler nix gut, Stalin nix gut » disait la petite matka d’Ukraine en 1943 !
Avant de quitter Rostock, j’avais encore reçu une lettre de mes parents datée du 15 juillet. Ce fut la dernière que je reçus d’eux à la Wehrmacht. J’allais rester sans nouvelles de leur part jusqu’au 30 juillet 1945, plus d’un an plus tard, à mon retour du camp russe.
Campagne en Lituanie et en Prusse-Orientale (hiver 1944 -1945)
Le 22 juillet 1944, nous quittâmes Gustrow pour une destination inconnue, mais nous nous doutions bien que c’était pour le front qui ne pouvait être à nouveau que celui de l’Est, l’Ostfront ! bien qu’on nous ait un moment laissé croire que c’était pour le Danemark.
Nous avions été équipés tout de neuf la veille. Dès le 23, nous débarquâmes à Dirschau, non loin de Danzig. A pied nous gagnâmes un petit village à 4 km de là, Baldau sur la Vistule. On logeait dans des granges et des fenils où il faisait une chaleur étouffante.
Les gars qui étaient avec moi venaient de toutes sortes d’unités, qui comme la mienne avaient combattu en Russie et qui avaient été décimées. Avec ce ramassis, on forma une nouvelle division, la 549. Volksgrenadier Division. Je fus affecté au Volksgrenadier Regiment 1099, à la 13ème Compagnie, c’est-à-dire à l’Infanterie Geschütz Kompanie, arme dans laquelle j’avais fait mes classes à Gnesen. Mais cette fois nous fûmes dotés de pièces d’un modèle nouveau, à tube long, alors que j’avais fait mes classes avec le modèle à tube court
En quelques jours, on nous familiarisa avec ces nouveaux canons. Dans ma compagnie, figuraient un Lorrain, de Hagondange, Robert Rémy, et un Alsacien de Guebwiller, Joseph Barlier.
De temps à autre, on nous emmenait nous baigner dans la Vistule. Quand tout était calme, on entendait un grondement sourd au loin, signe que le front se rapprochait. Le 10 août nous quittâmes Dirschau par le train et nous parvînmes à Eydtkau, à la frontière de la Lituanie. Pour rejoindre le front, il n’y eut plus cette fois de longs trajets à effectuer puisque les Russes venaient à notre rencontre !
Dès le 13 au soir nous montâmes en ligne. Quand on connaît la musique pour l’avoir vécue en Ukraine, c’est une sale impression de se retrouver dans la mouise. Tout de suite, nous découvrîmes que le secteur était loin d’être calme. Orgues-de-Staline, tirs d’artillerie, chasseurs-bombardiers nous souhaitèrent la bienvenue.
Les populations civiles avaient été évacuées ou avaient fui. Notre position se situait dans la région Schaki-Sintautai, encore en Lituanie, à quelques dizaines de kilomètres de Kovno (ou Kaunas) en Lituanie.
Le 15 août, jour de l’Assomption, j’écrivis à mes parents. Ce sera la dernière lettre qu’ils auront de moi puisque pour eux la libération par les troupes américaines aura lieu en septembre. Alors qu’ils sont à nouveau Français à part entière, je combattrai encore sept mois avec la Wehrmacht, jusqu’au 26 mars 1945 et resterai encore quatre mois dans les camps soviétiques avant de les retrouver le 30 juillet 1945. Ils resteront un an sans nouvelles de moi, ce qui fut mon cas aussi les concernant. Cette absence de nouvelles de part et d’autre nous fut à tous très éprouvante.
Nous souffrions beaucoup de la chaleur et de la soif. Chaque ferme avait bien son puits, mais en partant la population y avait jeté des cadavres et des carcasses d’animaux, rendant l’eau impropre à la consommation. Nous devions nous contenter pour toute la journée du bidon de café-ersatz qui nous arrivait chaque soir avec le ravitaillement. Nous subissions de violentes attaques russes mais qui n’arrivaient pas à nous déloger de nos positions. Les premiers blessés furent ramenés vers l’arrière. Ceux qui n’étaient pas trop méchamment touchés avaient de la chance. Pour quelques semaines, voire quelques mois, les voilà sortis de la mélasse.
Fin août, nous changeâmes de secteur. Nous prîmes position près de Ciciuniai, le long de la ligne de chemin de fer Kaunas-Koenigsberg, à l’est d’Eydtkau, mais toujours encore en Lituanie. Devant nous, se profilait la ville de Wilkowischki. Il nous arrivait de tirer sur la gare de cette localité où les Russes amenaient du renfort.
Contre toute attente, le coin s’avéra néanmoins beaucoup plus calme que prévu, malgré des tirs sporadiques de katioucha et de ratchboum. On appelle ainsi un canon russe de 77, à tir rasant, dont le bruit de départ se confond illico avec le bruit de l’impact.
Je fus désigné comme estafette auprès du P.C. du bataillon qui se trouvait à un kilomètre devant nous. Je n’y passai qu’une seule nuit. Le lendemain, un accident se produisit à l’une des pièces. A sa sortie du tube, l’obus, ayant éclaté, tua le chef de pièce, un sous-off sudète, et blessa grièvement le pointeur qui fut évacué. Des accidents de ce genre arrivaient de temps à autre. A cette époque, les usines d’armement d’Allemagne utilisaient beaucoup de main-d’oeuvre étrangère. Malgré la surveillance très sévère, certains ouvriers faisaient du sabotage. C’était très risqué pour eux, car la caisse de munitions d’où sortaient ces obus sabotés retournait à l’usine et les références inscrites sur la caisse permettaient de repérer l’équipe qui avait conditionné ces munitions.
Dans ma section on s’est souvenu que j’avais été formé comme Richtschütze (pointeur) et on m’y rappela. J’allais rester pointeur durant toute cette campagne, du moins tant que nous disposâmes encore de nos pièces. C’est à cette époque que je fus promu (!) Gefreiter, caporal, à l’ancienneté.
C’est à Ciciuniai qu’est tombé le copain lorrain de Hagondange, le 1er septembre. Sa pauvre maman viendra me trouver au Grand Séminaire de Metz en 1946, où j’ai dû lui confirmer la triste nouvelle. Comme il avait été porté disparu, elle espérait toujours le voir réapparaître, comme tant d’autres familles lorraines qui crurent longtemps encore au retour possible de leurs êtres chers disparus.
 Au début, nous n’avions que des trous individuels pour nous abriter. C’est là que nous cassions la croûte, que nous dormions, que nous nous mettions à l’abri en cas de tirs d’artillerie. A moins d’un malheureux coup au but, nous y étions relativement en sécurité. Les tirs au fusil ou à la mitrailleuse nous arrivaient aussi, mais à cette distance, ils étaient imprécis et donc moins dangereux. Comme la position semblait stable et que nous pûmes y durer un certain temps, nous avons construit des bunkers. Il s’agissait de trous de 3 mètres sur 3 environ, profonds de 2. En guise de couverture, nous disposâmes sur notre abri des troncs d’arbres superposés en deux couches, des poteaux téléphoniques sciés dans les environs et même des poutres récupérées sur le toit d’une maison édifiée à proximité. Le tout était recouvert avec la terre retirée du trou. A l’intérieur quelques lits superposés. Nous pouvions y loger à six. Quand il a commencé à faire froid, nous avons construit un petit fourneau fait de briques récupérées dans les murs d’une maison. La vie y était moins triste car nous étions ensemble. A Ciciuniai nous avons pu rester quelques semaines, puisque le front s’y était stabilisé. Le terrain était tourbeux et donc très humide. Dans un angle du bunker, nous avons creusé un trou hors duquel nous retirions tous les matins un ou deux seaux d’eau qui s’y était accumulée durant la nuit.
Au début, nous n’avions que des trous individuels pour nous abriter. C’est là que nous cassions la croûte, que nous dormions, que nous nous mettions à l’abri en cas de tirs d’artillerie. A moins d’un malheureux coup au but, nous y étions relativement en sécurité. Les tirs au fusil ou à la mitrailleuse nous arrivaient aussi, mais à cette distance, ils étaient imprécis et donc moins dangereux. Comme la position semblait stable et que nous pûmes y durer un certain temps, nous avons construit des bunkers. Il s’agissait de trous de 3 mètres sur 3 environ, profonds de 2. En guise de couverture, nous disposâmes sur notre abri des troncs d’arbres superposés en deux couches, des poteaux téléphoniques sciés dans les environs et même des poutres récupérées sur le toit d’une maison édifiée à proximité. Le tout était recouvert avec la terre retirée du trou. A l’intérieur quelques lits superposés. Nous pouvions y loger à six. Quand il a commencé à faire froid, nous avons construit un petit fourneau fait de briques récupérées dans les murs d’une maison. La vie y était moins triste car nous étions ensemble. A Ciciuniai nous avons pu rester quelques semaines, puisque le front s’y était stabilisé. Le terrain était tourbeux et donc très humide. Dans un angle du bunker, nous avons creusé un trou hors duquel nous retirions tous les matins un ou deux seaux d’eau qui s’y était accumulée durant la nuit.
Pas besoin de se demander d’où viennent les rhumatismes 60 ans plus tard ! A l’époque, j’avais 20 ans et je n’ai pas eu un rhume. Heureusement ! Nous n’avions pas de poux comme en Ukraine... mais par contre des puces.
Lors d’un moment calme dans la journée, on se déshabillait complètement dans la nature -les Russes n’avaient pas vue sur la position -, on secouait énergiquement le tout et on courait dix mètres plus loin pour se rhabiller. C’était efficace, mais il fallait recommencer l’opération assez souvent. Evidemment, comme on gardait par ailleurs l’uniforme jour et nuit et cela pendant des mois, la toilette corporelle était réduite au minimum.
Je ne sais plus comment nous avons fait pour garder la notion du temps et savoir quel jour et quelle date on était. Quand nous avons construit ce bunker, je suis allé avec un copain abattre des arbres dans les environs. Il a eu la jambe broyée par la chute d’un arbre. Heureuse blessure qui l’a fait évacuer en Allemagne pour un bon moment. Chacun rêvait d’un bon Heimatschuss pas trop méchant mais suffisant pour être rapatrié.
La nuit, il fallait monter la garde, toujours en duo et pendant deux heures. Les heures les plus pénibles étaient celles du milieu de la nuit. Le sommeil se trouvait toujours morcelé. Il fallait ouvrir les yeux et les oreilles, car des patrouilles russes rôdaient parfois par là. Ce n’était pas toujours rassurant dans la nuit noire.
Le ravitaillement était encore à cette époque-là convenable. Il nous parvenait tous les soirs par la Feldküche, la roulante. Pas question de circuler de jour. On s’attirait immanquablement une rasade de Granatwerfer ou de Bumser (lance-grenades) dont les Russes étaient largement pourvus.
De temps à autre, nous percevions de la Marketenderware, des articles de cantine (chocolat, schnaps, bonbons, cigarettes, peigne, savon à barbe, brosse à dents) et même des Pariser, des préservatifs ! Ils ne pouvaient ici être d’aucune utilité, dans cet enfer d’hommes. Nous nous amusions à les gonfler comme des ballons de foire.
En Ukraine, nous touchions aussi ces articles. Là non plus, ils ne servaient pas, mais pour d’autres raisons. Bien que la population civile soit restée là-bas sur place, les panienka (filles) ukrainiennes étaient trop fières pour répondre à d’éventuelles avances. De plus, leur hygiène était plutôt douteuse, ironisaient certains troufions.
Début octobre, on entendait toutes les nuits des bruits de moteur chez les copains d’en face. Cela ne présageait rien de bon et on se demandait anxieusement : « Quand et où vont-ils frapper ? »
Les jours précédant une offensive qu’on devinait proche, étaient toujours éprouvants et stressants.
Le 16 octobre, alors qu’il faisait encore nuit, eut lieu le lever de rideau. Un Trommelfeuer, un feu roulant d’une puissance inouïe s’abattit sur tout le secteur sur une largeur de 10 à 15 km et une profondeur de 5. Des dizaines de milliers de pièces de tous calibres labourèrent littéralement le terrain. Pas un mètre carré qui ne fût pas touché. C’était un véritable hachoir. Quand ce feu roulant commençait, on avait un noeud au creux de l’estomac.
Puis peu à peu la peur disparaissait. On était saisi par une espèce d’ivresse due au bruit infernal et à la poudre qui formait comme un brouillard. On avait l’impression d’être sur un bateau qui tanguait. Cela durait plusieurs heures au bout desquelles on devenait sourd. On n’entendait alors plus qu’un vague bruit de fond. Nous ne restâmes pas inactifs. Selon un plan de tir préétabli, nos pièces entrèrent, elles aussi, en action. Elles envoyèrent des milliers d’obus sur les positions russes. Les douilles vides s’amoncelaient autour de chaque canon. Vers midi le secteur devint plus calme. Dans l’après-midi on continua à tirer de part et d’autre mais à un rythme moins soutenu. Nous nous attendions d’un moment à l’autre à voir surgir l’infanterie ou les chars russes. Mais rien ne vint. Comme les communications avec les unités voisines étaient rompues, nous ne savions pas ce qui se passait chez eux. Pour l’instant, j’étais encore vivant et indemne. C’est tout ce qui comptait
J’ai eu à subir plusieurs fois les ravages de ces Trommelfeuer démentiels. On ne comprend pas qu’on puisse survivre à de tels déluges de feu. Plus de six décennies après, je ne m’explique toujours pas ma chance.
Une fois la nuit tombée, les tirs ont cessé. A notre grand étonnement, nous avons aperçu des fusées éclairantes, loin derrière nous, sur notre gauche. Les Russes avaient réussi leur percée le long de la ligne de chemin de fer Kaunas-Koenigsberg et avaient enfoncé le front sur notre gauche, sur une profondeur de 10 km. Comme nous devions l’apprendre dans la suite, ils en avaient fait autant sur notre droite. Dans notre secteur restreint, ils n’avaient pas bougé. Ils n’avaient plus qu’à fermer l’étau derrière nous et nous étions pris dans le chaudron.
Nos chefs ont ordonné le repli qui s’est effectué dans des couloirs bien délimités, car tout le terrain devant nous avait été miné pour former une barrière en cas d’attaque russe. On nous dirigea vers Wirballen à 10 km de là. Lorsque nous ne fûmes plus qu’à une courte distance de cette ville, elle subit sous nos yeux un bombardement aérien d’un genre particulier, du jamais vu. A une centaine de mètres d’altitude, les bombes explosaient et faisaient tomber une pluie de feu sur la ville. C’étaient des bombes au phosphore. Des centaines de ces cônes de feu s’abattirent sur elle. Vu de loin et dans la nuit, le spectacle était grandiose. Je n’ai jamais vu de feu d’artifice aussi impressionnant. Sous l’effet de ces flammes tombant du ciel, toute la localité s’est embrasée. Nous allions en subir les conséquences, car il nous fallut traverser Wirballen de bout en bout, pour échapper à l’encerclement. J’en garde un souvenir hallucinant. Une nuit d’enfer ! De chaque côté des rues que nous longions, les maisons brûlaient et s’effondraient. Passant près d’une fontaine installée sur une place, nous nous sommes mouillé les uniformes, avons trempé le mouchoir pour le mettre devant le visage et nous protéger quelque peu du feu et de la chaleur émanant de ce brasier.
Nos pièces étaient tractées par des chevaux. On sait que le cheval ne craint rien davantage que le feu. Il fallait tenir les chevaux à plusieurs pour qu’ils avancent sans s’emballer. Avec des chiffons mouillés, nous leur avons masqué les yeux. C’était dantesque !
Au lever du jour, nous approchâmes d’Eydtkau. Dans la brume matinale d’octobre, nous avons discerné sur notre droite d’autres colonnes qui convergeaient vers cette ville. C’étaient les Russes ! Ils atteignaient pour la première fois le sol allemand, en ce 17 octobre 1944.
 Des combats se déroulèrent dans Eydtkau ce jour-là, avant que les Russes ne s’en rendissent maîtres le lendemain. Les redoutables Schlachtflieger, chasseurs-bombardiers munis de lance-roquettes, volant à faible altitude, mitraillaient, bombardaient, roquettaient tout ce qui bougeait.
Des combats se déroulèrent dans Eydtkau ce jour-là, avant que les Russes ne s’en rendissent maîtres le lendemain. Les redoutables Schlachtflieger, chasseurs-bombardiers munis de lance-roquettes, volant à faible altitude, mitraillaient, bombardaient, roquettaient tout ce qui bougeait.
Ce fut une véritable boucherie. Tout au long de la journée –pourtant une journée radieuse -, ils se relayèrent pour ce travail. Ils volaient si bas que nous pouvions distinguer les pilotes. Ce fut très dur. On n’en menait pas large. Pas de ravitaillement en vue et nous allions passer une deuxième nuit sans sommeil. Dans la nuit, nous décrochâmes vers Nickelsfelde, puis le jour suivant vers Bilderweiten, toujours harcelés par les Russes qui poursuivaient leur offensive. Le 19, un front quelque peu stabilisé a contenu l’avance russe à Krähenwalde. Mais continuellement nous avons encore dû céder du terrain.
Avec cette offensive, les Russes pénétraient pour la première fois sur le territoire du Reich. Sur notre droite, ils poussèrent jusqu’à Nemmersdorf d’où ils furent délogés par la suite. Quand les Allemands reprirent ce secteur, ils découvrirent la sauvagerie des troupes russes. Toutes les femmes du village, religieuses comprises, avaient été violées. Puis, toute la population qui n’avait pas pu fuir, femmes, enfants et vieillards, fut massacrée, au couteau, à la grenade, à la mitraillette. Parmi eux, des prisonniers français. On retrouva une femme clouée nue sur une porte de grange. Les Allemands s’empressèrent de faire venir la presse neutre (Suisse, Suède, Espagne) sur les lieux pour dénoncer la bestialité des hordes bolcheviques. Le Courrier de Genève rapporta ces faits monstrueux le 7 novembre 1944. L’écrivain soviétique Lev Kopelev, officier de 1’Armée Rouge, en campagne en Prusse-Orientale a confirmé des faits semblables perpétrés par ses hommes, de même que Soljenitsyne, lui aussi, officier en Prusse-Orientale. Nous étions à l’époque au courant de ces crimes. Cela ne pouvait pas nous inciter à vouloir passer de l’autre côté.
Début novembre, l’offensive russe s’essouffla et le front se figea à nouveau en guerre de position pour plus de deux mois. Nous prîmes position près de Mildenheim-Rosslinde à quelques kilomètres d’Ebenrode, ville de Prusse qui était maintenant passée aux mains des Russes. Le froid et l’humidité de novembre commencèrent à se faire sentir. Nous nous enterrâmes dans des trous individuels. C’était bien triste sous la pluie. J’y reçus par retour de courrier toutes mes lettres que j’avais envoyées à la maison depuis le 15 août : la communication avec ma famille était définitivement coupée. Désormais nous ne saurions plus rien les uns des autres. Le cafard était grand. Heureusement que je ne sus pas d’avance que cette séparation douloureuse durerait 9 mois.
Un nouvel accident se produisit à l’une de nos pièces par suite de l’éclatement d’un obus à la sortie du tube. Il n’y eut heureusement pas de blessés. Depuis le premier accident en Lituanie, nous nous accroupissions à chaque tir. Cette fois, un éclat déchira la capote du pointeur à hauteur de son dos, l’éraflant simplement. S’il était resté debout, il l’aurait reçu en pleine poitrine. A quoi tient parfois la vie ?
Histoire d’entretenir avec des breloques le moral de la troupe, toute notre compagnie fut décorée du Sturm Abzeichen in Silber, la médaille d’assaut en argent. Quand nous avons deviné que le front allait de nouveau se stabiliser là, au moins pour un temps, nous avons aménagé des bunkers. Nous y étions au moins à l’abri de la pluie et dans une sécurité relative quant à la pluie de ferraille. Sans parler de l’hiver qui approchait. Pour couvrir notre bunker, nous avons démoli le toit d’une maison toute proche et récupéré les poutres. De toutes façons, il nous paraissait évident que le propriétaire n’y reviendrait plus jamais et qu’après nous, les Russes n’auraient qu’à se débrouiller. A la guerre, comme à la guerre...
Le secteur se calma peu à peu. Quelques tirs par jour de notre part sur des cibles reconnues, la même chose de la part des Russes. Par contre beaucoup de tirs de mortiers ennemis pleuvaient sur nous. Ils n’étaient pas appréciés car ces obus tombaient presque à la verticale.
La nuit, c’était la garde. On ne dormait jamais plus de quatre heures d’affilée. Chaque nuit, il y avait les passages de l’U.V.D. le sous-officier de ronde ou le vol de la Nähmaschine, la machine-à-coudre comme nous l’appelions. C’était un petit appareil russe d’observation, très lent, pétaradant comme une pétrolette. De temps à autre, sans cible précise, le pilote lançait une bombe... ou aussi une grosse pierre. Son but : nous agacer et nous énerver.
Entre temps l’hiver s’était installé. Il devait être rude cette année-là. La neige tombée avait transformé le paysage mais aussi nos conditions de vie... ou de survie. Les heures de garde de nuit, en particulier, par -20°C, devinrent éprouvantes. Contrairement pourtant à l’hiver précédent en Ukraine, nous avions touché ici un équipement plus chaud : un passe-montagne sous le casque et pour le visage, des gants épais ainsi que des survêtements à enfiler par dessus l’uniforme, ce qui rendait les mouvements plus difficiles. Les nouveaux habits étaient fourrés et réversibles : blanc pour circuler dans la neige et tenue de camouflage de l’autre côté. Les bottes de cuir avaient été remplacées par de grosses bottes de feutre épais. Le ravitaillement était correct mais ce qui me manquait le plus, c’était le courrier. De ce côté-là, il n’y avait pourtant rien à espérer. A l’approche de Noël, trois gars de ma section, originaires de Pommern me firent envoyer des paquets par leurs familles, car j’étais coupé de la Moselle. C’était drôlement sympathique de la part de ces Poméraniens. Il faut admettre qu’au front régnait une vraie camaraderie. Le danger continuel auquel nous étions exposés nous rapprochait les uns des autres. Les quelques Alsaciens-Lorrains que nous étions encore n’ont jamais été mis de côté ni traités en suspects, du moins pas au niveau des hommes de troupe.
Pour Noël, le chef de compagnie a fait venir l’Alsacien et moi dans son bunker et nous a gratifiés d’un paquet spécial de la compagnie, contenant de délicieuses gâteries. C’était l’époque de l’offensive allemande de von Runstedt dans les Ardennes. En nous congédiant, notre Oberleutnant, pensant nous réconforter, nous dit : « Bald ist eure Heimat wieder frei. Bientôt votre région sera de nouveau libérée. » Une fois dehors, nous nous sommes dit l’un à l’autre : « Notre Heimat est désormais vraiment libérée et elle le restera ! »
Dans notre bunker, nous avons essayé d’oublier quelque peu le cafard en faisant la fête. Les gâteries ne manquaient pas ni le schnaps ni la bière. Un des jours après Noël, des aumôniers militaires ont organisé une messe pour le régiment à l’église de Kattenau, un village à l’arrière du front. De chaque section, quelques volontaires ont pu s’y rendre. J’en étais. L’église était bondée. Avant la communion, les aumôniers nous ont donné l’absolution générale. Comme beaucoup n’avançaient pas pour recevoir la communion, ils nous ont presque forcés en clamant : « Vos péchés sont pardonnés par l’absolution générale. » A l’époque, on n’osait pas encore aller communier sans devoir passer impérativement par la confession individuelle.
Le 31 décembre 1944, à 22 heures, les Russes nous ont offert un beau feu d’artifice. Toute la ligne du front s’est illuminée de leur côté par des tirs en l’air, au fusil, à la mitraillette ou à la mitrailleuse, avec des balles traçantes. Ils fêtaient déjà d’avance la victoire qui leur semblait proche désormais.
A minuit, (il y avait un décalage horaire de deux heures entre les Russes et nous), nous leur avons rendu la politesse mais par des tirs très clairsemés. Chez nous, les munitions étaient devenus une denrée rare.
Début janvier, pendant plusieurs jours, de grosses valises russes passèrent au-dessus de nos têtes. Elles étaient destinées à démolir notre artillerie installée derrière nous. Ces tirs annonçaient que quelque chose était en préparation. L’assaut final sur le Reich et vers Berlin était dans les cartons de l’Etat-major de l’Armée Rouge.
La nuit, les bruits de moteur en face nous le confirmaient. Pour nous, c’était à nouveau la peur au ventre : c’est pour quand ? Demain ? Dans deux jours ? Dans une semaine ? Heureusement que nous ne savions pas ce qui nous attendait. Pour nous, la guerre se résumait à notre petit secteur, avec les évènements quotidiens qu’on y vivait. Nous n’avions aucune vue d’ensemble.
Depuis, à travers les lectures que j’ai pu faire, j’ai appris bien des choses que nous ignorions à l’époque, nous qui n’étions qu’un tout petit maillon dans la stratégie des états-majors.
L’offensive que montaient les Russes constituait le dernier coup de boutoir qui devait régler définitivement le sort de la Wehrmacht et les amener à Berlin. Ils y mirent le paquet. Leur puissance de frappe accumulée était phénoménale, leur supériorité matérielle écrasante. Et malgré cela, il leur faudra encore quatre mois pour venir à bout du Reich. L’offensive projetée couvrait un front qui allait de la Baltique à Varsovie. Le rapport des forces en leur faveur était de 1 à 11 pour l’infanterie, de 1 à 7 pour les chars et de 1 à 20 pour l’artillerie. Dans le ciel, la maîtrise de leur aviation était absolue. Durant les trois mois qui suivront, nous ne verrons que très rarement l’intervention de la Luftwaffe. Nos seuls alliés sous ce rapport-là étaient le brouillard ou les chutes de neige.
Mathématiquement parlant, si les Russes avaient placé leur artillerie sur une ligne continue allant de Varsovie à la Baltique, c.à.d. sur le front qu’ils voulaient faire éclater, un calcul rapide aurait donné un canon ennemi tous les mètres, c’est dire que ce qui allait nous tomber dessus serait terrible !
Le 12 janvier 1945, déclenchement de l’offensive soviétique sur la Vistule.
L’Armée Rouge va anéantir ou isoler en Prusse-Orientale et en Poméranie l’équivalent de trente-cinq divisions allemandes. A ce bilan catastrophique, viennent s’ajouter trente autres divisions du Heeresgruppe Nord (Heinrich von Vietinghoff) encerclées dans une autre poche dans les Pays Baltes et en Courlande, par les 2ème et 3ème Fronts de la Baltique (Ieremenko et Maslenikov). Ce groupe d’armées est d’ailleurs rebaptisé Heeresgruppe Kurland.
25 janvier 1945, Secteur Nord.
La situation des forces allemandes isolées en Prusse-Orientale est de plus en plus critique. C’est tout le Heeresgruppe (Groupe d’Armées) Centre, ou plutôt de ce qu’il en reste, qui se retrouve encerclé par le 2ème Front de Biélorussie (Rokossovski) d’un côté et le 3ème front de Biélorussie (Tcherniakovski) de l’autre. Adolf Hitler remanie en profondeur sa chaîne de commandement, limoge toute une série de généraux et d’officiers supérieurs. Le général Georg-Hans Reinhardt, commandant le Heeresgruppe Centre qui défendait la Prusse-Orientale, est destitué. Le Führer lui avait catégoriquement refusé l’autorisation de retirer ses forces dans la zone des lacs de Mazurie. Il est remplacé par le maréchal Ferdinand Schörner, une terreur !
Le 13 janvier, vers 7 heures, le jour n’était pas encore levé, nous avons été réveillés dans le bunker par un bruit de tous les diables. L’offensive tant redoutée venait d’être enclenchée par un Trommelfeuer (feu roulant) de l’artillerie russe de tous calibres accompagnés de tirs de mortiers.
Nous nous sommes précipités dehors vers nos pièces qui se trouvaient à une centaine de mètres derrière le bunker. Quelques-uns d’entre nous restèrent à l’intérieur des bunkers. Ils devaient, à la fin du feu roulant, nous couvrir avec leurs fusils et une mitrailleuse en cas d’attaque de l’infanterie russe.
Il faisait très froid et brumeux, ce qui par chance empêcha l’aviation adverse d’entrer action. La neige recouvrait le sol fortement gelé. Ce que nous avions vécu le 16 octobre en Lituanie se renouvela mais avec une intensité accrue. Les obus pleuvaient littéralement. On s’est fait très petit derrière nos pièces qui nous offraient une très relative protection. A quelques mètres devant nous, j’ai vu un obus de gros calibre frapper le sol gelé et tournoyer comme une toupie. Le Blindgänger n’éclata pas. Ce fut notre chance.
Nous avons riposté avec nos pièces mais leurs effets ravageurs ne calmèrent pas pour autant l’ardeur des artilleurs d’en face. Nos salves à répétitions s’ajoutèrent simplement au bruit assourdissant que nous subissions. Le martèlement dura quatre heures. Subitement, nous vîmes les premiers Russes s’approcher de notre bunker et y jeter des grenades à main. L’un des nôtres s’échappa hors d’un bunker pour courir vers nous, mais une rafale l’abattit. Instinctivement, je baissai le tube du canon et à travers le tube, je visai le groupe qui s’avançait vers nous, avant que le chargeur n’y enfournât un obus. Je n’ai pas regardé l’impact qui se situait à peine cent mètres devant nous. Nous avons répété plusieurs fois l’opération. L’Autrichien qui chargeait les obus me cria : « Mittendrin. En plein dans le mille. » Je n’ai pas regardé dans cette direction mais j’ai vu, sur notre droite, à 50 mètres d’autres Russes arriver. La partie était perdue pour nous. Il ne nous restait qu’une seule solution : prendre la poudre d’escampette. Chacun a saisi son fusil et sauve-qui-peut. Les pièces restèrent sur place. Les Russes n’avaient plus qu’à les retourner contre nous. Les munitions étaient là. Je ne sais plus si j’ai encore enlevé le percuteur comme le voulait le règlement. Le terrain montait légèrement et nous avons peiné, courant de toutes nos jambes et zigzaguant, pour ne pas fournir une cible trop facile à l’infanterie russe qui nous canardait. Arrivés en haut de la colline, près du village de Kattenau, le chef de compagnie a rassemblé son monde et nous a fait occuper une tranchée qu’il a fallu d’abord dégager de la neige.

 Durant l’automne 1944, la population avait été contrainte par le Parti, à creuser beaucoup de ces tranchées ainsi que des fossés anti-chars dans toute la zone frontalière. Nous n’avions que nos fusils et peu de munitions. Nous avons tout de même réussi à stopper les Popofs au pied de la colline. J’ai toujours visé leurs jambes. Cela ne tue pas et ça suffisait pour les empêcher d’avancer : leur blessure leur promettait un retour vers l’arrière, et donc la fin de la guerre pour eux. Nous avons tenu cette position jusqu’à la nuit, puis nous nous sommes repliés. Notre division a subi de lourdes pertes ce jour-là. Le front a craqué de toutes parts et ce fut le commencement d’un recul qui ne devait s’arrêter, pour les survivants, que sur les bords de la Baltique à 200 km de là.
Durant l’automne 1944, la population avait été contrainte par le Parti, à creuser beaucoup de ces tranchées ainsi que des fossés anti-chars dans toute la zone frontalière. Nous n’avions que nos fusils et peu de munitions. Nous avons tout de même réussi à stopper les Popofs au pied de la colline. J’ai toujours visé leurs jambes. Cela ne tue pas et ça suffisait pour les empêcher d’avancer : leur blessure leur promettait un retour vers l’arrière, et donc la fin de la guerre pour eux. Nous avons tenu cette position jusqu’à la nuit, puis nous nous sommes repliés. Notre division a subi de lourdes pertes ce jour-là. Le front a craqué de toutes parts et ce fut le commencement d’un recul qui ne devait s’arrêter, pour les survivants, que sur les bords de la Baltique à 200 km de là.
Durant les semaines qui allaient suivre, le scénario quotidien fut à peu près toujours le même. De jour, établis en position, exposés au tir des mortiers et soumis par beau temps aux roquettes et aux bombes des chasseurs-bombardiers, nous faisions face à la poussée irrésistible des Russes. De nuit nous retraitions de quelques kilomètres sur une nouvelle position, par des froids de -20°C. Cela comportait aussi un avantage : nous pouvions traverser les cours d’eau sur la glace, quand les ponts avaient sauté.
Très peu de sommeil. Un ravitaillement qui arrivait au compte-gouttes, presque toujours froid. La fatigue, n’en parlons pas. Quand le jour se levait on se demandait : « Serai-je encore en vie ce soir ? » Impuissance devant l’énorme supériorité matérielle des Russes qui puisaient dans des réserves inépuisables. Chez nous, on manquait de tout. Même les munitions étaient rationnées. On sentait la fin et pourtant il fallait continuer à marcher, à se battre, à souffrir, sans autre issue que la mort ou la captivité.
Les pertes augmentaient chaque jour. Un copain par ci, un copain par là. Ton tour, c’est pour quand ?
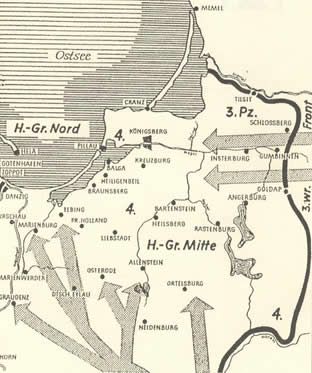 Partout les populations civiles essayaient de fuir, car elles savaient qu’elles n’avaient rien de bon à attendre des Soviets. C’étaient surtout des femmes, des enfants et des vieillards. A pied ou en charrettes attelées, elles erraient, dans le plus grand désordre. Il n’y avait pas d’évacuation méthodiquement organisée. Ils formaient des trecks dans lesquels les chars et l’aviation russes provoquaient des bains de sang. Il y avait des cadavres partout. Personne ne se souciait plus de les enterrer. D’ailleurs, le sol était profondément gelé. Une vision de fin de monde !
Partout les populations civiles essayaient de fuir, car elles savaient qu’elles n’avaient rien de bon à attendre des Soviets. C’étaient surtout des femmes, des enfants et des vieillards. A pied ou en charrettes attelées, elles erraient, dans le plus grand désordre. Il n’y avait pas d’évacuation méthodiquement organisée. Ils formaient des trecks dans lesquels les chars et l’aviation russes provoquaient des bains de sang. Il y avait des cadavres partout. Personne ne se souciait plus de les enterrer. D’ailleurs, le sol était profondément gelé. Une vision de fin de monde !
La direction générale du repli, c’était l’ouest, avec le secret espoir d’arriver ainsi au centre de l’Allemagne.
J’ai gardé en mémoire le nom de quelques positions éphémères que nous avons tenues : Tutschen, Roseneck, Springen, Luisenberg, Insterburg, Dittlacken, Allenburg Pilgrim, Dringheim, Uderwangen. Entre Dringheim et Uderwangen, les Russes nous rattrapèrent avec leurs chars. Ils roulaient parallèlement à la route où s’entremêlaient unités militaires en déroute et colonnes de réfugiés. Ils s’en donnèrent à cœur joie et tirèrent dans cette cohue en faisant des ravages. C’était le sauve-qui-peut général. Les chevaux s’emballaient. Des familles furent séparées. Des morts, des blessés qu’on ne pouvait plus emmener. Parmi eux des enfants. Cris et hurlements. Insoutenable. La course avec la mort ! Je m’en sortis encore une fois indemne. Nous ne formions plus qu’une petite section. Le contact avec le reste de la compagnie et le régiment s’était perdu dans cette fuite éperdue.
Entretemps, venant du sud, de Varsovie, les Russes, dans un grand mouvement enveloppant avaient poussé jusqu’à Tolkemit, près d’Elbing, sur la Baltique. Nous étions donc dans la souricière. La Prusse-Orientale était définitivement coupée du reste du front et tout espoir de rejoindre l’Allemagne s’était évanoui. Nous étions dans un immense chaudron que les Russes enserraient de toutes parts pour le jeter à la mer.
Pour les jours à venir, la direction était le nord, vers la Mer Baltique. Par Kreuzburg, Zinten, nous l’atteignîmes à Brandenburg. La mer était fortement gelée. Chaque nuit, des colonnes interminables de réfugiés traversaient la glace du Haff, une mer "intérieure", pour atteindre 15 km plus loin, la Nehrung, une bande de terre par laquelle ils espéraient arriver à Danzig. Plus d’un demi-million réussira ce passage (cf. fin du récit de René Habay).
 Mais notre route sur la glace prit une autre direction. Nous fûmes dirigés vers l’ouest où, après une marche de 30 km, nous retrouvâmes la terre ferme à Rosenberg. Par Heiligenbeil, Braunsberg et Pettelkau, nous parvînmes à Drewsdorf, du côté ouest du chaudron, qui depuis le 31 janvier s’était rétréci pour former un carré de 60 km de côté, adossé à la mer. Nous prîmes position en bordure du village dont la population était encore sur place. Le secteur demeurait assez calme pour l’instant.
Mais notre route sur la glace prit une autre direction. Nous fûmes dirigés vers l’ouest où, après une marche de 30 km, nous retrouvâmes la terre ferme à Rosenberg. Par Heiligenbeil, Braunsberg et Pettelkau, nous parvînmes à Drewsdorf, du côté ouest du chaudron, qui depuis le 31 janvier s’était rétréci pour former un carré de 60 km de côté, adossé à la mer. Nous prîmes position en bordure du village dont la population était encore sur place. Le secteur demeurait assez calme pour l’instant.
Le 12 février les Russes attaquèrent avec des chars après nous avoir largement arrosés avec leurs mortiers. La peur s’empara des villageois. Je vis des jeunes filles qui changèrent de tenue et revêtirent des pantalons et de vieilles loques. Elles se barbouillèrent le visage. Ce travestissement ne leur évita hélas pas le viol par les brutes russes. Nous fûmes rapidement débordés avec les nouvelles pièces qu’on nous avait fournies en remplacement de celles abandonnées aux Russes le 13 janvier. Notre Feldwebel, un homme sympathique, ordonna le repli. Nous reculâmes de quelques centaines de mètres et passâmes par malheur à côté d’une ferme où était installé le P.C. du Régiment 912 de la 349. V.G.D.
L’Oberst Meinecke nous fit stopper et aligner dans la cour de la ferme.
« Wer ist der Führer dieses Haufens ? Qui commande ce tas ? »
Le Feldwebel se présenta. L’officier enchaîna : « Sie haben die Stellung ohne Befehl verlassen, vous avez quitté la position sans en avoir reçu l’ordre. Im Namen des Führers, halte ich hier Kriegsgericht. Sie sind zum Tode verurteilt. Haben Sie noch einen Wunsch ? Au nom du Führer, je détiens ici les pouvoirs de la cour martiale. Vous êtes condamné à mort. Avez-vous encore un désir ?
- Ia, ich möchte in Stellung gehen. Oui, je voudrais repartir pour occuper une position.
- Das gibt’s nicht mehr. Es ist zu spät. Ce n’est plus possible. C’est trop tard. »
Nous vîmes Meinecke dire quelque chose à l’un des officiers qui l’entouraient. Celui-ci entra dans la maison et en ressortit quelques instants après. Pendant ce temps, on avait arraché les épaulettes et le ceinturon à notre Feldwebel et on l’avait plaqué contre le mur de l’écurie. Le peloton d’exécution prit position.
Meinecke cria : « Haben Sie noch einen letzten Wunsch ? Avez-vous un dernier désir ?
- Ia, grüssen Sie meine Frau und meine Kinder. Oui, saluez ma femme et mes enfants !
- Feuer ! Feu ! » Le malheureux s’écroula devant le mur de l’écurie. Un officier vint lui donner le coup de grâce.
Tout le drame s’était joué en une vingtaine de minutes et à quelques centaines de mètres des Russes. Durant toute la scène, nous étions là au garde-à-vous, hébétés. Chacun avait son fusil et 30 balles dans ses cartouchières. Aucun n’a bougé le petit doigt. Résultat de la discipline de fer inculquée à des hommes qui, même au bout du rouleau et voyant bien que la partie était perdue, n’ont pas osé retourner leurs fusils contre cette bande de salopards ! Nous étions 20. On a su par la suite que Meinecke voulait faire fusiller chaque troisième homme de la section, mais qu’il n’a pas obtenu le feu vert du P.C. de la division. C’est pour cela que l’un de ses officiers était rentré à l’intérieur donner un coup de fil.
Notre Feldwebel était originaire de Kassel. Il avait fait la guerre depuis le début, en Pologne, en France et ensuite en Russie. Il avait été blessé plusieurs fois mais avait survécu à 5 années de guerre pour mourir misérablement contre le mur de l’écurie d’une ferme de Prusse-Orientale, le 12 février 1945, par les mains criminelles d’un salopard comme ce Meinecke ! Après la guerre, j’ai fait des démarches à Kassel pour retrouver sa femme et ses enfants, mais sans résultat. J’ai fait aussi des recherches pour retrouver Meinecke. Je n’ai jamais obtenu de réponses. Je me suis demandé si mes correspondants n’ont pas cherché à le protéger. Inutile de décrire notre condition psychologique après cette horreur. Même les copains allemands étaient révoltés. Plus que jamais, j’étais, ce soir-là décidé à passer de l’autre côté. Mais pouvait-on faire confiance aux popofs ? S’ils n’avaient pas eu la réputation d’abattre les prisonniers ou de les laisser "crever" en Sibérie, les désertions auraient été nombreuses, même de la part des Allemands.
Par la suite, il m’est arrivé à plusieurs reprises de rester dans mon trou, le soir, quand on décrochait, mais à la dernière minute, j’ai tout de même suivi les autres. La décision était bien difficile à prendre. Dans les dernières semaines du combat en Prusse-Orientale, des faits semblables à l’exécution de Drewsdorf sont devenus courants. Se sachant perdus, ils ont voulu entraîner tout le monde dans la mort.
Ils ont fréquemment installé des Feldgendarmen (police militaire) dans des trous derrière les premières lignes. Le premier qui sortait de la tranchée ou de son trou, soit pour aller vers les Russes, soit pour refluer, était descendu. Du côté de Heiligenbeil et de Braunsberg, pendaient aux arbres des soldats qui s’étaient repliés sans ordre vers l’arrière. Perdus pour perdus, ils ne faisaient plus de quartier.
Notre section a été incorporée à la 13ème compagnie du V.G.R. 912, celui de Meinecke, et nous avons été mis en position dans une grande clairière du Braunsberger Stadtwald. Nous ne sommes pas restés longtemps là non plus. Lors d’une attaque au mortier, Erich S., un Allemand, et moi, nous nous sommes jetés dans le fossé d’un chemin forestier, pour nous protéger quelque peu. Quand le tir a cessé, je me suis relevé. Mon voisin est resté couché. Je l’ai secoué. Il ne bougeait plus. Un éclat l’avait mortellement touché. Il était mort sans un cri. Je l’ai enterré aussitôt sommairement au pied d’un arbre et une demi-heure plus tard nous décrochions une fois de plus : repli sur Schilgehnen. Impossible de creuser un trou tellement le sol est gelé. Je me suis fait mon trou dans un silo de betteraves. Au-dessus de nous, un chasseur allemand - ça faisait longtemps que n’en avions plus vu - a abattu un avion russe qui est tombé tout près de notre position. Cela a donné un beau feu d’artifice quand ses munitions ont explosé. Son pilote avait pu sauter en parachute et a été fait prisonnier. De là, repli sur Braunsberg où nous avons pu dormir une petite nuit dans une caserne en ruines causées par les bombardements et ouverte à tous les vents. Subitement, une lampe de poche m’a été braquée dans les yeux et une voix me dit : « Der Iwan ist da. Mensch ! Wollen Sie die Hände gar nicht hochheben ? Iwan est là. Vous ne voulez donc pas lever les bras ? »
Des officiers nous provoquaient parfois pour tester notre volonté à continuer le combat. Nous étions sur nos gardes. Bien que réveillé en sursaut, ma tête a fonctionné au quart de tour et j’ai flairé le piège. Son allemand sonnait trop allemand pour être celui d’un Russe et malgré le pistolet braqué sur ma poitrine, j’ai senti instinctivement que c’était un de ces officiers salopards qui cherchaient à nous avoir. J’ai saisi mon fusil et déverrouillé la sécurité. Il s’est aussitôt fait reconnaître comme officier allemand Si j’avais levé les bras, il m’aurait abattu.
Après cette nuit de repos, façon de parler, que nous avons passée quelque peu à l’abri du froid -il n’y avait bien sûr pas de chauffage mais nous étions épargnés par les -20°C qui sévissaient dehors- nous avons repris la marche par Stangendorf pour nous mettre en position près de Willberg, face à Frauenburg, au bord de la Baltique dont les rives étaient déjà occupées par les Russes. Nous les entendions circuler à moto et avec des camions. C’était début mars et la neige commençait à fondre. Cette halte devait être notre dernière position stabilisée avant ma capture.
Nous y avons à nouveau construit un bunker dans la terre où nous étions six, dont un Alsacien, Joseph B..
Le front était relativement calme dans notre secteur. Nous étions à 5 km de la Baltique.
Autour du bunker, du pissenlit commençait à pousser. Pour améliorer le menu qui était de plus en plus maigre, Joseph et moi en avons cherché. Nous l’avons lavé dans des trous d’eau et apprêté. Les Allemands qui nous voyaient faire disaient : « Die Franzosen fressen Gras. Les Français bouffent de l’herbe. » C’était effectivement plutôt du Gras’ que de la salade. L’assaisonnement ne comportait que du sel et quelques lardons. Le reste nous manquait. Les Allemands ne connaissaient pas cette salade dentelée.
Le 13 mars, nouvel assaut général des Russes sur le Kessel de Heiligenbeil, le chaudron dans lequel nous étions. Durant quelques heures, ce fut de nouveau le tremblement de terre dû au Trommelfeuer. Cette fois, les Russes étaient décidés à liquider cette épine qu’ils avaient dans le pied, loin derrière le front général qui se trouvait déjà profondément établi en Allemagne. Nous ne le savions pas à l’époque. Ils mettaient le paquet pour détruire ou jeter à la mer tout ce qui restait encore vivant dans ce chaudron.
Puis Iwan arriva avec son infanterie. Dans notre secteur, nous parvînmes à le contenir. Stationnés au-delà du Haff et de la Nehrung à plus de 20 km du large, des bâtiments de la Kriegsmarine envoyaient de grosses bordées sur les assaillants. Ça faisait du méchant dégât. Nous tînmes quelques jours avant de décrocher sur Grünau où nous subîmes des bombardements successifs démentiels durant toute la journée, une journée radieuse de soleil. Impossible de décrire ces scènes : des cadavres partout, d’hommes et de chevaux, les pièces touchées déplacées de plusieurs mètres, des équipements et des corps projetés sur les branches des arbres.
Chacun essayait de sauver sa peau comme il pouvait. Je ne savais plus où me réfugier. Finalement, je me planquai dans l’entonnoir d’une bombe récemment tombée, il n’y avait que l’embarras du choix, le sol en était criblé et je confiai mon sort à la loi des probabilités selon laquelle il n’y a qu’une chance sur mille pour qu’une autre bombe tombe exactement au même endroit. C’était la loterie. Elle a été gagnante pour moi, ce jour-là.
Le soir, une fois le calme revenu, on s’est retrouvé auprès de notre pièce. Une roue en avait été arrachée. Le tube était fiché profondément dans la terre.
Certains n’étaient plus là, dont Joseph B., l’Alsacien. C’était pourtant sa fête, ce jour-là, 19 mars ! Il est rentré après la guerre, lui aussi heureux rescapé. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois depuis pour nous raconter nos aventures après cette journée mémorable de Grünau. Il avait été comme sonné par ces bombardements qui lui avaient fait déborder le vase. Le soir, il avait rencontré des prisonniers français qui refluaient eux aussi vers la mer, comme nous. Il leur a demandé des effets kaki qu’ils lui ont donnés. Dans la nature, se croyant à l’abri de tout regard, surtout dans la nuit, il est passé du feldgrau au kaki. Deux S.S. qu’il n’avait pas vus, se sont approchés et lui ont braqué leurs fusils sur la poitrine. A coups de poings, il a réussi à les jeter à terre et a filé de toutes ses jambes, échappant miraculeusement aux coups de feu tirés sur lui. Quelques heures plus tard, il était chez les Russes qui ont failli eux aussi l’abattre sur place. Arriver seul chez eux comme évadé comportait toujours un gros risque. Conduit vers l’arrière, il a abouti après différents camps au sinistre camp de Tambov, où il a réussi à survivre jusqu’à son rapatriement en octobre 1945.
De Grünau, nous aboutîmes à Heiligenbeil le 22 mars. Le Kessel n’avait plus que 20 km de long en bordure de la Baltique sur 5 km de large. Des dizaines de milliers de soldats allemands s’y trouvaient encore, presque sans munitions et surtout sans ravitaillement. C’était un amoncellement incroyable de charrettes, de chars sans essence, souvent incendiés, d’équipements de toutes sortes abandonnés par les civils avant leur marche sur la glace du Hall en février.
Images typiques d’un champ de bataille devenu tas d’ordures ! Images inoubliables.
Et dans ce chaudron réduit, c’était le pilonnage continu de l’aviation et de l’artillerie russes. Un enfer ! Nous étions en position près du terrain d’aviation de Heiligenbeil. Alors que j’étais couché contre un talus, une bombe tomba trois mètres au-dessus de mon emplacement et m’enterra. Les copains me sortirent de l’amas. J’avais la bouche et le nez pleins de terre. Bien que blessé à la jambe gauche, je pouvais marcher. De soins il n’en était plus question. Le lendemain je fus à nouveau blessé au bras gauche par un tir de mortier. J’en ai encore les éclats dans la peau. Le soir, en décrochant une fois de plus, et n’en pouvant plus de fatigue, je jetai la caisse de munitions que je portais, ceci pour alléger ma marche. Malheureusement pour moi, un officier qui se trouvait non loin de là, vit mon geste.
« Was haben Sie da weggeschmissen ? Qu’avez-vous jeté là ? » Je ne pouvais pas lui dire « Munition » sinon j’étais bon pour la casserole. « Was weiss denn ich ? Qu’est-ce que j’en sais ? » lui répondis-je. Et vlan, il m’envoya une gifle magistrale qui projeta mes lunettes au loin. Je ne les ai plus retrouvées par la suite.
J’étais fou de rage. Je lui ai crié : « Ich hab’ nicht gewusst dass deutsche Offiziere solche Schweine sind ! Je ne savais pas que les officiers allemands étaient de tels cochons. » Ma diatribe est sortie comme un jet. Une fois proférée, j’ai pensé : « Denis, tu viens de faire la connerie de ta vie. Il va sortir son revolver et te descendre ! »
II ne l’a pas fait. Il m’a dit : « Dort ist der Bunker des Kommandeurs. Gehen Sie sich beschweren ! Là-bas il y a le bunker du commandant. Allez vous plaindre. » Je m’en suis bien gardé. De toute façon, simple soldat, je tirais la courte paille face à un officier, bien que le règlement interdise à un officier de gifler un soldat. Mais dans cette atmosphère de fin de monde, il y avait surtout des règlements de compte et ceux-là se soldaient par une balle dans la peau. Nous avons continué notre marche dans la nuit.
Un copain allemand m’a tapé sur l’épaule en me disant : « Diese Nacht, komm’ ich mit dir ! Cette nuit, je viens avec toi. » Je n’avais pourtant fait aucune allusion à une éventuelle désertion mais il connaissait mes sentiments.
Dès le lendemain matin, à la sortie de Heiligenbeil, les bombardements non-stop ont repris. Le petit groupe que nous étions encore s’est dispersé sous les bombes, chacun cherchant ailleurs un abri. La cohésion entre les gars d’une même unité s’est défaite. Je me suis retrouvé avec Karl O., qui avait encore une mitrailleuse et quelques munitions. Nous avons mitraillé autant que nous pouvions encore, toujours sous les bombes. On pensait que notre fin approchait ! Le soir, on s’est encore replié et dans la nuit nous nous sommes perdus définitivement. Karl O. a pu rentrer sain et sauf. Après la guerre, nous nous sommes écrit. Il habitait alors en R.D.A. Il me relata qu’il était, en ce fameux soir, arrivé jusqu’au rivage de la Baltique. Sur une planche, il avait essayé de traverser le Haff, large de 10 ou 15 km. Après plusieurs heures d’efforts, alors qu’il était totalement exténué, un petit bâtiment de la Kriegsmarine le repêcha. Dirigé sur Koenigsberg, il fut blessé à la tête lors des combats pour cette ville. Il eut la chance de pouvoir trouver place sur un dernier bateau qui l’amena au Danemark où il fut fait prisonnier par les Anglais, qui le libérèrent bientôt à cause de ses blessures.
 J’étais désormais seul. Quelques centaines de mètres plus loin, je suis tombé dans une position parsemée de trous individuels où des gars d’unités disparates étaient en ligne. Ils m’ont intégré dans leur groupe. Ce devait être mon dernier front. Les Russes avaient suivi mais nous les tenions à distance avec nos fusils. On avait faim. Depuis des jours, aucun renfort ne nous atteignait plus, et pour cause ! C’était la débâcle et le sauve-qui-peut général. Dans la nuit, nous avons aperçu entre les lignes, une voiture chargée de vivres mais abandonnée, et dont les chevaux avaient été tués. J’ai rampé jusqu’à elle. Elle était chargée de pain. J’en ai pris quelques-uns et je suis retourné dans mon trou où je me suis régalé de ce repas inespéré. Au matin, quand il a commencé à faire clair, j’ai vu que ce pain était tout couvert de sang. Sang humain ou sang de chevaux ? Peu importait. Quand on a faim on mange des cailloux ! Par dessus le bord de mon trou, j’ai inspecté prudemment le secteur où j’avais débarqué dans la nuit. Je me trouvais au sommet d’une élévation de terrain qui descendait en pente douce vers la Baltique située à 500 mètres de là. Par delà le Haff, on distinguait à 10-15 km la Nehrung, cette étroite bande de terre. Vers le nord, je voyais toute la côte jusqu’à la pointe de Balga à environ 10 km.
J’étais désormais seul. Quelques centaines de mètres plus loin, je suis tombé dans une position parsemée de trous individuels où des gars d’unités disparates étaient en ligne. Ils m’ont intégré dans leur groupe. Ce devait être mon dernier front. Les Russes avaient suivi mais nous les tenions à distance avec nos fusils. On avait faim. Depuis des jours, aucun renfort ne nous atteignait plus, et pour cause ! C’était la débâcle et le sauve-qui-peut général. Dans la nuit, nous avons aperçu entre les lignes, une voiture chargée de vivres mais abandonnée, et dont les chevaux avaient été tués. J’ai rampé jusqu’à elle. Elle était chargée de pain. J’en ai pris quelques-uns et je suis retourné dans mon trou où je me suis régalé de ce repas inespéré. Au matin, quand il a commencé à faire clair, j’ai vu que ce pain était tout couvert de sang. Sang humain ou sang de chevaux ? Peu importait. Quand on a faim on mange des cailloux ! Par dessus le bord de mon trou, j’ai inspecté prudemment le secteur où j’avais débarqué dans la nuit. Je me trouvais au sommet d’une élévation de terrain qui descendait en pente douce vers la Baltique située à 500 mètres de là. Par delà le Haff, on distinguait à 10-15 km la Nehrung, cette étroite bande de terre. Vers le nord, je voyais toute la côte jusqu’à la pointe de Balga à environ 10 km.
Derrière nous, on découvrit des 88 orphelins de leurs servants, partis sans doute par faute de munitions. Tout le long de la côte, ce n’était que bric-à-brac, voitures et attelages abandonnés.
Il ne restait plus que cette étroite bande de territoire encore aux mains de la Wehrmacht.
Nous étions le 26 mars 1945, le lundi de la semaine sainte. Dès que le soleil se leva, le tapis de bombes et d’obus s’abattit de nouveau sur cette petite langue de terre.
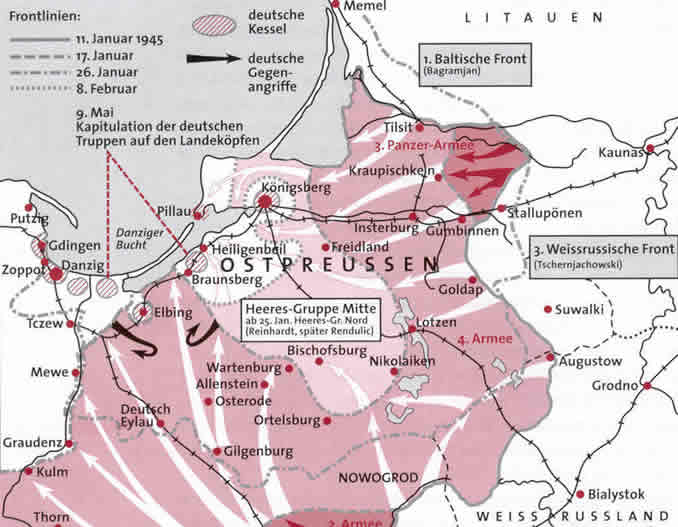 Sur le Haff, on apercevait des petites embarcations, des radeaux de fortune, qui tentaient de gagner la Nehrung. L’infanterie en face se tenait tranquille. Dans la journée, apparurent cinq chars. Un sous-officier et quelques soldats rampèrent vers eux avec des Panzerfaust. Ils en touchèrent trois qui flambèrent aussitôt. Les chefs de char des deux autres blindés fermèrent leur écoutille et firent demi-tour. Les équipages qui avaient encore pu s’extraire de leurs chars qui brûlaient rampèrent vers leurs lignes.
Sur le Haff, on apercevait des petites embarcations, des radeaux de fortune, qui tentaient de gagner la Nehrung. L’infanterie en face se tenait tranquille. Dans la journée, apparurent cinq chars. Un sous-officier et quelques soldats rampèrent vers eux avec des Panzerfaust. Ils en touchèrent trois qui flambèrent aussitôt. Les chefs de char des deux autres blindés fermèrent leur écoutille et firent demi-tour. Les équipages qui avaient encore pu s’extraire de leurs chars qui brûlaient rampèrent vers leurs lignes.
Il faisait un soleil radieux, un vrai jour de printemps. La mer paressait derrière moi, brillante comme un miroir. Et moi, j’étais terré dans mon trou, abandonné au désespoir. J’approfondis ma cavité pour le cas où d’autres chars viendraient à nettoyer le terrain. En dehors du pain récupéré la nuit, il n’y avait rien à manger, ni surtout à boire et aucun espoir que quelqu’un viendrait nous ravitailler. D’ailleurs personne ne connaissait plus personne dans ce ramassis des "derniers des Mohicans ".
Cette journée fut la plus éprouvante de toute ma guerre. Non pas tant à cause des obus et des bombes qui nous étaient généreusement largués- on avait eu largement le temps de s’y habituer - mais à cause des questions et pensées qui hantaient mon esprit. J’ai fait le tour de toutes les possibilités qui me restaient pour m’en sortir.
Je pressentais nettement que c’était mon dernier jour de Wehrmacht. Mais qu’allais-je devenir ? Mourir dans ce trou perdu au bord de la Baltique, absolument incognito ? Jamais ma famille ne saurait ce que j’étais devenu et où pourrissait ma carcasse.
Dans un trou voisin, un gars était en train de mourir, touché par un obus expédié par l’un des chars venus dans le secteur quelques heures plus tôt. Je ne connaissais pas ce type. Je n’ai jamais vu son visage, j’ai entendu ses plaintes et ses gémissements toute la journée. Mais impossible d’arriver jusqu’à lui. Vers le soir, je ne l’ai plus entendu, mort sans doute. Soldat inconnu !
Me replier en soirée vers la mer ? Quelle chance subsistait-il à espérer pouvoir encore embarquer sur des bateaux inexistants ? De plus, le rivage à atteindre constituait davantage encore une cible tentante pour les mortiers et les avions ennemis que notre première ligne installée à 500 mètres de là.
M’envoyer une balle dans la tête ? Certains le firent, je trouvais ça trop bête. Il me restait une dernière solution : attendre les Russes dans mon trou. Je ne m’en voyais pas sortir vivant. Connaissant leurs moeurs et leurs usages, je me ferais abattre par le premier Iwan venu. Je m’en remis à la Providence et je me dis dans une prière quelque peu naïve : « Si Dieu t’a ramené ici à peu près indemne à travers la saloperie de ces deux années, il ne va pas te laisser crever misérablement maintenant, alors que se joue le dernier acte. » Toute la journée s’est ainsi écoulée à ruminer, à passer du plus noir accablement au plus fol espoir. La nuit est tombée. En face, les Russes ont tiré en l’air avec des balles traçantes, comme au premier janvier. Leurs cris et leurs chants sont parvenus jusqu’à nous. Ils fêtaient déjà la victoire, sachant bien qu’ils ne trouveraient plus grande résistance chez nous et qu’occuper ce bout de territoire en bordure de mer ne serait plus qu’une promenade nocturne au clair de lune.
Un sous-off a sauté dans mon trou. « Wir ziehen uns zurück zum Strand. Du machst Nachhut mit ein paar Mann. Nous nous replions en bord de mer. Tu fais l’arrière-garde avec quelques autres.»
Tout en restant dans nos trous, nous devions, de temps à autre, tirer quelques coups de fusil pour faire croire aux Russes que la position était toujours occupée, alors que la plus grande partie des survivants descendait la colline vers la petite route qui longeait les roseaux.
Une heure durant nous avons tiré sporadiquement, sans qu’on ne bouge en face. Puis, de trou en trou, a circulé le mot Rückzug, Repli ! Je n’ai pas eu le courage de rester terré dans mon trou. Mais je n’avais pas plus envie de descendre vers ce bord de mer tentateur pour prendre la direction de Balga, où le lendemain, - si les Russes n’allaient pas déjà occuper le tout au cours de la nuit-, le chaudron ne serait plus qu’un mouchoir de poche et où la journée à venir serait encore plus meurtrière sous leur pilonnage. Que faire ? J’ai traîné la patte et j’ai laissé les autres s’éloigner, les suivant de loin. Arrivé au bord de la Baltique, je me suis engagé sur le petit chemin qui la longeait. Il faisait nuit noire mais les carcasses de voitures et les équipements de toutes sortes qui brûlaient, éclairaient le paysage.
A un moment donné, j’ai vu des silhouettes dans les roseaux sur ma gauche. Ces silhouettes parlaient français ! Comme un éclair, une lumière a jailli dans ma tête : « Je suis sauvé ! » Je me suis approché. J’ai entendu dire : « On ne peut pas rester là, on va se faire tuer dans cette boucherie. Que faire ? » Je me suis rapproché d’eux. Ils n’ont plus rien dit. J’étais casqué, botté, un fusil à la main. Ils m’ont pris pour un Boche, quoi.
A leur accoutrement, j’ai reconnu des prisonniers français. Ils étaient six. Je leur ai dit : « Je suis Lorrain. N’auriez-vous pas des effets kaki à me passer ? Je peux vous mener chez les Russes. Je n’ai qu’à faire le retour vers les anciennes premières lignes d’où je viens. » Comme je devais le découvrir quelques instants plus tard, il y avait déjà parmi eux depuis quelques jours, un autre déserteur lorrain, Marcel T.. Lui était vêtu tout en kaki.
Un Vendéen qui portait une peau de mouton, récupérée sans doute dans une ferme au cours du repli qu’ils avaient effectué au rythme des retraites de la Wehrmacht, avait encore dans ses bagages son ancienne capote kaki, en très mauvais état. Elle lui servait de couverture. Il me la donna.
Profitant du couvert des roseaux, j’ai enlevé mon casque, mon ceinturon, tout le harnachement, les cartouchières. Le fusil, la baïonnette et tous mes papiers militaires, Soldbuch, etc..., j’ai jeté le tout à la Baltique. Cela ne m’a posé aucun cas de conscience par rapport au serment de fidélité prêté à mon Führer !!?? Par contre, j’ai dû garder le pantalon vert-de-gris et les bottes. Cela m’a donné quelques craintes pour la suite des événements, mais je ne pouvais tout de même pas me présenter tout nu devant les Russes. Par chance, j’avais un pull-over kaki que j’avais touché quand on avait été équipé en juillet passé. Déjà en situation de pénurie à l’époque, la Wehrmacht avait puisé dans les stocks récupérés auprès de l’armée française défaite.
J’ai enfilé la capote. J’étais devenu en quelques minutes un prisonnier français de 40 !
Ce travestissement s’est effectué le 26 mars 1945, le lundi après les Rameaux, vers 21 heures, sur les bords de la Baltique, en Prusse-Orientale. Si je relève ainsi cette date, c’est parce que je la mets en parallèle avec le 18 juin 1940 quand les Allemands avaient fait leur entrée dans mon village. Ici aussi, c’était un monde qui basculait pour moi, pas de la même façon qu’en 1940.
Une parenthèse dans ma vie, celle de la Wehrmacht, allait se refermer et j’allais retrouver ma véritable identité. Mais restait tout de même une grande inconnue pour l’avenir immédiat, la peur des Russes dont les méthodes nous étaient bien connues. J’ai vraiment eu l’impression de passer d’un monde civilisé à un monde de l’homme des cavernes. Ce que j’allais vivre chez eux sera comme un "passage chez les barbares, sur une autre planète".
Je suis passé de la Wehrmacht de Hitler à l’Armée Rouge de Staline en habit de prisonnier de 1940.
J’ai dit à mes nouveaux copains : « on va se diriger vers la ligne du front que je viens de quitter. Nous tomberons infailliblement sur les Russes. Il n’y a plus d’Allemands entre eux et nous. » Je me trompais.
Au bout de quelques dizaines de mètres, nous avons entendu des voix devant nous. C’était encore un petit groupe d’Allemands qui formaient l’arrière-garde dans un secteur voisin du mien. Ils nous ont demandé où nous allions. J’ai eu bien peur avec mes bottes et mon pantalon vert-de-gris. Je me suis fait tout petit dans ma capote kaki et j’ai laissé les copains expliquer qu’on allait schlafen (dormir) par là. « Nein, da konnt Ihr nicht hingehen, Non, vous ne pouvez pas aller par là » ont-ils répondu. « Da ist ja der Iwan. C’est chez Iwan ! » Nous ne pouvions pas leur dire que c’est justement "chez Iwan" que nous voulions aller.
Ils nous ont ramenés en arrière, à peu près à notre point de départ. Comme il y avait des trous un peu partout, ils nous ont dit : « Hier konnt Ihr schlafen ! Ici, vous pouvez dormir ! » On les a laissés s’éloigner en restant encore un bon moment dans nos trous.
Plus personne ne venait. J’ai dit : « Repartons ! Il ne peut plus y avoir d’Allemands devant nous. »
Nous nous sommes remis en route vers ma dernière position de la journée. Je me suis sans doute un peu écarté du chemin que j’avais emprunté voici peu en sens inverse. On entendait ici ou là des gémissements douloureux. Sans doute des blessés qui agonisaient dans leur trou. Au bout de quelques centaines de mètres, nous avons perçu des voix devant nous. On a prêté l’oreille attentivement car il ne fallait pas tomber encore sur des Allemands. C’était bien des sons russes. Cette fois le Rubicon allait être franchi. Mon coeur battait la chamade. Qu’allait-il se passer ? Comment se ferait la rencontre ? A coups de mitraillette et ce serait la fin ou vraiment le salut ? Connaissant les popofs, je n’étais guère rassuré.
Nous nous sommes encore avancés, agitant des mouchoirs et criant : « Franzouski, nix schiessen, Kam’rad. » Notre progression a été stoppée par un petit cours d’eau, canal ou ruisseau, large de 3 à 4 mètres. Les Russes y sont parvenus de leur côté et nous ont crié : « Idi souda ! Dawaï, dawaï ! Par ici, allez, allez ! » Nous leur avons montré le cours d’eau, ils ont continué à crier : « Dawaï, dawaï ! » en nous ordonnant de traverser l’obstacle.
Les premiers d’entre nous -ils portaient des valises et des sacs qu’ils ont jetés de l’autre côté -sont passés à la nage. Je ne savais pas nager et je pensais que j’allais me noyer au moment même où je croyais être sauvé. L’eau était profonde. Les Russes s’énervaient. J’ai pris un élan et j’ai sauté aussi loin que j’ai pu. Des mains se sont tendues et m’ont tiré de là. Nos libérateurs étaient une troupe d’avant-garde composée d’une dizaine de soldats de l’Armée Rouge. Leur premier geste fut de nous plaquer la mitraillette sur la poitrine puis de nous réclamer des « Ouri, ouri, des montres, des montres. » Mes compatriotes furent délestés sans ménagement. J’avais caché la mienne dans les bottes. Les copains s’exclamaient : « Franzous ! Alliés... alliés.
- You pojy match ! » nous répondirent-ils. C’est un grossier juron russe que nous allions entendre bien souvent dans la suite et qui voulait dire : « va coucher avec ta mère ! » Le langage de charretier de toutes les armées du monde se ressemble !
Les rapaces nous vidèrent les poches, prenant ce qui leur plaisait et en jetant le reste par terre. Ils se ruèrent également sur les valises et les sacs des copains. Puis ils nous dirent de marcher en direction de leurs arrières. Eux continuèrent leur avance.
Nous avons ramassé ce qu’ils n’avaient pas daigné saisir et avons pris la direction indiquée. Les copains étaient salement déçus de l’accueil de nos alliés libérateurs. Ils nous avaient en tout cas libérés de bien de nos affaires ! Moi j’étais content de ce premier contact, je n’avais pas reçu une balle dans la peau, comme cela arrivait souvent quand ils faisaient des prisonniers. Nous étions trempés jusqu’aux os et la nuit de mars était encore froide. Nos misères n’étaient pour autant pas encore terminées.
Bientôt d’autres petites sections russes suivirent et ce fut chaque fois le même scénario entrecoupé de menaces, de vols et de pillages. Ce maraudage se reproduisit une bonne dizaine de fois. Les copains furent pratiquement délestés de tous leurs bagages. Moi, je ne possédais que le contenu de mes poches ainsi qu’une musette.
Pour tout vous dire, il me restait un mouchoir, ma pipe cassée, ma gamelle, ma cuillère-fourchette et un petit portefeuille en carton mâché contenant deux ou trois papiers dont je parlerai plus loin. Même mon chapelet a changé de propriétaire, devenant qui sait, peut-être une chaîne pour accrocher un revolver !
Une des sections nous soumit à une visite corporelle plus approfondie. J’avais pu auparavant sortir ma montre de mes bottes et l’écraser du talon dans la boue. Je me suis défaussé de ma montre car je ne voulais pas m’exposer à de graves ennuis si on l’avait découverte. Ma marraine me l’avait offerte à ma communion solennelle en 1937.
On finit par nous emmener dans la cour d’une ferme des environs de Heiligenbeil où s’entassait déjà une foule captive constituée de prisonniers allemands, de prisonniers français de 1940, d’anciens prisonniers russes, de civils russes déportés comme travailleurs par les Allemands, etc... On nous mit en carré.
Un officier ou commissaire politique, revolver à la main, nous harangua en russe pendant un bon moment. Nous ne comprîmes rien à son discours. Pendant ce temps, des soldats russes, munis de bougies, s’infiltrèrent dans nos rangs, inspectèrent nos chaussures et nos habits. Quand ils trouvaient une pièce qui leur plaisait, ils sortaient le gars des rangs et lui faisaient enlever la veste ou le pantalon ou les chaussures qu’ils avaient trouvés à leur goût.
Les prisonniers et civils russes furent mis à part. On leur réserva un traitement spécial à la soviétique ! Comme nous l’apprendrons par la suite, au lieu d’être rapatriés, ils furent mis dans des camps. Leur crime : ayant été en contact avec le monde occidental kapitalist, (ќапиталист) il fallait d’abord les décontaminer !
Quand l’officier eut fini son baratin on nous fit monter, nous autres Français, dans le grenier à paille d’une ferme par une échelle où manquait la moitié des échelons. Posté au pied de l’échelle, de chaque côté, un popof et son vis-à-vis hâtaient le mouvement à coups de « dawaï, bistra » et de coups de crosses. Heureusement la paille ne manquait pas. Certains parmi nous se déshabillèrent pensant que leurs habits sécheraient mieux ainsi et s’enfouirent dans la paille en caleçon. Le lendemain matin, leurs habits étaient aussi mouillés que la veille. On n’était pas en août mais en mars ! M’étant glissé tout habillé dans la paille, je constatai au matin que mes habits avaient tout de même séché quelque peu. Nous n’avons eu ni à boire ni à manger.
J’avais passé une très bonne nuit, la première depuis longtemps, sans avoir à monter la garde, sans risquer de bombardement. J’ai surtout goûté le fait que la guerre, au moins celle des armes, était terminée pour moi et que, presque par miracle, j’y avais survécu. Qu’allait-il advenir maintenant ? Je n’en savais rien.
Mais la chance de me trouver parmi des ex-prisonniers français me laissait tout de même l’espoir d’un rapatriement pas trop lointain. La préoccupation du moment était d’arriver à survivre chez les Russes. Cela n’était pas tout à fait évident.
Le lendemain matin, on nous rassembla dans un pré voisin pour un triage : soldats allemands par ici, ex-prisonniers français par là. Je ne me sentais pas très rassuré dans mes bottes et mon pantalon feldgrau de la Wehrmacht. Personne n’y prêta attention. Les Russes avaient eux-mêmes des accoutrements très disparates.
Par contre, j’évitai de me trouver au premier rang de l’alignement, de peur d’être reconnu peut-être par l’un ou l’autre Allemand de mon unité et dénoncé éventuellement par eux auprès des Russes.
Les Français furent mis en marche dans une colonne forte de plusieurs centaines d’hommes. C’étaient tous des "ex-pensionnaires" des stalags IA ou IB situés en Prusse-Orientale. Beaucoup parmi eux avaient travaillé dans les fermes et s’étaient repliés avec les civils devant l’avance russe. Ils n’avaient pas trop osé se laisser libérer par les Russes. Ils avaient espéré que le repli se ferait peut-être jusqu’en Allemagne où ils auraient été vraiment libérés par les Anglo-Américains.
On nous mit sur la route. Notre destination nous était inconnue. Des sentinelles armées nous encadraient. Pas question de ravitaillement. En guise de boisson, il y avait l’eau des fossés. Quelques dizaines de mètres plus loin gisaient des cadavres de chevaux ou d’hommes !
II s’agissait de garder l’allure, car nos gardes avaient la détente facile. Une vie humaine ne comptait pas beaucoup en ces temps-là.
Le soir, on fit halte près d’une ferme brûlée où nous passâmes la nuit à la belle étoile. On fouilla ici ou là et l’on trouva quelques pommes de terre qui furent grillées dans la braise d’un feu qu’on avait allumé. Le lendemain et le surlendemain, notre marche se poursuivit jusqu’à Preussisch-Eylau où nous fûmes parqués dans une caserne à moitié détruite qui ne disposait plus d’aucune porte ni de fenêtre.
Et c’est là que le Vendredi-Saint 30 mars, nous avons touché notre premier ravitaillement : un morceau de pain et un bout de saucisse. On nous a prévenus que c’était là notre provision de route jusqu’au mardi suivant.
Le lendemain Samedi-Saint, on nous a remis en marche sans nous préciser la destination. Nous avons "fêté" Pâques, sur les routes de Prusse-Orientale, quelque part entre Preussisch-Eylau et Allenstein où nous arrivâmes le mardi suivant.
Logés dans une ancienne caserne allemande bien endommagée, nous y avons reçu enfin un ravitaillement plus régulier : deux soupes par jour, un morceau de pain et une cuillerée à soupe de sucre. Parmi les ex-prisonniers français 1940, se trouvaient plusieurs prêtres, dont l’abbé Duben, futur aumônier général du Secours catholique français. Il a célébré la messe pour nous dans la cour de la caserne, le dimanche de Quasimodo 8 avril, en nous donnant l’absolution générale, un acte religieux exceptionnel qui nous a permis de faire nos Pâques.
Le lundi suivant, nouveau départ, mais cette fois en train de marchandises, en direction de l’Est. Nous craignions que ce fût pour la Russie, mais à Insterburg on nous débarqua et nous continuâmes à pied jusqu’à Gumbinnen où plusieurs milliers d’ex-prisonniers français étaient rassemblés. C’est là que j’allais passer quatre mois. Le groupe dont je faisais partie était logé dans une espèce de cité en dur, à la périphérie de la ville. Nous occupions des maisons dont les propriétaires avaient fui lors de l’offensive russe en octobre 1944. Les Russes avaient vidé les habitations de tout leur mobilier qui, par trains entiers, était parti vers la Russie.
J’étais toujours avec mes six copains des premiers jours. Je passerai d’ailleurs tout mon séjour avec eux.
Nous nous organisâmes avec les moyens du bord. Nous fabriquâmes des bat-flancs recouverts de paille sur lesquels nous couchions. Trois soupes aux betteraves ou à l’orge, environ 700 grammes de pain et la traditionnelle cuillerée de sucre composaient nos menus. Pas un gramme de viande ni de matière grasse.
Comme la surveillance ne s’exerçait que sur les routes et les chemins, nous formions chaque semaine un petit commando clandestin qui à travers champs battait la campagne dans les environs et ramenait tantôt des betteraves, tantôt des grains de seigle récupérés dans des fermes aux alentours.
Nous faisions cuire les betteraves pendant des heures dans une vieille baignoire, en plein air. Cela nous donnait une espèce de confiture. Le grain, nous le moulions dans un moulin à café, dont il ne restait que la pièce essentielle (qui en assurait le concassage) et nous cuisions des galettes, sans sel, ni levure, ni graisse. Mais de la sorte nous nous assurions un petit supplément malgré tout appréciable. La faim rend inventive !
Plusieurs fois, les Russes nous soumirent à des pointages et des contrôles. J’avais le numéro-matricule 4979. J’ai toujours vieilli ma date de naissance et donné comme lieu de naissance un autre endroit qu’une localité de Moselle. Ces opérationsse sont toujours bien passées pour moi, sauf une fois. C’était une femme-lieutenant, il y en avait beaucoup dans l’armée, qui menait le pointage. Elle m’a regardé, surtout mes bottes et mon pantalon vert-de-gris et m’a dit : « Daïtsche Soldatt ». J’ai répondu : « Nix daïtsche Soldatt. Franzous ». Elle a fait la moue et a répété que j’étais un Daïtsche Soldatt. Elle a dû se dire que j’étais bien jeunet pour avoir passé déjà quatre ans en captivité. Finalement, elle m’a dit : « Dawaï » et s’est adressée au suivant. J’ai eu très chaud ce jour-là. Nous étions plusieurs Alsaciens-Lorrains noyés dans la masse du camp. En usage interne, les aspirants français nous ont demandé notre véritable identité. Eux savaient qui nous étions. Je gardais dans mon portefeuille deux sauf-conduits français de 1939 que j’avais eu la bonne idée d’emporter lors de ma dernière permission de l’an passé pour le cas où... Ils m’ont bien servi à ce moment-là mais aussi ultérieurement, au contrôle des Anglais à Bedburg-Hau, lors de notre rapatriement.
Ce séjour à Gumbinnen m’avait fait revenir dans le secteur où j’avais combattu quelques mois plus tôt. Lors de nos randonnées-ravitaillement, j’ai vu dans la nature quantité de carcasses de chars russes ou allemands, touchés à mort lors de l’offensive de janvier. Un peu partout gisaient encore des cadavres de soldats allemands tombés à l’époque et que personne n’avait enterrés depuis. Une fois, j’ai vu une dizaine de dépouilles, déculottées et nues, portant des stries noirâtres sur le dos et le derrière. Etaient-ce des prisonniers allemands que les Russes avaient torturés avant de les abattre ? Possible ! Beaucoup de soldats russes avaient un comportement de grands gosses qui pouvaient devenir dangereux et sauvages parce qu’ils avaient une mitraillette dans la main. Les mitraillettes partaient parfois toutes seules. C’est fou ce qu’un homme peut changer quand il a une arme dans la main ! Moins il est développé intellectuellement, plus il devient alors dangereux.
En général, les Russes que j’ai vus étaient des gens rustres et grossiers. Dans certains postes de garde, j’ai vu des interrupteurs électriques qui avaient été arrachés dans les maisons : pendus à une ficelle, ils servaient comme ornementation de leur cambuse ! Nous nous amusions beaucoup à les voir apprendre à monter et surtout à chuter à vélo, de drôles d’engins qu’ils avaient trouvés dans les villages. Ils en avaient arraché les pneus et roulaient sur les jantes !
Le système les avait chauffés à blanc dans la haine contre l’Allemand, ce qui provoqua leur sauvagerie, les viols et les pillages auxquels ils se livrèrent en entrant en territoire allemand. Ce que les Allemands avaient perpétré en Russie excita leur soif de vengeance aveugle.
Mis à part le ravitaillement insuffisant, la vie au camp était acceptable. Une grande camaraderie régnait entre tous. Nous autres, ex-incorporés dans la Wehrmacht, étions intégrés à part entière. Personne n’a jamais fait de différences ni de remarques désagréables à notre égard.
Pour les corvées inévitables on se relayait équitablement. Il y avait chaque semaine roulement : les uns faisaient les travaux d’entretien et de nettoyage qui nous étaient demandés, les autres partaient au ravitaillement clandestin à la campagne. Concernant cette dernière activité, il n’y eut jamais ni incidents ni accidents. II fallait pourtant être très prudents, car les champs de mines étaient nombreux.
Les prêtres assuraient chaque dimanche la messe dans une salle mise à notre disposition par les Russes. Elle était très fréquentée. De quoi parlions-nous ? Du rapatriement, bien sûr. On l’espérait proche mais on ne possédait aucun renseignement officiel. Des bobards circulaient continuellement, d’aucuns prétendaient que les trains étaient déjà formés en gare, d’autres prédisaient que nous serions rapatriés via la Russie, Odessa et la Mer Noire. Mais tout cela n’avait pas de fondement.
La vraie difficulté était sans doute que lors de leur débâcle, les Allemands avaient fait sauter toutes les installations ferroviaires et tous les ponts. Remettre cela en marche demanderait sans doute du temps.
On parlait aussi beaucoup deboustifaille. Chaque jour, l’un ou l’autre faisait le menu imaginaire qu’il se paierait en rentrant. Cela nous mettait l’eau à la bouche et attisait notre faim.
Malheureusement, tous ne rentreraient pas. Chaque semaine, il y avait deux ou trois décès, conséquence de la vie précaire ; ces décès résultaient du manque d’hygiène et de l’inexistence des soins pour faire face à la maladie. Il n’y avait ni sanitaires ni toilettes. Des feuillées primitives avaient été creusées dans la nature. Jamais de douche. Pas d’eau courante, pas d’électricité, pas de médicaments. La vermine grouillait inévitablement. Depuis plus de six mois, je n’avais pas changé de sous-vêtements. Une seule fois pourtant, j’ai pu toucher un caleçon long à fermeture à ficelles, une capote russe et un calot.
Pour le 1er mai, on nous fit défiler. Le 8 mai, nous apprîmes la signature de l’armistice et la capitulation totale des Allemands. « Gitler kapoutt » disaient les Russes. C’était bien sûr la joie. On nous fit défiler à nouveau mais aucune attribution alimentaire supplémentaire ne nous donna l’occasion de festoyer à la victoire.
Fin mai, une lueur d’espoir apparut. Par train, trois convois quittèrent Gumbinnen pour la Russie à destination d’Odessa. Le 1er juin, on nous fit déménager en ville, dans la vieille caserne.
Pendant quelque temps, je fus de corvée quotidienne à la cuisine. Mon travail consistait à moudre de l’orge pendant plusieurs heures, manuellement s’entend. Un travail exténuant, car je n’avais plus beaucoup de force. Mais ça me valait une gamelle de soupe supplémentaire et cela comptait.
Dans les ruines de la ville de Gumbinnen survivaient quelques civils allemands qui, à l’époque de l’évacuation des troupes de la Wehrmacht, n’avaient pas pu ou pas voulu se replier. Ils menaient une vie misérable, du genre de celle vécue par les hommes des cavernes. Ils ne disposaient pas d’eau courante, pas d’électricité, pas de gaz, pas de magasins, pas de vêtements ni de chaussures. C’étaient surtout des femmes, des vieillards et des enfants. Ils survivaient avec les restes qu’ils trouvaient chez les Russes : c’étaient des cadavres ambulants, sans parler des sévices sexuels que subissaient les femmes sans défense de la part de la soldatesque qui était souvent ivre.
J’ai vu un jour une de ces ombres conduire au cimetière, dans une brouette, toute seule, le cadavre de son gamin, mort de faim. Elle était hébétée, sans réaction aucune.
Encore une autre image que je n’arrive pas à oublier : la chasse aux trésors ! Au début les Russes se jetaient sur tout ce qui brillait : montres, alliances, chaînes, -ils ont parfois coupé des doigts pour récupérer les bijoux !
Et comme désormais il n’y avait plus rien à trouver chez les vivants, les chasseurs fouillaient alors dans les décombres des maisons, sondaient avec des tiges de fer les jardins, pour y chercher de l’argenterie ou de la porcelaine, que les populations avaient cachées, imaginaient-ils, lorsqu’elles durent quitter leurs maisons.
Ils s’attaquaient aussi aux morts. Au cimetière de Gumbinnen, j’ai vu des caveaux troués. Les profanateurs étaient allés chercher des alliances et des dents en or sur les cadavres.
Quand les Russes enterraient un des leurs compères, ils le couchaient sans autre forme de procès sur une voiture-plateau tirée par un cheval. Une caisse sans couvercle posée à l’envers recouvrait le corps qu’ils allaient enfouir quelque part dans la nature. La caisse resservait ensuite pour leur prochain macchabée.
Il nous arrivait de jouer des tours pendables aux Russes. Un jour, alors que nous étions allés à quelques-uns à la gare, histoire de voir si l’on formait vraiment des trains pour notre rapatriement, nous nous sommes fait pincer par une sentinelle qui nous a amenés manu militari à la Kommandantura où siégeait le commandant de la place. Le soldat y est entré pour signaler notre escapade : nous nous sommes demandé ce qui allait advenir de nous. Quand il est ressorti, il nous a conduits à l’autre bout de la ville, dans un grand jardin entouré de hauts murs. Nous étions punis de corvée de jardinage !
Un vieux moujik, manifestement un vétéran, en était le jardinier. Les produits du jardin étaient sans doute destinés à la popote du commandant. On était en juin. Les semis sortaient de terre, la mauvaise herbe aussi. Il nous remit à chacun une binette et par signes, il nous montra que nous devions enlever la mauvaise herbe. Puis il s’en alla dans sa cabane au fond du jardin. Quand il revint au bout d’une heure ou deux, il jeta les bras au ciel et proféra quelques jurons russes typiques. Nous avions fait du bon travail de prisonniers ! Nous avions arraché les plants et laissé la mauvaise herbe. Il nous engueula copieusement et nous chassa de son jardin en nous menaçant du manche d’un outil. Nous avions obtenu exactement ce que nous voulions : retourner à notre cantonnement. « Franzouski nix cultura » nous injuria-t-il.
Afin de ne pas être repris par une autre patrouille, nous nous mîmes en formation, marchant au pas, l’un de nous jouant au chef comme si nous étions en commando régulier. Nous regagnâmes notre quartier en provoquant l’hilarité chez les copains à qui nous avons raconté le bon tour joué aux Russes.
Le 26 juin, grand branle-bas. On nous dit de nous tenir prêts pour 11 heures, on nous annonça que nous allions être rapatriés via l’Allemagne et non plus via la Russie et Odessa. (Les convois partis quelques semaines plus tôt vers Odessa, reviendront après un long périple passé en Russie, eux aussi par l’Allemagne, pour rentrer en France). Grande joie et grandes tapes dans le dos dans tout le quartier. A 11 heures précises, tout le monde était rassemblé sur la place d’appel. Il n’y avait pas de retardataires. Par le truchement d’un interprète, un officier nous annonça que le départ était différé. Il ne nous donna aucune explication et nous ordonna de regagner nos quartiers. La déception était immense. Les popofs furent voués à tous les diables pour leur façon de jouer au chat et à la souris avec nous. La soirée se passa bien tristement.
Dans l’après-midi du lendemain, eut lieu un nouveau rassemblement avec armes et bagages– ils n’étaient pas lourds. Mais c’était sans enthousiasme. On n’y croyait plus. De nouveau, harangue d’un officier qui nous annonça notre rapatriement. « Nous espérons qu’après le retour chez vous, vous travaillerez (et comment ?!) pour nous qui vous avons bien traités ici ». On se regardait les uns les autres et on faisait de grands yeux. Certes, nous étions vivants, ce qui est déjà une performance quand on a passé par les mains de la Krasnaja Armija, l’Armée Rouge. Nous y avons tout de même laissé quelques kilos malgré leur bon traitement.
Et alors... divine surprise. Un ordre fusa : « Demi-tour droite. En avant ! » Nous nous mîmes en route en espérant qu’il n’y aurait plus de contre-ordre cette fois. Une fois sortis de la ville, nous avons commencé à croire que cette fois c’était bien pour de bon. Nous arrivâmes à Insterburg dans la soirée et on nous mena directement sur le quai de la gare. C’est là que nous avons compris pourquoi il nous fallut faire à pied le chemin de Gumbinnen jusqu’à Insterburg. Les Russes avaient provisoirement pu rétablir la ligne de chemin de fer jusqu’à Insterburg, mais en raison de l’écartement des voies russes, plus large que l’écartement européen, ils n’avaient pas encore pu progresser. Mais pas de train en vue. Nous avons poireauté sur le quai toute la nuit et toute la journée du lendemain. Ce n’est que le soir du jour suivant qu’un train de marchandises vide est arrivé. C’était pour nous. Nous avons embarqué.
Cependant le train est resté encore à quai toute la nuit et la journée suivante. Notre patience fut mise à rude épreuve mais, comme chacun le sait, la nonchalance russe, « nitchevo ! », est proverbiale.
Enfin, le 29 juin au soir, le train se mit en route, emportant 2 500 Français dans 57 wagons, qu’on avait eu le temps d’orner avec des branchages et de la verdure, en gare d’Insterburg.
Les conversations allaient bon train dans le wagon où nous étions couchés par terre. Les plus optimistes nous voyaient à la maison au bout de trois jours... En fait, il nous faudra encore un mois avant d’embrasser nos familles. Car c’est à la vitesse d’escargot que s’effectua le voyage. On avançait d’une gare à l’autre. Chaque fois le mécanicien allait chercher son ordre de route jusqu’à la gare suivante.
Ce n’est que le 4 juillet que nous arrivâmes à Berlin, en passant notamment par Gerdauen, Ostrod, Deutsch-Eylau, Thorn, Gniezno -ça me rappelait quelque chose !- Landsberg, Küstrin.
Partout on ne voyait que ruines et désolation. Un pays ravagé. Berlin offrait le même visage, c’est-à-dire des montagnes de gravats que des femmes en loques dégageaient avec des seaux qu’elles se passaient de main en main sur de longues files, les Trümmerfrauen, les femmes des ruines, comme on les appelait. J’appris par la suite qu’il a fallu déblayer 55 millions de mètres cubes de gravats dans l’ex-capitale du Reich.
Via Belzig, Borne, Güterglück et Gommern, notre voyage se poursuivit jusqu’à Magdeburg, où nous quittâmes le train, pour nous retrouver dans un immense camp de rassemblement dans l’ancienne caserne de la Flak. Ça grouillait de monde, hommes, femmes et enfants confinés dans une indescriptible promiscuité : cette masse humaine représentait 20 000 personnes de toutes nationalités.
J’y rencontrai plusieurs familles de mon village qui avaient été déportées en Silésie. Le ravitaillement y était nettement insuffisant mais nous touchâmes pour la première fois depuis trois mois des matières grasses.
Pour essayer d’améliorer l’ordinaire, nous allions chaparder dans la campagne environnante des légumes, des petits pois, des pommes de terre. Mais nos chapardages n’arrangeaient pas les affaires des civils qui, les pauvres, n’avaient pas grand-chose à manger. Ils alertèrent les Russes. Des patrouilles à cheval furent lancées à notre poursuite. Ceux qui se laissèrent attraper furent mis au cachot, lequel se retrouva bientôt surpeuplé. Alors, les gardes se contentèrent de couper les cheveux à ras aux "délinquants". Je n’ai pas été attrapé, m’étant caché à plat ventre dans les plantations de petits pois lors d’une patrouille.
Chaque dimanche nous avions une messe célébrée en plein air par un des prêtres qui étaient parmi nous. C’est au camp de Magdeburg que j’ai fêté mes 21 ans le 8 juillet. A l’époque nous n’avions pas compris pourquoi il y eut un "intermède" de trois semaines à Magdeburg, nous qui avions une telle hâte de rentrer. Nous l’avons su par la suite. Les Américains avaient cédé à ce moment-là une partie de leur zone d’occupation aux Russes. Il fallait donc aménager la nouvelle ligne de démarcation ainsi que les camps de transit d’une zone à l’autre.
Le samedi 21 juillet, nous quittâmes enfin ce camp, le dernier camp russe. Après un trajet en train d’une quarantaine de kilomètres, nous arrivâmes par Barneberg à Alversdorf. On nous chargea sur de vieux camions russes et nous passâmes la ligne de démarcation le 22 juillet à 14 h 15.
En voyant les Anglais, nous hurlâmes de joie. Enfin, (presque) la liberté ! Nous passâmes la nuit dans un camp anglais à Alversdorf, non sans avoir d’abord perçu des rations convenables. Le lendemain, par camions, on nous achemina à Rothenfelde-Wolfsburg, dans les usines Volkswagen.
Désormais les choses se précipitaient. A 11 heures, départ en train vers le camp anglais de Bedburg-Hau, où nous passâmes au contrôle de la police militaire anglaise. Avec mes deux sauf-conduits, je pus justifier de ma condition d’incorporé de force mosellan et l’audition passa comme une lettre à la poste, sans aucun problème.
Le 25 au matin, nous reprîmes le train pour entrer en Hollande, en passant par Hassum, Gennep, Boxel avant d’arriver à Eindhoven où nous fûmes abondamment ravitaillés vers midi. Le moral était au beau fixe. La joie était grande. Le trajet continua par Tilburg, Breda, Roosendal, Anvers, Mechelen jusqu’à Bruxelles-Schaerbeck, où dans une immense salle, sur des tables à nappes blanches, on nous servit royalement. Il y avait là du pain éblouissant de blancheur, comme nous n’en avions plus vu depuis 5 ans.
Nous continuâmes jusqu’à Valenciennes, non sans avoir eu droit, au passage de la frontière franco-belge, à un quart de pinard, le premier pinard français. A Valenciennes, arrêt de quelques heures, le 26, pour un dernier contrôle, français cette fois, au centre de rapatriement. On nous délivra notre carte de rapatrié et nous pûmes faire envoyer un télégramme stéréotypé à nos familles : « Arrivé en France ». De loin, je m’imaginais leur joie.
Le 27 nous arrivâmes à Paris où nous passâmes par une caserne de Reuilly. Le moment de nous séparer arriva. Les Alsaciens et Lorrains furent dirigés sur le centre de triage de Chalon-sur-Saône. Les autres purent librement rentrer chez eux. C’est là que se déroula un incident regrettable. Alors que nous passions aux douches, à la désinfection au DDT, un soldat français du service demanda à l’un d’entre nous, dont il ne savait pas qu’il était Luxembourgeois : « T’as pas été à l’armée allemande ? » Le Luxembourgeois lui répondit innocemment que si. Avant qu’on eût le temps d’intervenir et d’expliquer, le Luxembourgeois se fit rouer de coups. Excuses lui furent faites par un officier, mais le gars gardera, pour sûr, un bien mauvais souvenir de l’accueil reçu en France. C’étaient là des méthodes qu’on avait déjà connues ailleurs ! Le même jour, nous arrivâmes en soirée à la caserne d’Uxelles à Chalon-sur-Saône. Nouvelles formalités, nouveaux papiers, nouveau contrôle et perception de quelques habits neufs, kaki, cette fois. Je garderai les bottes jusqu’à la maison. Elles seront le dernier vestige de la Wehrmacht. On nous donna du ravitaillement, un peu d’argent et le dimanche 29, de très bon matin, je pus prendre le train, un train de voyageurs cette fois, qui m’amena vers midi à Strasbourg. Pour Metz, il n’y avait pas de train de prévu avant le soir. J’en profitai pour faire un saut chez une tante qui habitait un village proche de Strasbourg. C’est là que j’appris que mes parents et mon frère étaient vivants. Inutile de dire l’accueil que j’y reçus et les plats que ma parente m’a mijotés. Ces mets n’étaient pas très bons ni pour mon estomac ni pour mes intestins fragilisés et rétrécis par le régime des derniers mois.
Eugène, mon cousin venait de rentrer des USA. Lui aussi avait été incorporé dans la Wehrmacht. Il avait été fait prisonnier en Italie par les Américains qui l’avaient emmené jusqu’en Amérique. J’appris, hélas, aussi la mort d’un autre cousin, tombé en Italie. Le soir, je pris le train pour Metz, via Nancy. La ligne directe Strasbourg-Metz n’était pas encore rétablie. Les tunnels d’Arzviller n’étaient pas encore reconstruits. Par Metz, j’arrivai à Thionville où je pris le tram pour Hayange et je rejoignis à pied mon village.
Inutile de décrire la joie de mes parents et la mienne. La boucle était bouclée. Nous nous retrouvions sains et à peu près saufs. C’était la soirée du 30 juillet 1945. J’étais parmi les rescapés. Parti le 16 février 1943 à l’âge de 18 ans et 7 mois, je rentrais à l’âge de 21 ans et 3 semaines, meurtri dans mon corps et dans mon âme, traumatisé jusqu’à la fin de mes jours par les souffrances endurées et les horreurs dont j’avais été le témoin, à un âge qui n’était pas fait pour cela et pour une cause qui n’était pas la mienne.
Epilogue
Sur les 132 500 Alsaciens-Lorrains incorporés de force, 42 000 ne revinrent pas, 22 000 trépassèrent sur les champs de bataille, surtout en Russie. 20 000 autres étaient morts dans les camps de prisonniers soviétiques.
Pour celui qui n’a pas connu cette époque-là, certains faits relatés dans ces pages peuvent paraître imaginaires, romancés ou invraisemblables. J’en garantis l’entière et totale véracité. Tous les ex-incorporés de force de la Wehrmacht peuvent en rapporter de semblables tout comme ceux qui ont combattu dans d’autres armées.
On nous a dit parfois : « Pourquoi, vous autres Alsaciens-Lorrains, n’avez-vous pas déserté quand vous étiez sur le front russe ? » Lisez ce qui suit et vous comprendrez. « Lucien de Sarreguemines faisait partie du dernier groupe des survivants qui avaient réussi à prendre pied sur la rive ouest du Dniepr. C’était en novembre 1943, au sud de Kiev. Cinq hommes, en haillons, trempés, crottés, barbus, sans armes et les yeux hagards débarquèrent d’un assemblage de rondins et furent recueillis par la section. Ils étaient, au départ, une douzaine d’hommes, commandés par un sous-officier, qui avait scindé l’escouade en deux équipes se suivant à un intervalle de 100 mètres. Ils arrivaient à proximité du fleuve et cheminaient le long d’une laie forestière, lorsque l’équipe de tête fut brutalement assaillie, au détour du chemin par une horde de partisans qui voulaient intentionnellement les prendre vivants. Un seul coup de feu fut entendu et un partisan s’écroula sur la piste, ce qui eut pour effet de déchaîner la fureur et la frénésie des agresseurs. Le groupe dont faisait partie Lucien ne fut pas découvert par les partisans et se lova dans les buissons et fourrés bordant le chemin. Paralysés par l’effroi, -ils n’avaient plus d’armes- ils durent alors assister à une séance d’une sauvagerie frisant l’abomination la plus abjecte. Lucien tremblait de tout son être en relatant cet épisode à Joul, un Malgré-Nous de Sarrebourg. Bien que le premier groupe eût levé les mains pour se rendre, les Russes obligèrent les prisonniers à se déshabiller. Pendant que les uns leur maintenaient bras et jambes, les autres, à l’aide de pierres, enfoncèrent les baïonnettes récupérées, jusqu’à la garde, dans le ventre des suppliciés, les clouant vivants sur la piste de la forêt. Des hurlements atroces et désespérés montèrent dans les frondaisons. Mais la plus ignoble monstruosité se déroula dans la foulée. Armés de poignards, ces infâmes créatures arrachèrent plutôt qu’ils ne les tranchèrent, les parties génitales des malheureux et les leur enfoncèrent dans la bouche. Le sous-officier qui commandait le détachement et qui avait blessé un Russe au cours de l’échauffourée eut encore droit à un traitement supplémentaire. Ils lui crevèrent les yeux. Les partisans, riaient, plaisantaient et buvaient en assistant à ce macabre spectacle, se délectant des derniers soubresauts de leurs infortunées victimes. Lucien révéla aussi à Joul que parmi la première équipe figurait un jeune Alsacien qui, au moment de sa capture avait hurlé : « Ya Franzouski » à tue-tête. Mais cela ne servit à rien. Même le petit ruban bleu, blanc, rouge, que la majorité des incorporés de force portaient sur eux et que l’intéressé agitait de toutes ses forces ne parvint pas à infléchir ses persécuteurs. Il subit le même sort que les Allemands. Et quand la baïonnette s’enfonça dans son ventre, il hurla encore : «Ya Franzouski » jusqu’au moment où plus aucun son ne put sortir de son gosier obstrué par ses propres testicules. Joul restait abasourdi et sans voix. Il en avait déjà vu de toutes les couleurs mais ne pouvait s’imaginer qu’une telle abomination puisse exister. Ce jour-là, Lucien relata aussi les pénibles moments vécus depuis la retraite de Karkhov, la ruée des chars russes défonçant tout sur leur passage, s’offrant un macabre plaisir à pourchasser jusqu’à épuisement les soldats blessés isolés, puis les écrasant sous leurs chenilles. Il décrivit aussi la barbarie des fantassins russes s’acharnant sur tout soldat allemand en qui la moindre parcelle de vie pouvait encore être décelée. » (Georges Koestler - ADIEU GALINA - Editions Serpenoise –Metz 1993 page 133 et suivantes).
Comment prévoir une évasion dans ces conditions ? On peut comprendre la soif de vengeance des Russes après tout ce que les Allemands avaient fait dans leur pays. Il faut aussi comprendre que leur façon de prendre la revanche -que nous connaissions à l’époque -ne pouvait pas nous inciter à déserter et à passer chez eux. Ne suffit-il pas de voir ce qui se passe aujourd’hui en ex-Yougoslavie ou en Somalie ou ailleurs, pour comprendre que la barbarie et la déshumanisation qu’engendre la guerre ne sont, hélas, pas que de l’histoire ancienne ?
Six ans après mon retour, j’ai eu, avec une vingtaine d’autres ex-incorporés de force, à effectuer une période de quatre jours à l’armée française à Niederlahnstein. A son issue, le capitaine des effectifs nous reçut l’un après l’autre dans son bureau. Il me dit : « Vous avez connu l’armée allemande, puis l’armée soviétique et maintenant vous avez fait connaissance avec l’armée française. Qu’en pensez-vous ? » Il s’attendait peut-être à une comparaison à l’avantage de l’armée française. Je lui ai répondu : « Mon capitaine, après ce que j’ai vu, l’armée, c’est l’armée, qu’elle soit allemande, russe ou française ! » Il n’a pas beaucoup apprécié ma réponse.
« Quelle connerie, la guerre ! » Jacques Prévert.
« Plus jamais la guerre. Plus jamais les uns contre les autres ! » Paul VI à l’O.N.U.
« Prendre un fusil, c’est mettre l’Evangile aux oubliettes et se tourner vers la mort ! » Jacques Gaillot, évêque d’Evreux.