Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197
Ernst Jean †
« Chère Madame Simon, Je vous écris en ce 1 er juillet 1944 de l’hôpital d’Arendsee suite à votre courrier daté du 28 juin que je viens de recevoir.De suite, je veux vous répondre, j’aurais voulu le faire bien plus tôt mais cela s’avéra impossible du fait de mes graves blessures. Et lorsque je repris pleinement possession de mes moyens, je ne souhaitais plus me remémorer les événements terribles que j’avais vécus avec Gilbert, votre fils, et surtout, je ne voulais pas vous commenter les circonstances dramatiques de sa disparition.

S’il vous plaît, comprenez-moi, il faut du temps au temps pour évacuer le drame effroyable que j’ai vécu si douloureusement avec Gilbert Simon (Feldpost 29268) pendant plus d’une semaine, en février dernier, avant d’en parler à nouveau.
Revenu sain et sauf de la tête-de-pont du Kouban après mon passage réussi au-dessus du détroit de Kertch et après mon évacuation miraculeuse de la Wotan Stellung avec les survivants de notre 111 ème division d’infanterie le 27 octobre 1943, j’ai pu bénéficier d’un congé avant de rejoindre ma Marschkompanie, basée à Hanau au bord du Main. Cette unité était en attente de départ vers le front aux environs du 20 novembre.
J’ai connu à ce moment-là Gilbert lors du rassemblement de cette compagnie à Hanau, ainsi que quelques autres Lorrains. Nous passâmes par Vienne, Budapest, Jassy et Odessa avant d’arriver dans la grande boucle du Dniepr (le 25 novembre, Ndr). Après la ventilation des soldats effectuée à Nikopol, nous partîmes direction Melitopol où stationnait notre unité. Je pris Gilbert avec moi dans l’état-major du 36ème Régiment de pionniers-fantassins.
Comme il avait été déclaré G.V .H . (Garnisonsverwendungsfähig Heimat = employable dans une garnison en Allemagne) et non K.V . (Kriegsverwendbar = utilisable à la guerre), il atterrit de ce fait dans une section chargée de construire des ponts à l’arrière du front. Je puis vous assurer qu’il se trouvait toujours en sécurité à quelques kilomètres derrière la H.K .L., la ligne principale du front. Pendant ce temps, c’était le 19 décembre 1943, je fus envoyé dans une autre unité, parfaire durant une semaine, une formation de Panzerknacker, destructeur de chars.
Nous avions entretemps appris que les Russes allaient bientôt lancer une grande offensive. J’étais séparé de votre fils mais j’avais constamment de ses nouvelles grâce au contact relationnel que je maintenais avec le poste de commandement du bataillon. Lors de la grande offensive soviétique déclenchée dans la nuit du 1 er au 2 février 1944, Gilbert se trouvait dans une localité du nom de Cerenaïa, située à 3 km derrière le front. L’attaque ennemie fut précédée par de lourds bombardements d’artillerie ; les salves tirées par les canons russes tambourinèrent ininterrompues sur nos positions.
Puis l’attaque fondit sur nous. La première vague d’assaut fut anéantie, les fantassins ennemis arrivaient bien groupés, homme contre homme, sur une large ligne. Le feu de l’artillerie adverse qui tempêtait furieusement sur nos positions établies à l’arrière fut ramené sur la nôtre. Le tir de barrage démentiel dura deux heures, la fin du monde ! Subitement un silence incroyable s’établit avant que n’apparurent leurs panzers, suivis de leur infanterie. La nuit était éclairée comme en plein jour par d’innombrables lucioles. Nous tirâmes des fusées étoilées de couleur rouge à l’horizontale au-dessus de nous.

Ainsi prévenue par ce signal d’appel au secours, notre artillerie tira sur nos positions pour stopper l’assaut, la riposte fut poursuivie par nos mitrailleuses qui tiraient elles-aussi dans la masse grouillante. Lorsque le jour apparut, le champ de bataille était parsemé de morts et de tanks calcinés. Je pus rejoindre le village dans lequel était positionné Gilbert. C’était une vision spectrale (gespenstisch), il n’y avait plus de village, rien que des décombres.
J’y retrouvais encore quelques gars rescapés ; notre petit groupe reconstitua un nouveau verrou de sécurité. J’avais eu beaucoup de chance dans cet enfer : mon calot avait été perforé et mon fusil troué par un éclat d’obus. Que m’importait ces dégâts, j’étais parvenu sain et sauf à l’arrière et ce n’était pas rien ! L’unité de Gilbert s’était retirée vers le fleuve lorsque le feu roulant s’était abattu durant la nuit sur nos avant-postes. Le lendemain, son unité nous rejoignit et nous gardâmes durant quelques jours le village de Cerenaïa. Puis vint la retraite. C’était terrible, le dégel était apparu. Avec la gadoue jusqu’aux genoux, il fallut s’en sortir en combattant, avec le feu russe constamment sur nous.
Gilbert était à mes côtés, je lui disais de s’agripper à moi dans la boue. Nous avions le bonheur de disposer de chaussures à lacets. Tous ceux qui portaient des bottes furent victimes du Schlamm, cette fange piégeuse que nous appelions raspoutitsa. Les bottes restaient engluées, les gars se retrouvaient pieds nus et dans ce cas ils se savaient irrémédiablement perdus à cause des gelures contractées.
Aucune ambulance n’était là pour les secourir. Nous atteignîmes la localité de Demitrowka où s’étaient déjà ancrées des avant-gardes de la redoutable 8 ème Garde des armées de Staline. Il y eut à nouveau de lourdes contre-attaques, nous devions impérativement rejoindre le fleuve et le traverser. Dans le secteur que nous devions atteindre, le Dniepr est profond de 12 mètres et s’étend ici sur 8 km, dans ce qu’on appelle la Plagna, un immense bras-réservoir marécageux du fleuve (s’écrit en russe Planha). Gilbert était toujours là, mais il souffrait de profondes gelures aux pieds. Plus d’une fois, je le hissai sur des charrettes tirées par des chevaux, à cause de ses douleurs. Lors de notre attaque effectuée du côté de Malaya Lepeticha et Boloya Lepeticha, nous avions pu récupérer les canots des avant-gardes ennemies qui servirent à nos unités à traverser l’impressionnant cours d’eau.

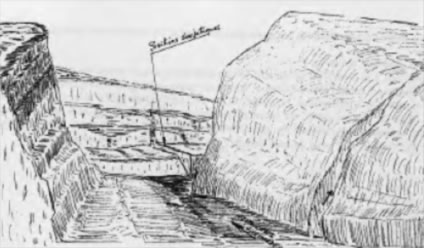
Là, nous bénéficiâmes de la présence miraculeuse du général-colonel Schörner qui assura notre sauvetage. Plus tard les historiens épilogueront sans doute longtemps sur l’odyssée inhumaine vécue là-bas. Ce qui est sûr, ce fut sa connaissance tactique de l’art consommé de la guerre qui permit cet exploit, je vous en parlerai lors de mon congé de convalescence. Après notre traversée réussie sur l’autre rive, nous formâmes un cordon de sécurité sur la berge abrupte.
Tandis que le Russe fonçait sur nous avec ses canots et tous les moyens disponibles qu’il avait pu réunir, intervint dans la foulée un puissant coup asséné par l’aviation ennemie qui nous attaqua avec ses avions au fuselage blindé. C’était des Iliouchine I et II qui nous couvrirent de bombes et qui utilisèrent leurs mitrailleuses de bord pour tirer en rase-mottes afin de nous anéantir. Nous n’étions plus en capacité de combattre, on nous rappela à l’arrière pour être rafraîchis dans une nouvelle unité.
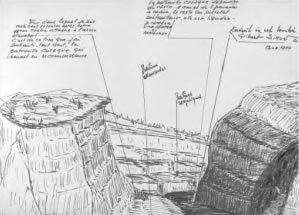
Gilbert était toujours là. Le lendemain, on nous versa dans la ligne de feu, il fallait qu’on reprenne un ravin par contre-attaque. Lors de cette attaque, Gilbert est tombé, pratiquement tous les camarades furent terrassés. Sur la compagnie, il ne resta que 5 survivants. Gilbert avait été atteint d’une balle en pleine tête, je l’ai vu étendu par terre mais je n’ai pas pu le secourir tant le feu était meurtrier.(Pieux mensonge, la réalité sera plus cruelle ! Ndr) Ce jour-là, nous quittâmes onze fois notre position et onze fois il fallut aller la reprendre aux Russes !
Je n’ai pas connaissance qu’un sous-officier ait pu désigner Gilbert comme estafette, c’est d’ailleurs invraisemblable car Gilbert était présent à mes côtés durant l’assaut, il n’y avait que deux mètres qui nous séparaient. Ma version des faits est véridique, toute autre assertion est fausse. Le commandant du bataillon vous a-t-il communiqué de plus amples renseignements ? Ou bien l’un de nos officiers ?
Dès ma permission et lorsque je pourrai à nouveau marcher, je viendrai vous rendre visite pour vous relater de vive voix les péripéties de sa mort mieux que je ne les aurais évoquées à travers une simple lettre. Je vous joins un plan sommaire des lieux où est tombé Gilbert le 12 février 1944 lors de la bataille entre Marinskoje et Apostolowo (cf. plan au début de la lettre suivi de 3 dessins des lieux tragiques). Je veux clore ma missive, mal rédigée à cause de ma main droite mutilée et qui est encore bandée car, elle aussi, a beaucoup encaissé. Permettez, chère Madame Simon, de vous exprimer mes plus sincères condoléances. Jean Ernst vous salue et partage avec vous, qui êtes écrasée par la douleur, sa peine silencieuse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Déroulement des faits antérieurs avant la blessure de Jean Ernst
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 janvier 1944
Il fait incroyablement froid, on peut difficilement respirer. L’un derrière l’autre, nous piétinons la neige épaisse et nous nous glissons vers notre HKL (Hauptkampflinie, ligne principale de défense du front) qui s’étend devant le village. Chacun rumine en solitaire ses pensées et a de quoi les entretenir en cette période d’inquiétude, car chaque nouvel ordre signifie un nouveau combat en vue, et donc une interrogation continuelle sur ses chances de survie. Même si le pionnier n’est pas habité ou rongé par le doute morbide, il n’en demeure pas moins vrai que ce dernier aura du mal à transporter les lourdes caisses, en sus de son fusil qui pèse bigrement sur l’épaule.
Il essaie aussi de garder continuellement une main au chaud avec laquelle il devra saisir à tout moment sa mitrailleuse et pouvoir l’utiliser, en cas d’intrusion ennemie. Beaucoup d’autres soucis l’assaillent, tels les codes des lucioles et le mot de passe à retenir (qui changent quotidiennement, Ndr). Nous espérons encore avoir l’occasion de reconnaître au mieux l’emplacement de nos futures positions tant qu’il fait jour, avant qu’Iwan n’attaque.
7 janvier 1944
Nous sommes installés dans la position que nous avons sommairement pu consolider avant la nuit. A chaque heure s’opère la relève. Nous pouvons ensuite dormir trois heures si l’on trouve de la place convenable dans l’abri. Et à nouveau une heure dehors et ainsi de suite. Souffler un peu, c’est ici impossible. Rien n’est plus primordial que la veille de la sentinelle pour assurer la sécurité de tout le groupe. Provenant du village d’en face et traversant la cuvette, l’ennemi avance vers notre position.
Nous ne sommes que 38 hommes. Le sergent et le lieutenant donnent les consignes : laisser d’abord approcher au plus près puis tirer à courte distance. Voilà maintenant les tirs en gerbe d’une mitrailleuse ennemie qui arrivent sur nous en sifflant, ils proviennent de la bordure du village tenu par l’adversaire. Un des canons antichars ennemis argumente chacun de nos mouvements par une rapide bordée d’obus. Mais alors survient soudain l’invraisemblable ! En peu de temps, au point qu’aucun d’entre nous n’a vécu un tel phénomène, le ciel s’obscurcit et un mur gris accompagné d’une violente tempête de neige descend de la nuée et s’avance sur nous. La bourrasque est si forte qu’on ne retrouve plus son chemin.
Agripper sa propre mitrailleuse apparaît alors pour le moins ridicule, car l’arme est devenue entièrement glacée, obturée par le verglas qui l’empêche de tirer. Des silhouettes ombrées sautent par ci par là, comment savoir si ce sont des amis ou l’ennemi ? Le bruit sourd de la culasse qu’on arme a, en ces instants, un son très particulier ; on ne peut apprécier dans sa ligne de mire aucune distance, aucune direction ni sélectionner une cible de choix. Ce qui est sûr, c’est que le danger est là, tout près. Iwan est posté à quelques mètres de nous. Avec les fusils et pistolets, nous résistons. Savoir si l’on a atteint l’adversaire, on ne peut le constater que rarement. Aucun d’entre nous ne peut donner de renseignements clairs, il n’existe aucune cohésion, aucune liaison ; chacun ignore ce qui se passe chez son voisin. Nous tirons sur des ombres qui s’aventurent devant nous, provenant de devant, de derrière, de gauche et de droite.
Nous n’apercevons plus la section voisine, il n’y a plus de ligne. Mais nous faisons confiance à nos camarades qui en attendent autant de nous. Le chef de groupe nous a ordonné de tenir la position. Il est clair que la position serait perdue si un guerrier quittait son poste. Si sa sMG arrête de tirer faute de munitions, le fantassin continue de répliquer avec son fusil, son pistolet et ses grenades. Souvent, en ces moments tragiques, un fusil peut être déterminant. Après trois heures de tempête blanche, le ciel s’éclaircit, la moitié du village brûle. Le crépuscule voit toujours la compagnie garder ses positions. Ainsi, comme on le constate, ce fut un jour difficile que chaque homme a dû passer seul dans le froid, au dehors. Et le sifflement des balles continue sans répit. La parfaite visibilité donne aux deux partis d’incomparables occasions d’atteindre leurs cibles. Le fantassin sort- il sa tête hors de son trou pour voir et tirer, il doit alors compter sur la balle mortelle venue d’en face ! S’il reste abrité, il doit accepter l’idée angoissante de l’ennemi qui rampe vers sa position et imaginer qu’avec une baïonnette brandie par l’adversaire, le malheureux sur le qui-vive prépare sa propre fin !
8 janvier 1944

Devant Wersch Rogatschik Signification des lucioles : 1 cartouche rouge = tir vers l’ennemi, 2 rouges = tir de barrage roulant, 1 verte = suspension de tir, 2 vertes = allonger le feu de tir provenant de nos arrières pour soutenir notre progression. De nouvelles difficultés apparaissent, je suis dans le poste de commandement de la compagnie établi dans une maison qui tient encore debout. Dans un des coins, s’affaire une équipe de mitrailleurs qui n’arrive pas à réparer l’engin. Le chef de compagnie distribue les dernières munitions. Dans un autre coin, des blessés légers sont assis à table, ils restent silencieux et visiblement satisfaits car atteints par un Heimatschuss convenable, blessure juste comme il faut à propos de laquelle beaucoup de fantassins rêveraient d’en être à leur tour les heureux détenteurs. Mais les blessés graves qui sont couchés dans la paille, seront-ils extraits du chaudron ?
Quelques-uns des nôtres essaient de les rassurer avec des petits mots de réconfort, là où ça (le mensonge) prend. Au milieu des gémissements nous arrivent les rapports pour signaler que les munitions sont épuisées. Nous ne possédons individuellement plus que 5 cartouches. Lorsqu’on tend l’oreille vers la forêt, l’on entend distinctement « Urräh » sortir des gosiers russes. Une impression de gorge sèche liée au danger mortel vous triture l’esprit, il n’y a aucune aide à attendre de l’extérieur. La grande leçon de cette guerre qu’on nous a inculquée, c’est surtout de ne pas compter sur du secours extérieur mais uniquement sur soi-même.
C’est une épreuve qui apparaît très difficile sur le coup mais qui une fois surmontée, devient quelque temps plus tard un autre test ardu à passer face à un nouveau danger encouru ! Maintenant il nous semble que c’est la fin. Pourquoi devons-nous seuls garder cette position ? Il faudrait économiser des vies, oui pourquoi tenir ce bout de tranchée ? Que représente Wersch Rogatschik à l’échelle de la grande Russie ? Voilà ce que nous ruminons mais ces divagations ne nous sont d’aucun secours ! La nuit se passe dans une attente stressante qui met nos nerfs à rude épreuve. (cf. photo ci-dessus d’une tranchée conquise à W. Rogatschik, Jean Ernst est à l’arrière-plan).
9 janvier 1944
Si nous quittions maintenant la maison en feu, nous serions irrémédiablement déquillés les uns après les autres. Mais que nous reste-t -il comme autre choix ? Etre grillés ou abattus ? Qu’adviendra-t -il de nos blessés ? Concernant les malheureux estropiés, nous ne leur sommes d’aucun secours. L’on sent qu’ils nous quémandent un coup d’œil rassurant et qu’ils attendent en gémissant sur leur fatale destinée. Ainsi va notre existence, la Peur sur nos talons. Le Gruppenführer ordonne que les dernières munitions seront à tirer au coup par coup et qu’il nous faudra crier « Hurra » le plus fortement possible pour tétaniser l’assaillant.

Ceux qui connaissent l’effet démoralisant du « Urräh » et du « Hurra » sur le mental du combattant solitaire, en appréhendent eux-mêmes la signification. Dans le village, l’on perçoit subitement une pétarade de coups de feu ; des détonations retentissent à gauche devant nous et même devant notre maison. On entend nettement l’éclatement strident des obus russes.
Aussi bizarre que cela paraisse, je vois maintenant des silhouettes feldgrau sauter, des grenades voler vers les canons. Nous crions « Hurra », une de nos sections s’élance, il y a du mouvement, nous poursuivons les fuyards. L’invraisemblable a réussi ! Iwan qui nous a attaqués avec des forces considérables faiblit et cède du terrain. C’était un assaut désespéré que nous avons tenté pour alléger la pression, nous avons pu libérer dans un sursaut héroïque les camarades de la Stabskompanie du Grenadier Regiment 36 (le Major nous félicite, cf. photo).
Nous pouvons maintenant secourir les blessés et les diriger vers la halte des premiers secours. Le lieutenant Müller étant grièvement atteint à la tête, je l’ai traîné en lui fixant un câble (que j’ai coupé) sous ses aisselles, sur bien 200 mètres, et j’ai réussi à le ramener en sécurité, sous le feu ennemi. Il est inconscient, il a une horrible blessure à la tête mais il peut espérer néanmoins s’en sortir. J’ai utilisé les bandes de nos trousses de secours respectives, je les ai appliquées pour arrêter l’hémorragie. Ce gars doit impérativement pouvoir être sauvé. J’ai glissé dans son livret de solde un papier mentionnant que je l’ai extrait de la ligne de feu dans une neige profonde. J’étais seul, ce ne fut pas facile, mais j’étais fier d’avoir pu sauver le chef de compagnie le 9 janvier 1944 aux environs de 15 heures. Signé, Jean Ernst de l’Infanterie Pionier Kompanie 9 de la 111 ème Division d’Infanterie.
Lettre du 16 janvier 1944
Chers parents, Je dispose de quelques jours de congé (du 9 en soirée jusqu’au 16) et je me trouve hors de la zone de combats de la division sur ordre de notre commandeur. Je n’ai plus de papier à lettre à ma disposition comme il serait d’usage de le faire pour vous donner de mes nouvelles, même par ici. Je pense avoir oublié les bonnes manières, (Jean écrit sur le verso d’un recueil de poèmes allemands, Ndr). Je vous envoie aussi de nombreuses photos que j’ai faites à la veillée de Noël et que j’ai pu faire développer ici. Un courrier de la division va être expédié et j’ai obtenu l’autorisation d’y glisser quelques lignes avec les clichés. Voici un rapide résumé des événements de Noël et de la nuit du 25 au 26 décembre 1943. Vous avez sans doute pu entendre les rapports de la Wehrmacht à ce sujet.

Je n’ai pas pu, ni recevoir ni expédier du courrier. J’étais de garde avec ma Leuchtpistole (lance-fusées), lorsque vers 15 heures je fis feu et donnai l’alarme. Iwan s’était glissé silencieusement à 10 mètres devant mon trou lorsque 5 gars surgirent face à moi. Je tirai aussitôt deux grenades tandis que les Iwans répliquaient avec leurs mitraillettes. Ils lancèrent des lucioles rouges ce qui fit tambouriner leur artillerie deux heures et demie sur nos positions.Puis ils arrivèrent sur nous, homme à homme au coude à coude, avec plusieurs sections d’assaut. Je tirai en continu avec ma mitrailleuse dans l’attaque. Puis, du Nord arrivèrent leurs tanks accompagnés à nouveau de troupes de choc. Nos canons antichars 7,5 et 8,8 cm brisèrent l’assaut. Nous avons anéanti 36 blindés et les combats ne cessèrent qu’aux environs de 20 heures. Ensuite, c’est nous qui avons été impliqués dans la contre-attaque et avons pu réinvestir nos positions précédentes.
Mon bon camarade, le sous-officier Winter, est tombé de même que beaucoup de camarades de la compagnie. C’est de cette manière que nous avons passé Noël, pas d’enfant Jésus dans la crèche mais en contrepartie, du froid, de la neige épaisse et les spécialités de Staline ! Dans le corps-à -corps, j’ai été légèrement blessé à l’œil gauche par un coup de poignard. Mon visage est enflé, le docteur dit que ce n’est pas grave, juste une blessure de chair ouverte. Hélas, cela n’a pas suffi pour que ma blessure devienne prétexte à un rapatriement. Dès que nous serons sortis de l’encerclement, je vous écrirai d’autres renseignements, il y aurait tant à commenter. J’espère que vous avez reçu de la correspondance du colonel. Procédez avec précaution avec ces choses (photos, Ndr), pensez toujours que « l’ennemi écoute avec ». Je vous donnerai de mes nouvelles dès que possible. Je vous envoie des saluts froids de la steppe, à bientôt.
Jean Jean Ernst a malheureusement égaré certaines pages de son manuscrit, d’où des vides dans son agenda....
30 janvier 1944

Vers 18 heures, alors que les « ravitailleurs » s’apprêtent à partir vers l’arrière (au village de Cerenaïa) pour nous ramener de quoi desserrer le ceinturon, j’entends des bruits devant mon poste de mitrailleuse. Je tire aussitôt une luciole blanche et je vois, à environ 30 mètres de distance, une forme couchée. Je crie fort : « Stoï, Parole » et sur ce, je m’exclame en allemand « Kennwort » et j’arme mon MG 42. Je perçois un bruit étouffé : « Sdajus towaritsch ne stre latze ». Je crie aux camarades de ne pas tirer sur le déserteur. Je l’appelle : « Towaritsch, iddi souda ». En même temps, mon pistolet expédie une nouvelle fusée qui illumine la scène enneigée. « Towaritsch, iddi souda, viens ici. » La silhouette rampante s’approche, guidée par mon appel.
Le Russe n’est pas armé, je l’agrippe par le col pour le culbuter dans la tranchée. Je confie mon MG au tireur n° 2 en lui recommandant une extrême vigilance. Le soldat russe est ramené dans notre bastion que nous avons blindé à notre manière, avec les moyens du bord. Le pauvret s’agenouille, me baise la main.
Il me supplie : « Panwy gawaritji russia ? Homme, parles-tu russe ?
- Ja panjiemaju, je comprends, lui dis-je.
- Towaritch, ja goladna. Camarade, j’ai faim.
- Tchass, moment’... skora. Un moment... après. » Je le fais fouiller à la recherche d’une arme ou d’une grenade cachée.
Je lui prends ses papiers et lui dis : «Woyna piocha, la guerre est mauvaise. Prasstitjija nji. Ça me fait de la peine. Dajti mniè pagalussta rasjätka. Je voudrai ton rasoir.
- Da, da. Spassiba karascho, Towaritch niemski ! Oui, oui, merci beaucoup, tu es un très bon camarade allemand.
- Ja Frantsusski, niet Niemski ! Je suis Français, pas Allemand.
- Ja panjemaju. Je comprends. »
Je lui demande : «Wy is kakoj tschjassti ? De quelle région viens-tu ?
- de O... près de la mer d’Azov. Ja studjänt. Je suis étudiant.
- Schto wy isutschjatji ? Qu’est-ce que tu étudies ?
- Mjädejitsina. Médecine.

L’adjudant Pausch m’interrompt et s’exclame : « Jean, je ne savais pas que tu parlais le russe ! (cf. photo de Pausch et Ernst dans la steppe).
- Oui, assez pour le comprendre et m’entretenir avec quelqu’un. Ecoute, ce gars est étudiant en médecine, disons Unterarzt (médecin en second). Avant d’avertir le bataillon, je voudrais connaître son nom et son âge.
- Jean, mais tout cela est annoté dans son livret.
- Laisse-moi donc faire... »
Peu après Pausch réapparaît : « Alors Jean, drôle de capture ?
- As-tu un peu de gnôle ?
- Oui. Pourquoi ?
- Donnes-en une gorgée au pauvre gus. Il a, en plus, très faim. Il m’apparaît encore plus malheureux et plus abusé que nous. Les Russes avancent partout, ce coco n’hésite pourtant pas à nous rejoindre, ce qui est le cas d’ailleurs de nombreux autres déserteurs.
- Goladna et khotschjetsa. Faim et soif » gémit le prisonnier.
- Je me rends compte que la faim et la soif sont également un fléau chez les soldats d’en face », conclut Pausch.
Après avoir avalé une bonne rasade d’eau, le Russe sourit : « Balischoji spassiba. Merci beaucoup. » Je dis au prisonnier : « Lorsque tu seras dans nos états-majors à l’arrière, tu diras toujours que tu as étudié, que tu es un Wratschi, un docteur. Tu seras bien traité. Je vais t’écrire une annotation dans ton livret comme quoi tu es volontairement venu chez nous comme « Déserteur ». Le Russe devient subitement un autre homme, il me dit qu’il détient des informations capitales qu’il ne peut dévoiler qu’à un officier. Il me supplie d’appeler mon commissaire politique.
- Nous n’avons pas de commissaires, mais des colonels qui sont tous des gens instruits. Wratschi, que sais-tu ? Ici, c’est moi qui suis commissaire. Je veux savoir et connaître ton secret sinon tu n’iras pas à l’arrière. Je peux te tuer ! et tout de suite. » Je réfléchis.
Quel homme peut bien être ce déserteur ? Est-ce un comédien venu très habilement d’en face pour nous débiter des salades et induire notre commandement en erreur ou bien a-t -il assez soupé des commissaires et dans ce cas dit-il vrai ? Angoissé, il me répond : « Cette nuit, grosse attaque des Russes. Les 3 ème et 4ème fronts d’Ukraine vont foncer sur la tête-de-pont et détruire tout ce qui s’y trouve.
- Et toi, tu viens chez nous mais alors tu seras également détruit !
- Certes, mais vous comprenez que moi je ne veux pas mourir. Je préfère mieux déserter avec des informations primordiales qui me garantiront la survie que de croupir en face, dans leurs affreux camps de Sibérie.
- Pausch, donne immédiatement l’alarme au bataillon et dis au Kommandeur que nous détenons un très important déserteur qui signale pour cette nuit une attaque de grande envergure. Pausch, je veux aller avec le prisonnier chez le colonel, c’est important pour nous ! Hans, viens avec moi et ouvre l’œil. Camarades, attention, cela va être dangereux cette nuit. Alarme critique. Surveillez le secteur. Iwan viendra. »
Et nous descendons dans l’abri de Pausch qui transmet les précieux renseignements à l’état-major qui est établi à Cerenaïa. J’obtiens l’autorisation de ramener le prisonnier avec le mot de passe. La nuit est sombre, la buée gèle à la moustache. On file le long du boyau de communication jusqu’à la tranchée de liaison, direction le village. Le Russe m’apprend qu’il s’appelle Piotr. Il marche devant moi, j’ai ma mitraillette en position de tir, c’est plus sûr. Piotr demande : « Katoryi Tschjass ? Quelle heure se fait-il ?
- Ssitschjass Bjäss Djissjitji Wossjim Giarmanja. Il est 8 heures moins 10 en Allemagne.
- Sskoljka Äta Sajmot ? Combien de temps cet interrogatoire va-t -il durer ?
- Poltschjissa, une demi-heure.
- Karascho, Spassiba. Très bien, merci. »
Arrêtés plusieurs fois par les postes de sécurité établis dans les tranchées de liaison, nous sommes à chaque fois testés pour le mot de passe. « Die Parole ? Le mot de passe ? » demande à nouveau un veilleur tatillon sur un ton sans réplique. - Station-service. Tankstelle. J’amène un prisonnier Iwan au bataillon. » Cette dernière sentinelle, très pointilleuse, nous interpelle : « Approchez-vous ? Votre unité ? Nom ? Puis, après un temps de vérification, elle dit sèchement : « Gut, vous pouvez circuler ! »
Vers 20 heures 15, nous longeons la position de l’artillerie située près d’une grosse meule de paille, étalée juste avant l’entrée du village. Là, nous sommes attendus par une patrouille de trois hommes. Ils ont la consigne de nous guider à travers le village jusqu’au poste de commandement où je dois aller faire mon rapport au Colonel. A notre arrivée au P.C., le prisonnier est tenu à distance et ne peut pas écouter ce que je raconte. Le premier officier Ia Kalden (Ia = officier d’opérations) me répond : « Vous savez, je suis visiblement intrigué par les propos que Pausch m’a transmis par radio (cf. photo de Kalden avec son état-major).
- Je tiens à vous dire, mon Colonel, que cet homme que je ressens honnête n’est pas téléguidé par la partie adverse pour nous communiquer une fausse nouvelle mais qu’il est bien un authentique déserteur. En tout cas, c’est l’impression qu’il m’a laissé lors de son premier interrogatoire. Il est instruit et a suivi des études de médecine. Il ne veut pas mourir...

- Nous, non plus, n’allons pas le tuer, nous ne sommes pas des monstres, n’est-ce pas ? sourit le Colonel.
- Bien sûr que non, mon Colonel.
- Conduisez le prisonnier chez moi !
- Mon Colonel, j’ai une sollicitation à formuler.
- Oui et laquelle ?
- Je voudrai pouvoir assister à l’interrogatoire.
- Pour quelle raison ?
- Je pense que notre médecin transfuge parlera de manière plus confiante si je l’assiste.
- Mais, bon Dieu, parlez-vous le russe ?
- Oui, mon Colonel, assez pour lui inspirer confiance.
- Bon, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais j’y pense, je ne vous ai pas encore félicité. Vous êtes un sacré tireur de mitrailleuse, intrépide de surcroît. Une courte rafale et adieu Iwan ! L’Allemagne sans prisonnier, donc moins de problème ! N’est-ce pas ?
- Mon colonel, on peut, certes, résoudre ainsi certains problèmes mais moi j’ai un autre point de vue.
- Et lequel ? (Le prisonnier vient d’entrer, je me tais...)
- Mon Colonel, puis-je par politesse dire un mot au prisonnier ?
- Oui, bien sûr.
- Piotr, Gjärmanija Kommandant karascho Natschanilk. Pierre, le commandant allemand est un bon chef.
- A quelle heure commencent la présentation et la confrontation ? » questionne le prisonnier. Un lieutenant interprète traduit aussitôt la question au colonel. L’officier supérieur rit et me dit : « Mon garçon, vous avez bien fait. Restez avec nous ! » L’audition commence : « Vos nom, prénom ?
- A... Piotr.
- Vos date et lieu de naissance ?
- 10 avril 1919 à O...
Le colonel esquisse un sourire et dit : « dites au Russe que j’étais à O... du côté de la mer d’Azov. Je connais bien son village natal. » (Récit écrit à l’époque communiste. J .E . n’a pas voulu divulguer le nom d’origine, de peur que le déserteur et ses proches encore en vie ne pâtissent du goulag, Ndr) Etonnement évident du Russe ! Ses traits se détendent, il est poli. On sent que c’est un homme instruit. L’officier l’interroge. Après les questions habituelles : unité, grade, etc..., le colonel Kalden arrive au vif du sujet. « Demandez-lui pourquoi il s’est sauvé ?
- J’ai été élevé dans une famille religieuse orthodoxe. Mon père est ingénieur dans une usine électrique, ma mère est pédiatre. Je suis un jeune médecin et j’ai étudié à l’université de S... J’ai déserté parce que je ne suis pas un communiste et également parce qu’on m’a continuellement brimé à l’armée. Je suis médecin d’une unité du front et je n’ai aucune autorité ; cela est réglé par nos commissaires qui sont tout puissants. Nous avons des blessés graves et aucun sulfamide à disposition. On peut difficilement les soigner.
- Et les blessés allemands, qu’en faites-vous ? » Le Russe ne sait d’abord pas quoi dire, il hésite puis il répond : « D’abord nous nous occupons de nos soldats, et après des Allemands s’ils ont eu la chance et n’ont pas été tout simplement abattus. Je suis médecin et j’aide chaque être qui a besoin de mon secours. Les commissaires ont une autre opinion, comprenez alors pourquoi je ne veux plus continuer à pratiquer ainsi. J’ai ma conscience et je crois en Dieu.
- Bon et quelle est donc cette information si importante que vous voulez nous communiquer ?
- J’ai appris que cette nuit, vers 1 heure, notre grande offensive allait démarrer. La tête-de-pont de Nikopol mesure cent vingt kilomètres de long et n’a qu’une profondeur d’environ trente kilomètres de l’autre côté du fleuve (il entend le fleuve Dniepr). La 5 ème Garde va attaquer du nord en direction de Krivoï-Rog-Apostolowo. Du sud-est viendront la 3 ème Garde et la 5 ème Armée de choc, direction les ponts du Dniepr près de Lepeticha ! La 5ème Garde et les attaquants venus du sud doivent tout cisailler et tout détruire derrière le Dniepr.
- Donc une bataille d’encerclement comme Stalingrad ? interroge le colonel.
- Oui, les officiers d’état-major précisent bien que ce sera un second Stalingrad. - Si vous avez dit la vérité, je vous promets un bon traitement et votre départ vers l’Allemagne. »
Le colonel s’adresse à ses officiers : « Donnez par code secret un appel-radio à la division. Alarme au plus haut degré, une attaque russe est attendue pour cette nuit. Transmettez en extrême urgence au général d’armée Schörner. Ramenez le prisonnier en sécurité à la division, qu’il dispose d’habits chauds et de nourriture avec ma lettre d’accompagnement. Tout est O.K . ? Alors exécution ! »
Je demande au colonel s’il me donne l’autorisation de reparler au prisonnier.
- Bien sûr, vous le pouvez.
- Piotr, nadjäjussi my sskora mvidunssja ! Pierre, j’espère que nous nous reverrons bientôt !
Le Russe répond : « Ja, my ouvidimjia odin dien. Nous nous rencontrerons sûrement un jour.
- Mon colonel, puis-je serrer la main au Wratschi ?
- Bien sûr, vous le pouvez.
- Da sswidanija Piotr ! » Il pleure et me dit une parole que je n’ai jamais oubliée : « Balischoji spassiba Frantsusski. Merci beaucoup, Français. » Je me suis retourné, j’ai salué le colonel et demandé : « Permettez que je regagne mon unité ?
- Non, vous resterez ici pour cette nuit. Vous irez d’abord à la cuisine pour y manger chaud, y prendre des cigarettes et déguster du Zielwasser (liqueur de plantes aromatiques pour accentuer l’adresse sur cible), le tout porté à mon crédit !
- Merci beaucoup, mon colonel.
- Et n’oubliez pas que je tiens à rediscuter avec vous. A tout à l’heure. »
Je file à la cuisine. Il était 21 heures 30. Si je me souviens, j’ai avalé là-bas une bonne soupe de semoule (gruau) de la valeur d’une gamelle, reçu une gourde remplie de café et deux paquets de cigarettes Ernte 23. Le cuistot compte me refiler un alcool brun de seconde qualité : « Halte, non pas de celui-là, je ne le supporte pas. Le colonel m’a bien dit de boire à sa santé et sur son compte !
- Comment ça, sur le compte du chef ?
- C’estça!
- Je ne t’en filerai pas ! As-tu une attestation signée ?
- Non, mais je dois retourner le voir. Si tu n’obtempères pas, prépare-toi dès maintenant à mon rapport qui sera sans complaisance pour toi !
- Mon saligaud, tu ne t’imagines tout de même pas que je vais te servir le champagne et encore en gants blancs ?
- T’as pas besoin de m’ouvrir la bouteille, je l’emmènerai en première ligne. »
Le bougre est entêté, prétentieux et radin. Je sais bien que ces messieurs les officiers veulent être servis comme des princes, sans payer. Alors, lorsqu’il s’agit de remercier un sans-grade... Sur ces entrefaites arrive un garde qui m’appelle : « J’ai ordre de vous ramener au colonel. » Le cuistot tout affolé gémit : « Mon gars, n’ fais pas le con. Reviens tout à l’heure ! » Je me dirige vers le bunker. «Avez-vous bien dîné ? Jeune homme, je voudrai m’entretenir avec vous entre quatre-z - yeux à propos de ce Wratschi. Dites, êtes-vous acteur ?
- Non, mais pourquoi cette question, Herr Oberst ?
- Vous m’avez donné l’impression d’être très sûr de vous, que vos mimiques et vos sollicitations pour lui tirer les vers du nez allaient de soit. Vous êtes assez habile pour répéter au prisonnier qu’il sera bien soigné histoire de cerner au mieux sa personnalité et le mettre en confiance. Ne vous êtes-vous pas posé d’autres questions ?
- Si, mon colonel. J’ai d’abord cru que le bonhomme avait été intentionnellement lâché devant ma position.
- Réponse intelligente. Mais qu’est-ce qui vous permet de justifier votre interprétation ?
- D ’abord, il s’est pointé droit devant notre mitrailleuse, à l’endroit où nous n’avions pas de barbelés mais il s’est avancé à ses risques et périls au milieu des mines.
- Pourquoi aucune rangée de barbelés, Donnerwetter, nom d’une pipe ?
- Nous avons préféré ne pas en installer pour faciliter la progression de nos patrouilles dans le labyrinthe des tranchées.
- Votre glacis me paraît facilement accessible ! Vous n’avez donc aucune autre sécurité ?
- Rassurez-vous, nous avons miné le coin et installé des Entlastungszünder (E.Z. détonateur à décharge), une arme diabolique. J’ai été initié un peu avant Noël à cette cochonnerie que je trouve perfide. Nous allons pouvoir rendre pareille fourberie à Iwan.
- Ah, cela m’intrigue ? Oui, parlez-moi de cet engin !
- On creuse d’abord un trou, on y place une planche sur laquelle on positionne le E.Z. bien calé dessus, avant de remonter son ressort percuteur. Pour ce faire, on tire sur le cordon de 1,50 m, cela débloque le levier de sécurité qui libère le cliquet du détonateur. On entend le mouvement du mécanisme qui s’enclenche et qui repousse le crayon d’amorce loin du percuteur. Au bout de 90 secondes, le bruit s’arrête, le E.Z. est amorcé et l’on ne risque rien puisque le percuteur a été préalablement neutralisé par le poids de la mine qu’on a placée dessus au moment de tendre le ressort. On peut aussi poser d’autres objets dessus : bidons d’essence, caisses de munitions, cartons de rations de guerre, bref, tout ce qui attire les mains voraces de l’adversaire. Il faut bien tasser la terre autour pour éviter la détection de la machine infernale.
Quiconque va neutraliser la mine ou soulever tout objet posé dessus, libère le percuteur qui va frapper la capsule d’amorce qui provoque la détonation, le tout en une fraction de seconde ! L’onde de choc va faire exploser la mine, enflammer l’essence ou faire détoner les cartouches selon le leurre choisi !
- Comment se fait-il que vous, Français, vous vous sentiez inspiré face à une telle arme diabolique pour détruire l’ennemi alors que vous aimez ce docteur russe ? Qu’allez-vous me répondre ?
- Mon colonel, si la situation n’était pas aussi tendue, je pourrais sans doute mieux extérioriser ma pensée.
- Oh ! Continuez, nous avons sonné l’alarme extrême dans tous nos secteurs d’opérations, et de toute façon, Iwan n’attaquera pas. Votre docteur est un espion.
- Non, mon colonel, le Russe qui était devant moi a bravé le champ de mines, a baisé ma main et a quémandé de la nourriture. Cet homme n’est pas un espion. J’aurais pu le tuer. Il m’a abordé en disant «Njemiitski », je lui ai répondu de loin : « non, Français. » J’ai voulu qu’il ait confiance et voyez-vous, l’homme s’est senti rassuré. En plus, je ne l’ai pas menacé avec mon arme lorsqu’il s’est avancé. Ai -je commis une faute ?
- Non, vous êtes intelligent, vous avez analysé rapidement la situation. Je crois que vous n’êtes pas quelqu’un de brutal, plutôt sentimental, n’est-ce pas ?
- Vous me flattez, mon colonel. Je suis un Muss Soldat mais je ne déserterai jamais chez les Russes, je me le suis juré, plutôt mort dans ce cas. J’ai vu de mes propres yeux comment Iwan et ses nettoyeurs de tranchées procèdent pour tuer mes camarades qui ont été massacrés, bestialement abattus et retrouvés les mains attachées dans le dos. Vous comprenez qu’après avoir vu de telles ignominies, je puisse vous faire cette déclaration si franche. Je n’ai jamais descendu un homme sans défense ou un blessé quelconque. Je ne le ferai jamais. La foi chrétienne me réconforte et je n’ai pas perdu l’usage de la prière. Vous avez prétendu tout à l’heure que j’étais un sentimental, à juste titre, mais cela n’empêche pas un esprit de décision.
- Qu’avez-vous reçu comme instruction ?
- Je suis allé à l’école française, ensuite j’ai suivi le second degré avec des cours d’allemand, puis je suis parti au centre de formation des houillères dans la perspective d’entrer ultérieurement dans 1’école des porions. J’avais 16 ans lorsque la guerre éclata. Mes parents et moi-même fûmes évacués à l’intérieur de la France où je m’engageais dans une usine d’armement. J’ai travaillé dans une armurerie où je filetais les tubes de mortiers. Après la débâcle, nous revînmes au pays natal. Je ne voulais plus aller à la mine, je partis aux Chemins de fer (Reichsbahn).
Le soir, je suivais des cours accélérés pour pouvoir mieux maîtriser l’allemand bien que nous ayons appris en seconde française la Spitzschrift. Je devins employé-cheminot et assurai le service dans différentes gares. Début mars 1942, je passai l’Abitur que j’obtins avec une bonne note. Le 17 avril 1942 je partis au service du travail obligatoire au Reich et en novembre 1942 je fus incorporé à Fulda comme des milliers d’Alsaciens-Mosellans enrôlés de force. Déconsidérés dans la Wehrmacht en raison de notre douteuse fiabilité, nous étions malgré tout la variable d’ajustement idoine pour aller étoffer comme chair-à -canon principalement les régiments d’infanterie. Un adjudant m’a extrait de mon unité pour m’envoyer dans différentes formations. Je fus affecté à l’école d’infanterie de combat (2. Stamm Kp. Gr. Ers. Btl. 88) à Vienne en France (j’ai eu droit à l’initiation de base sur toutes les armes d’infanterie, les armes jumelées, du K1 aux tubes quadruples). Je m’activais également à la 12 ème escadrille des planeurs DFS 230 à Valence (Drôme). Je suivais les cours pour intégrer l’école des officiers. Le Service de sécurité (Sicherheitsdienst) nous a arrêtés (le capitaine Hanika, le chef-comptable von Schonberg) soi-disant parce que nous étions en relation avec la Résistance. Nous avons subi un interrogatoire musclé et fûmes emprisonnés.
J’ai naïvement répondu que j’avais fourni à toute ma compagnie du chocolat, du vin, des spiritueux provenant du marché noir. Le juge chargé de mon instruction m’a éjecté de la salle d’audience : « ou bien vous êtes réellement stupide (doof) ou bien vous êtes un traître, en tout cas vous racontez à n’importe qui tout ce qu’on vous a appris. Pour un peu, vous divulgueriez encore notre instruction sur les armements à la Résistance. (Je retrouvais après guerre M. Petitjean, chef de la résistance avec qui effectivement, j’étais en contact).
Nous fûmes transférés en Allemagne sous la constante surveillance de 3 hommes en civil et de 3 Feldgendarmen. Nous arrivâmes à Hanau où chacun d’entre nous fut auditionné individuellement. (Je n’ai jamais plus entendu parler de mes deux supérieurs impliqués). Je fus expédié dans un camp fermé et affecté à une Marschkompanie (1 Res. Gr. Btl 181). Pas de permission ! Huit jours plus tard, je roulais vers le Süd Abschnitt où je fus intégré dans la 111 ème Division d’Infanterie qui œuvrait dans le Kouban. Le1 er juin 1943, j’arrivai à Konstantinowka, puis je fis partie d’un convoi acheminé au Kouban (Inf. Pion. Kp . 9, 111 I.D .) Je disposai là-bas d’une moto Zündapp KS 1200.
Nous restâmes tout le mois de juillet et jusqu’à mi- août à Novorossisk puis dans la presqu’île de Taman. Après la traversée maritime effectuée par le détroit de Kertch, notre division pressée par l’ennemi, dut contenir aux abords de Rostov-sur-le-Don une attaque grandiose menée par des Soviétiques dotés de blindés et de troupes d’infanterie en surnombre : leur but était d’encercler notre 29ème Armeekorps autour des rives ukrainiennes de la Mer d’Azov. Faisant partie du Groupe Recknagel, nous pûmes juguler jusqu’au 30 août les tentatives des percée ennemies dans le chaudron près de Taganrog. Nous avions contre nous la 51ème Armée. Le lendemain, nous nous dérobâmes en marchant en direction de Mariopoul. Des combats très durs s’y déroulèrent. La 111 ème Infanterie Division dont je faisais partie perça à la hussarde. Un Wehrmacht Bericht mentionna sur les ondes la destruction de 273 tanks russes. Nous fûmes ensuite dirigés sur la Wotan Stellung, un simple fossé antichar truffé de tranchées individuelles le long de la steppe.
La VIème Armée put maîtriser la situation durant deux semaines mais le 9 octobre, Iwan entama la bataille à une heure inhabituelle : à 10 heures du matin, un feu infernal s’abattit durant des heures sur un front de 15 km, un obus par mètre ! Croyant à notre anéantissement, l’infanterie russe arrivant en masse fut désagréablement surprise. De la steppe labourée lui répondirent nos mitrailleuses, elles-mêmes relayées par nos obusiers secondés par les lance-roquettes. Leurs régiments s’effondrèrent et reculèrent, mais d’autres soldats rouges revinrent pour être derechef anéantis. Mon colonel, ce fut ainsi le samedi, ce fut aussi le cas le lundi, et également le mardi puis le mercredi et enfin le jeudi. Il nous fallait tenir cette ligne qui constituait le verrou sud pour bloquer l’isthme de Perekop et retarder l’invasion de la Crimée. (photo prise en compagnie de l’Oberleutnant Fritz Müller, que j’ai sauvé le 9 janvier 1944).
La férocité des combats n’avait ici rien à envier à la bestialité de Stalingrad. Les noms des champs de bataille (Bogdanowska, Oktoberfeld, Akimowka, Danilo Iwanowka) resteront à jamais gravés dans nos mémoires comme étant ceux qui furent parmi les plus sanglants de la seconde guerre mondiale ! Les Russes attaquèrent trente fois Oktoberfeld, trente fois ils furent repoussés. Malheureux fantassins oubliés, vidés de votre sang, sacrifiés pour de la folie ! Lors de notre retraite, nous subîmes d’âpres combats jusqu’au 23 octobre, jour où cessa notre résistance dans la ville de Melitopol.

Là, on peut très honnêtement dire que c’est le groupe Hake de la 13ème Panzerdivision qui nous a sortis des griffes de la captivité. « Nous étions si près de toi, mon Dieu ! Nous, les survivants, nous nous regardions. Aucun ne voulait parler, une très grande anxiété se lisait sur nos visages. Combien de temps durerait encore ce carnage ? » Le 27 octobre, nos compagnies fondues n’existaient plus. Notre unité allait être complétée par de nouveaux renforts. Retraitant vers le Dniepr, nous y apprîmes que notre nouveau Generalmajor Grüner était placé sous les ordres du Generaloberst Ferdinand Schörner. Je bénéficiai alors d’un congé de trois semaines avant de revenir dans la tête- de-pont de Nikopol.
Ecoutant impassiblement mon long monologue, le colonel ne pipait mot ; je suis sûr qu’il était au courant de ma condamnation, bref qu’il savait que j’avais à me réhabiliter. Après ce long entretien, le colonel me déclare : « Comme vous ne pouvez pas rejoindre votre section à cette heure avancée de la nuit, je vais vous faire établir un sauf-conduit (Ortsaufentaltbescheinigung) pour circuler librement dans le secteur. Que Dieu vous protège ! » Je bénéficie d’une journée de repos (jusqu’à 18 heures le lendemain).
J’ai la chance de dénicher dans un local un coin empaillé pour dormir. Que veut dire dormir ? En plein sommeil, on se réveille croyant être endormi derrière la mitrailleuse. Puis on réalise qu’on est à l’abri et qu’il fait bon de roupiller. Je ne me rappelle plus de l’heure exacte où je me suis réveillé. Tout est calme. Je me lève, prends mon casque, je me ceinture et je happe mon pistolet-mitrailleur. Des flocons de neige me saluent au dehors, la sentinelle veut savoir où je vais. Je me sens souffrant. Ma montre indique 4 heures. Iwan n’a pas attaqué, tout est calme, à part des tirs intermittents. « Retourne te coucher », prévient amicalement le garde.
 Vers 7 heures, on s’active dans la pièce. Des lève-tôt viennent de la roulante avec du café chaud ! Je pars à la cuisine, fais remplir ma gourde, reçois un demi-pain, de la margarine et un morceau de saucisse. Mon cuistot-champagneux n’est pas là. J’ai faim, hélas l’appétit n’est pas là. Pourquoi le Russe n’a-t -il pas attaqué comme l’a sacrément certifié mon docteur ?
Vers 7 heures, on s’active dans la pièce. Des lève-tôt viennent de la roulante avec du café chaud ! Je pars à la cuisine, fais remplir ma gourde, reçois un demi-pain, de la margarine et un morceau de saucisse. Mon cuistot-champagneux n’est pas là. J’ai faim, hélas l’appétit n’est pas là. Pourquoi le Russe n’a-t -il pas attaqué comme l’a sacrément certifié mon docteur ?
Lorsque je retourne au bunker, les paroles du colonel me trottent constamment en tête : « ...tu verras, Iwan n’attaquera pas ». La réalité lui donne raison. Je demande au capitaine la permission d’aller revoir le colonel ce qu’il me refuse d’abord, prétextant la surcharge de travail de l’officier. « Le caporal-chef Ernst tient à prendre congé du colonel à qui il a ramené hier soir un prisonnier de marque. » Bientôt je suis introduit chez le colon’ qui arbore un sourire malin : « Alors jeunot, et Iwan ? N’avais-je pas raison lorsque j’ai dit qu’il n’allait pas attaquer. Voyez-vous, on appelle cela la conduite de guerre psychologique et les Russes sont passés maîtres dans l’art de l’intoxication. Votre wratschi déserteur est déjà à l’état-major de la division où il est constamment cuisiné. Ou bien cet homme est un vrai déserteur et les généraux soviets en face ont compris qu’il les a vendus. Ils ont donc arrêté et ajourné l’offensive, oh ! pour un court moment puis ils essaieront de nous surprendre. 2ème hypothèse : c’est le prélude à la guerre des nerfs pour nous maintenir sous pression, en constante attention de notre part. Ils vont nous envoyer des troupes de choc et tâter notre ligne pour détecter notre artillerie.
- Mon colonel, permettez-moi de prendre congé.
- Jeune homme, vous me plaisez et le régiment me signale que vous êtes bon pour devenir un futur aspirant avec actuellement d’appréciés services. On m’a communiqué que vous avez obtenu deux insignes de chars détruits, vous avez la Croix de fer 2 ème classe et subi 29 jours d’affrontement à l’arme blanche. C’est magnifique. Quand toute cette foire aura déguerpi, je vous affecterai à mon état-major.Je tiendrai parole et compte vous surprendre, foi d’officier. »
Après le déjeuner, vers 11 heures 30, je parcours avec un fantassin de la Stabs Kpie 36 le village à la recherche d’endroits où je pourrai retrouver des camarades de relève mosellans qui étaient venus de Hanau avec moi dans le Südabschnitt en novembre 1943. La compagnie (36 IR) a quelques Lorrains dans ses effectifs et je viens leur rendre visite, tels Gilbert Simon de Metz Saint-Julien, René Bergmann et Jean Reiter, tous deux de la région de Thionville. Nous flânons dans le coin et nous nous dirigeons vers l’infirmerie pour rendre visite à un copain de Metz qui est blessé et que Simon connaît bien.
A peine avons-nous parcouru quelque cent mètres que nous entendons les bruits d’un moteur d’avion (direction à 9 heures). Un chasseur vient des lignes russes. Nous nous dispersons. Devant moi, à ma gauche se trouve une mitrailleuse anti-aérienne, installée sur un socle rond. Dans chaque localité on a installé un tel dispositif toujours prêt au tir (2 x 50 coups) pour parer à toute attaque. Je cours vers l’arme, m’installe, vise et lâche un tir continu, sur la voilure, devant le moteur. Ma gerbe semée de balles traçantes arrive droit au but. Connaissance, expérience, rapidité d’exécution et fermeté sont les aptitudes premières d’un mitrailleur responsable du sort de son groupe de combat réparti en système de quintuple doigtier (Fünf Finger Verteidigungs System). La vue du pilote dans son appareil volant en rase-mottes reste vivante en ma mémoire. Affublé de son casque de cuir, il me dévisage. Je ne veux pas le tuer puisque mes tirs sont dirigés sur le moteur. Son seul tort, c’est d’avoir cru pouvoir survoler notre secteur en un vol lent et lourd : ce sera sa perte, car un tireur de MG super-entraîné et connaissant son affaire ne laissera pas passer pareille aubaine.
Planant de 9 heures à 3 heures, l’appareil présente intégralement son flanc vulnérable. Suite à mes tirs continus, une fumée noire sort du moteur ; ce ne sont pas des gaz d’échappement produits par la relance des moteurs mis à contribution mais bien une cible atteinte grâce à cette arme providentielle. Le génial pilote peut encore se mettre en chandelle avant de sauter en parachute. Une corolle rose s’épanouit au-dessus de l’horizon sur lequel de lourds dégagements de fumée noire signalent l’impact de l’aéronef. Fier de moi, je ne savais pas qu’il était aussi facile de descendre un zinc. J’ai une pensée émue pour le malheureux aviateur, blessé ou non et qui a réussi peut-être à atterrir chez ses compatriotes. Les fantassins accourent, sortant des chaumières et viennent avec leur visage curieux me féliciter.
« De quel tas tu proviens, toi, pour déquiller un tel oiseau ? » Un capitaine s’en mêle et me demande de le suivre. Il compte annoter dans mon livret cet exploit et le faire confirmer par des témoins. « Non, je n’y tiens pas. Si les Russes me capturent, c’en est fait de moi ! Je ne cherche pas la gloriole, ni les effets d’ostentation. - Vous avez raison, jeune homme, mais il me faut vous avouer que d’autres combattants, émules de l’aigle nazi, recherchent ces attributs de prestige alors que vous n’y mettez pas un liard ! » Je retrouve peu après mes camarades mosellans. Je leur parle de l’attitude du gradé. Etait-elle réfléchie ou cynique ? Je quitte mes compatriotes au bord de leur abri et je m’annonce peu après au poste de commandement du bataillon.
Tête-de-Pont de Nikopol : mercredi 2 février 1944
Dans la nuit du 2 février, il y a un brusque changement de temps à notre grand désespoir. Comment étancher notre soif si neige et glaçons disparaissent et fondent rapidement dans la brume ? Sous l’effet d’un foehn réchauffant venu de la Mer Noire, la raspoutitsa chevauche progressivement la contrée.
Cette gadoue, d’une épaisseur de genou, - cette vase ukrainienne- ! s’étale comme un fleuve colossal de boue à l’infini. Il faut changer de position, se battre, ramper, anéantir des patrouilles hostiles et cela toujours dans cette profonde bouillie. Le gruau noir déchausse les bottes, neutralise voire arrache les chenilles des autos blindées et des tracteurs ; elle engloutit les chevaux ! Ils font pitié à voir ! Enfoncées jusqu’au poitrail, les pauvres bêtes avec leurs pattes piégées dans la boue sont abattues d’une balle dans l’oreille. Même s’ils étaient délivrés par un engin de levage, les quadrupèdes s’empêtreraient à nouveau deux mètres plus loin dans la glaise calamiteuse ! Plus aucune roue ne tourne ! Des canons d’assaut livrent bataille à l’élément-piège, avançant au maximum de 5 km à l’heure.
Pour parfaire la désolation provoquée par ce temps capricieux à la girouette, le gel insidieux s’incruste ensuite dans les lieux, figeant et bétonnant les panzers dans du marbre pétrifié. En face, le Russe n’est pas mieux loti ; de part et d’autre, chaque artillerie envoie sur l’arrière comme sur les premières lignes les notes pessimistes d’un requiem en symphonie funèbre. Le fleuve puissant, large de 1 200 mètres ne dispose en tout et pour tout, sur une longueur d’une centaine de kilomètres, que de deux passages indiqués. Comment arriver à temps pour traverser ces gués salvateurs, empêtrés que nous sommes dans cette mélasse goulue ? (Léon Laugel, cantonné en novembre 1943 à la « Kommandantur » de Boloya Lepeticha me signale l’existence d’un pont flottant constitué de barges et installé en contrebas sur le Dniepr qu’un avion russe finit par disloquer fin janvier sous l’effet d’une bombe. L’une et l’autre barge, qui avaient pu être récupérées à partir du pont détruit, assuraient en tant que «petit ferry» la relation est-ouest sur le fleuve, cf son témoignage in extenso Ndr). Stalingrad avait été la catastrophe du « Pas assez et du trop tard, Zu wenig und zu spät. » On avait trop tardé en novembre 1942 pour hâter la libération des troupes prisonnières et d’un autre côté on manquait de moyens offensifs pour soutenir la force de frappe. Le commandement suprême tomba de haut lorsque sonna le glas de la reddition de Paulus. Par contre, nous avons à notre disposition Schörner, un général hors pair, fin tacticien que beaucoup de fantassins remercient pour n’avoir pas fini comme prisonniers en Sibérie. « Si vous êtes faibles, vous contribuerez à la victoire de votre adversaire ! Ne tergiversez jamais !» répète-t -il pour forger notre courage.
Fiévreusement, les Russes nous matraquent avec leur artillerie ; die Walze, le rouleau compresseur de l’Armée Rouge ratiboise tout sur son passage comme jadis les chevaux des Huns massacreurs ! S’avançant en rangées successives, leurs fantassins déchargent un feu démentiel sur nos maigres avant-postes. Nos mitrailleuses dégorgent les salves mortelles dans la masse grouillante. Lorsque leur attaque piétine, notre feu d’artillerie prend la relève dans un tambourinage irréel. Des charges d’infanterie se succèdent, sans cesses re- complétées, dans un brouhaha démoniaque «Urräh Urräh. » Qui peut rester insensible à ce carnage ? Il m’apparaît impensable que le haut-commandement russe n’arrête pas le massacre de ses propres troupes. Face à cette hécatombe, son état-major injecte au contraire et sans relâche une humble foule de sacrifiés devant nos mitrailleuses chasseresses. Nous laissons le village de Cerenaïa pour nous établir plus loin, la localité ayant été entièrement détruite par les obus adverses. Je ne peux taire ici l’irresponsabilité meurtrière de la Stavka et la gabegie en vies humaines perpétrées sur les accotements des tranchées au milieu d’une collection incroyable d’armes de toutes catégories.
On a l’impression qu’un semeur dingue a saupoudré d’un geste rageur les graines de violence maléfiques sur les champs du chaos. Folie pure des hommes alors que toi, misérable ver-de-terre, tu es encore en vie ! L’ordre de départ nous parvient au crépuscule : « Attention dans une demi-heure, nous retraitons.» Nous sommes acheminés vers la rollbahn par un Lotsen (pilote) qui nous conduit peu après vers la Feldgendarmerie. Il faut à nouveau foncer à l’avant, la soupe gluante effiloche nos dernières forces. Le fantassin qui dispose de chaussures à lacets peut espérer les garder. Malheur aux gens bottés qui tombent dans la gadoue ! A chaque pas, il te faudra une force incroyable pour exhumer ta botte entartée et la refourguer dans la merde persistante.

Tes osselets vont s’épuiser dans la coupe visqueuse des douleurs. « Penche ton nez par terre ! Si tu regardes devant toi vers l’horizon, alors tes pieds nus te suivront orphelins de leurs coquilles et tu seras perdu, victime du gel qui t’assénera le reste ! Ton regard doit rester attaché à la glèbe, paysan ! » nous serine un sergent.
Pour garder les chaussures scotchées aux pieds, les toiles de tente sont déchirées et nouées autour des bottes. Chaque pas coûte une tonne d’effort, coûte du temps : chaque minute grignotée est si précieuse dans cette course contre la montre et pour la vie. Elende Rasputitza in einem elenden fremden Land in Mitten eines elenden Krieges ? Bon Dieu, où se trouve cette damnée passerelle qui nous débouche le chemin vers la liberté ? Devant nous, une explosion impressionnante, un éclair du tonnerre, des cris : « Sani ! Sani ! » Qu’est-ce qui s’est passé ? Est-ce un obus soviet ? En m’approchant, je distingue une lampe de poche qui s’attarde sur un spectacle de désolation : blessés et mutilés gémissent dans un décor d’épouvante. Mais qu’a-t-il bien pu se passer ? « En avant, en avant ! Circulez. Pour eux, c’est passé, le destin cruel a basculé. - Et les blessés, qu’en faites-vous ? - De quoi te mêles-tu ? Les brancardiers verront bien ! En avant, il nous faut reculer, Iwan est sur nos talons. » Pausch a réussi à nouveau à nous coller au train ; j’interchange les armes pour porter la lourde mitrailleuse de Hans qui, lui, portera mon arme légère et mon sac contenant les boîtes-camembert remplies de balles russes. « Qu’est-ce qui s’est passé, dis-moi Pausch ? - Je suppose que le cordon-tirette (Abreißschnur) d’une grenade à main s’est bien involontairement accroché à une branche épineuse. La déflagration a communiqué le feu à toute la rangée armée des fantassins. Pense à vérifier le système de sécurité des deux tiennes ! » J’en ai des frissons dans le dos. Avec sa faux macabre, la mort, souveraine, guette l’imprudent et tout cela à cause d’une toute petite seconde d’inattention. Mille péripéties émaillent ainsi le parcours semé d’embûches que ton ange gardien semble continuellement tenir éloignées de toi.On ne doit pas penser à tout ça sinon la folie nous guette. Les blessés graves qu’on abandonne dans la boue est un crime. Toi, roseau penchant sous les efforts surhumains, penses-tu décamper à temps ou seras-tu éliminé par ton adversaire conquérant ?
 Après les durs combats où l’arme blanche a prévalu dans les corps-à -corps fatidiques, nous pouvons nous sortir des pinces de la tenaille au débouché de Malaya et de Boloya Lepeticha. Notre troupe de pionniers a su faire obstacle au mot d’ordre du Maréchal Joukov : « Jetez-les tous à l’eau pour qu’ils se noient. » Notre devoir est de nous opposer, comme éléments de couverture, aux pointes de l’adversaire afin de permettre aux dernières unités allemandes de pouvoir s’esquiver de la nasse. Le bulletin journalier du général Schörner nous précise : « Compagnons du devoir, nous allons franchir le fleuve à l’endroit le plus dangereux. Le dernier fantassin devra impérativement avoir franchi le pont flottant qui conduit à l’île Katharina à l9 heures. »Notre capitaine nous sermonne : « attention, le pont est entièrement miné avec des fûts d’essence reliés à des détonateurs. Vous serez les derniers à le traverser. Mot de ralliement, Lösungswort : Katharina. Il nous faudra tous avoir l’œil ouvert et nous tenir sur nos gardes. » L’ordre de l’O.K .W . (Ober Kommando der Wehrmacht) stipule qu’il faut abandonner les blessés. A quoi répond, stoïque, Schörner : « Non, aucun d’entre eux ne restera à l’arrière ! » Sa présence physique revigore les énergies défaillantes et ne donne pas des ailes d’épouvante aux fuyards. Nous tenons ! Nous devons rester sur la rive Est afin de retarder les éléments de pointe russes, avec de faibles réserves ; nos petits groupes doivent résister ici jusqu’à la destruction du pont.
Après les durs combats où l’arme blanche a prévalu dans les corps-à -corps fatidiques, nous pouvons nous sortir des pinces de la tenaille au débouché de Malaya et de Boloya Lepeticha. Notre troupe de pionniers a su faire obstacle au mot d’ordre du Maréchal Joukov : « Jetez-les tous à l’eau pour qu’ils se noient. » Notre devoir est de nous opposer, comme éléments de couverture, aux pointes de l’adversaire afin de permettre aux dernières unités allemandes de pouvoir s’esquiver de la nasse. Le bulletin journalier du général Schörner nous précise : « Compagnons du devoir, nous allons franchir le fleuve à l’endroit le plus dangereux. Le dernier fantassin devra impérativement avoir franchi le pont flottant qui conduit à l’île Katharina à l9 heures. »Notre capitaine nous sermonne : « attention, le pont est entièrement miné avec des fûts d’essence reliés à des détonateurs. Vous serez les derniers à le traverser. Mot de ralliement, Lösungswort : Katharina. Il nous faudra tous avoir l’œil ouvert et nous tenir sur nos gardes. » L’ordre de l’O.K .W . (Ober Kommando der Wehrmacht) stipule qu’il faut abandonner les blessés. A quoi répond, stoïque, Schörner : « Non, aucun d’entre eux ne restera à l’arrière ! » Sa présence physique revigore les énergies défaillantes et ne donne pas des ailes d’épouvante aux fuyards. Nous tenons ! Nous devons rester sur la rive Est afin de retarder les éléments de pointe russes, avec de faibles réserves ; nos petits groupes doivent résister ici jusqu’à la destruction du pont.
C’est une des tâches les plus difficiles qui m’ait été imposée : faire partie de l’arrière-garde aussi longtemps que possible face au danger. Quand pourrons-nous déguerpir de Lepeticha, souricière au nom poétique où le gros matou rouge tend ses griffes pour chercher à nous harponner ? Quand aura-t -on l’autorisation de filer à fond de train ? Sera-t -il alors trop tard pour rejoindre les portes du salut ? Quelle responsabilité pour le chef des pontonniers car il est seul pour décider, tout seul en son âme et conscience pour garder ou faire sauter le sentier de la fuite ! Restera-t -il des camarades piégés par l’explosion du pont et qui subiront le sort atroce réservé aux vaincus ? Serons-nous du lot ? Il doit être l8 heures. Nous sommes couchés non loin d’une petite maison isolée ; les ombres prennent des allures fantasmagoriques lorsque la lune s’extirpe des nuages bondissants. J’aperçois dans la pénombre une forme qui se meut autour de la maison et observe.
Comme un chat sauvage, je me glisse vers la silhouette. Je ne dois pas tirer. Faut-il la neutraliser à l’arme blanche ? Calme. Sois calme. Tout se passe d’une manière folle, presque comique au vu de la situation plus qu’angoissante. Je hurle à l’inconnu : « Stoï, ruckiwersch. Stop, haut les mains. » Je lui plante le P.M . dans le dos, le type s’écroule : « Towaristsch niemski ne stre latzte. Ami allemand, ne pas tirer. » C’est un vieil homme qui porte une longue barbe blanche. Je lui dis énergiquement : « Mnjä uji wranitsja. Dawaï da ssmilania. Votre attitude ne me plaît pas, déguerpissez. Au revoir. Krassnayä armee jassti bÿi tut pablyisasstji. L’Armée Rouge est dans les environs. » Je ne suis pas content de la négligence coupable du vieux moujik car sans mes réflexes, j’aurais pu appuyer sur la détente : une vie humaine a si peu de prix surtout en ces instants tendus à mort. Cela prouve bien que c’est la froide domination de l’être humain sur ses sens et ses actes qui lui fait garder les idées claires, sinon le coup de feu serait parti depuis belle lurette. C’est pareil avec le poignard de tranchée, -le Grabendolch-, muet, efficace dans ses œuvres et si utile la nuit. On ne tire avec son arme que dans les situations désespérées.
L’homme dit encore : «Schisskajedno Woyna. Maudite (merdique) guerre. » Un sifflet retentit : « Pointe-toi, Ernst ! commande le lieutenant Netzer. Que s’est-il passé ? J’ai cru avoir perçu des voix et je pensais qu’Iwan était derrière nous. - Non, il s’agit d’un vieillard qui se promenait, je l’ai pisté et lui ai dit de rentrer dans sa maison. Tout est en ordre, mon lieutenant. - Ernst, tu files à cinquante pas d’ici, tu t’occupes de la M.G ., tu rassembles les hommes qui y sont. C’est le moment de filer le long du fleuve. Fais attention, il y a une rive abrupte avec des parois rocheuses. Tu conduis l’avant-garde, moi je clos la marche. A 19 heures précises, nous devons être au bord du versant. Mot d’ordre Katharina. Bonne chance, Ernst ! Allons-y . Exécution. » Sans bruit, je me glisse vers la M.G . et je rameute mes gars. « Attention ! la rive escarpée est dangereuse. Je marcherai devant. Si je dois tirer, restez tranquilles et demandez au lieutenant de rappliquer vers l’avant. Bonne chance comme sur la planète Pluton ! Que tout le monde me suive et de grâce que je n’entende pas vos castagnettes ! » Je me faufile dans les coins sombres que prête le terrain pour me confondre avec la nuit. A droite, sur un mamelon, on entend du bruit. Peut-être est-ce des troupes de couverture comme nous ? « Direction, pont de bateaux ! Attention ! C’est très pentu ici ! Soyez prudents, nous arrivons à la rive. »
Soudain un ordre court est lancé par une sentinelle : « Mot de passe ! - Katharina. - Ap prochez-vous ! Qui êtes-vous ? - Troupe de pionniers Netzer ». Le lieutenant rapplique aussi et confirme par radio : « Arrière-garde au complet, elle est au rendez-vous comme promis.» Un officier artificier donne des ordres : « Les gars, vite, foncez sur le pont. Attention, l’un derrière l’autre. Vite, nous allons tout faire sauter. » Le pont monté sur boudins pneumatiques est interminable, très étroit avec des fûts d’essence alignés à notre droite. Nous arrivons bientôt sur une île. Nous entendons alors des cris féroces qui proviennent du haut des berges. Si Iwan a attaqué aussi vite, c’est qu’il a rampé derrière nous pour nous couper la route. « A l’abri, couchez-vous ! » Les Russes descendent en hurlant vers la rive. Des fusées blanches illuminent un décor spectral. L’ennemi lance également des lucioles qui se balancent lentement au-dessus du fleuve.
Des Russes courent sur la passerelle. Une surpuissante détonation retentit ; les tonneaux sont propulsés en l’air et explosent dans un ouragan de feu. Des cris, des cris au milieu des flammes. Le bras du fleuve devant l’île est baigné par les flammes claires ; la rive enflammée grésille au milieu de continuelles détonations. Nous remontons vers l’autre berge et tombons sans arrêt sur des postes de garde qui nous indiquent le chemin à prendre. Je n’ai plus la notion du temps pour me rendre compte de la longueur de la course que nous avons effectuée sur l’île avant d’arriver aux canots et petites barges chipés à l’ennemi par une de nos escouades. On y trouve assez de place pour s’y coincer. Vite ! Il faut hâter le passage. Les moteurs rugissent, le bac tremble sur le fleuve rapide. Est-il large de 800 mètres ? de 1 200 mètres ? Derrière nous se profile un paysage haut en couleurs flamboyantes, aux teintes rouge-feu de la guerre. Je repense au bûcher de tout à l’heure. Pauvres bougres ! mais nos pionniers n’avaient plus d’autre alternative que d’appuyer sur le détonateur. C’est à peine croyable, nous avons réussi à passer entre les griffes de l’adversaire. Le ronronnement sourd de l’esquif prédispose à la somnolence. Soudain une vibration plus forte nous indique que les hélices de la barge amorcent leur freinage ; nous approchons de la rive. Un choc important se produit, tout l’équipage est propulsé comme une plume vers l’avant. Le bac vient d’accoster. Des appels fusent : « Pioniertrupp Netzer, au rassemblement. » Des guides nous indiquent le chemin à suivre. Nous avançons sur une rive sablonneuse, des vaguelettes se renouvellent devant nous, sur la grève. De l’autre côté du fleuve montent des lucioles dans un décor irréaliste. Après une demi-heure de marche, nous arrivons dans une gorge impressionnante. Ici on va passer la nuit et assurer la garde. Des tours de ronde sont installés ; la rotation des hommes se fait toutes les heures à cause de notre épuisement. J’ai pu dormir d’une traite continue tout comme le chef de section. Reiner nous a réveillés.
4 février 1944
Il fait déjà clair à notre réveil. Pausch l’ancien me propose de venir avec lui sur la rive. « Pour quoi faire ? - Ne pose pas trop de questions ! » Au sortir du ravin, s’étend une rive sablonneuse plate. « Vois-tu, Jean, nous allons nous laver les mains et le visage, ici. Tu pourras plus tard dire que tu t’es lavé dans le troisième plus grand fleuve d’Europe, après la Volga et le Danube ! - Et Iwan, de l’autre côté ? - I l est trop loin avec son armada. Il est bien trop occupé ailleurs pour réaliser un nouveau pont. Aujourd’hui, il ne viendra pas. Comme son principal passage est détruit, ses panzers ne peuvent pas encore débarquer chez nous. - Iwan va essayer de nous couper du gros de la troupe et faire parachuter des commandos sur notre rive, dis-je. - Les principales poussées seront faites au nord et au sud pour nous couper la retraite, comme les mâchoires d’un étau. Tu te rappelles de notre exercice précédent, l’opération Wotan ? Eh bien ! L’ennemi va procéder de la même façon : nous abreuver de coups incessants pour chercher à nous mettre groggy debout !
5-6 février 1944

Notre groupe de combat se trouve mêlé à d’âpres et difficiles combats d’arrière-garde dans le bas Dniepr. A côté de mon poste de mitrailleuse, dix hommes et un lieutenant se tiennent dans le fossé. Ils fument une dernière cigarette. Devant nous s’étendent un marécage et une forêt. Très tendus, nous scrutons l’obscurité. « Dans une heure, prévient le lieutenant, nous voulons être de retour. Faites bien attention de ne pas tirer sur nous lors de notre rentrée au bercail. Le mot de passe est Essig (vinaigre). »
Les voilà qui franchissent la tranchée et partent dans la nuit, l’un derrière l’autre. Une heure se passe. Au bout de deux heures d’attente, encore rien. Et toujours rien au bout de trois heures. Inquiets, nous écoutons le moindre bruit pouvant provenir du Vorfeld. Et voilà que des fusées éclairantes fusent dans le ciel, des grenades explosent suivies de tirs au pistolet et de fusil. Pour sûr, l’ennemi vient de tomber sur la pauvre escouade.
Aucun des onze ne revient. Ce détail, -cette perte minime en hommes-, n’est pas rapporté dans le compte-rendu journalier, ce n’est finalement qu’un jour sans événement particulier vécu dans le bas Dniepr !
7 février 1944

Notre position est devenue intenable. Iwan arrive avec tous ses moyens. Le caporal-chef Golke de Haute-Silésie est couché par terre et gémit doucement : « Emmenez-moi donc... je veux rentrer chez moi. »
Je me penche sur lui : « Agrippe-toi fermement à moi, reste calme, nous ne t’abandonnerons pas. » Mais Iwan se profile devant nous sous la forme d’innombrables ombres humaines. Je prends mon C 96 et tire au hasard dans la nuit. Je tire pour sauver la vie de mon camarade. Les autres emportent le blessé vers l’arrière.
A l’aube, nous sommes couchés dans une tranchée comme unité de soutien. Et voilà subitement qu’une chose, - une grenade à main !- cliquette sur la lame de ma bêche. Si d’aventure elle explosait à cet instant, tout serait perdu. Vite, un coup sec comme un réflexe salvateur et aussitôt elle s’envole au-dessus de notre position de couverture pour exploser dans la foulée. La cochonnerie de guerre reprend. Le lieutenant prépare sa Kampfpistole à fusée.
Debout ! On vérifie si les cartouches des fusils sont bien engagées ; les mitraillettes collées au flanc sont prêtes pour la pétarade. En avant ! Auf geht’s. Un sifflement strident sort du sifflet à roulettes et nous fonçons vers l’avant.
La tranchée est toute proche de nous, les têtes des Russes offrent des mimiques angoissées et grimaçantes. Ils tirent sans réussite sur nous. L’un d’eux dirige sa Mpi (Maschinepistole) sur moi, je suis plus rapide et je fais feu. Partout s’entendent des cris étouffés et des gémissements. De fortes respirations pour reprendre souffle nous accompagnent dans la tranchée conquise ! Les minutes qui suivent sont longues comme des heures. Nous sommes debout dans le fond de la tranchée et tremblons de tous nos membres.
Devant mes yeux, ma baïonnette est rouge de sang. Mes dents crissent, ma bouche est pleine de sable. « Qu’est- ce qui ne va pas, Ernst ? » me demande le lieutenant Bauer. Brisé par la tension intense vécue, je ne peux pas parler, je secoue la tête, je balbutie : « tout est en ordre, la tranchée est prise. » L’un de mes compagnons est livide, ne contrôlant plus ses mouvements pareils à ceux d’un épileptique. Le gradé me tapote paternellement l’épaule : « plante-toi dedans, nous allons devoir nous attendre à une contre-attaque. » De sévères combats ont lieu devant et derrière nous, nous avons libéré in extremis un pionnier qui pleure de joie et rend grâce au Bon Dieu. Les Russes ont percé et verrouillé la poche et ils essaient de nous culbuter et surtout de nous anéantir.
Atrocités russes

« Pas de survivants, tout est à détruire », voilà ce que stipule l’ordre des commissaires clairement diffusé par les haut-parleurs. Parfois même, on entend la voix de l’instituteur Stresow de Berlin, membre du Comité National de l’Allemagne Libre sous la direction de Paulus. Une autre fois, une voix féminine qui nous encourage à déserter s’écrie hors d’elle : « Je maudis les cochons nazis et vous souhaite de crever tous (verrecken). » Chacun de nous sait qu’un déserteur est voué à une mort atroce : il est d’abord humilié, corrigé puis s’écroule frappé d’une balle dans la nuque.
Iwan est en marche et sa machine d’extermination fonctionne sans problème. Un de nos gars que nous avons pu libérer par suite d’un coup de main sanglant nous raconte ce qu’il a vu. Le camarade miraculé témoigne : «Devant une des maisons de Nowo-Alejandrowka siégeait une femme-commissaire, elle était attablée, sûre d’elle comme tout chef imbu de sa personne qui veut en faire voir à ses subordonnés.
Les prisonniers devaient répondre aux questions : « Nom ? Prénom ? Quel régiment ? Nom des officiers ? etc... » Devant la table, il y avait un seau plein de nourriture. La dame-commissaire désignait le récipient : « Si toi dire vérité, toi manger. » Devant elle, le quidam captif essayait de répondre du mieux qu’il pouvait, elle lui donnait ensuite l’ordre de se pencher par terre pour bouffer comme un cochon. Alors l’un des gardes s’approchait par derrière et le tuait d’une balle dans la nuque.
Après chaque interrogatoire, les corps inconnus étaient enlevés les uns après les autres. Ce fut au tour du rescapé de passer à la casserole. A nouveau les mêmes questions suivies des mêmes réponses. La commissaire baragouinait un allemand haché : «si toi dire la vérité, si toi pas mentir, toi pas mourir, toi manger. » Notre malheureux, tremblant de tous ses membres et en pleurs, ne détenait aucun renseignement et vomit d’effroi à la vue du sang qui badigeonnait les chaussures de la Politruk. Par je ne sais quel miracle, il échappa à l’élimination. Un coup de pied et au suivant ! Il fut conduit dans la maison et il entendit à nouveau un coup de feu. Il en déduisit que c’était un commando de la mort qui pouvait anéantir impunément, sans réaction aucune des officiers présents. Je suis sûr que dans l’Armée Rouge comme chez les Allemands, ces atrocités étaient interdites et cependant on les laissa se perpétrer. Il y avait des supérieurs aveugles et muets ; cela aussi pourrait constituer un chapitre précis abordant les horreurs des saigneurs de la guerre !
8 février 1944

Aujourd’hui, les groupes de combat Zimmer et Lorsch attaquent Apostolowo. Le but à atteindre est la gare de Tok-Apostolowo. J’appartiens au groupe Mieth : notre mission est de pénétrer profondément dans la percée ennemie et de la bousculer. Soudain survient le dégel ! La boue, cette damnée merde ukrainienne, est profonde de la hauteur d’un genou et d’une viscosité collante incroyable. Tout s’enfonce, hommes, chevaux, locos, panzers ! Ayant dû abandonner nos godillots troués, nous entourons nos bottes avec des lanières provenant de la toile des tentes. Sont mieux lotis tous ceux qui disposent des chaussures à lacets. Les bottes non ceinturées restent enfouies dans la glèbe, comme retenues par une main géante. Avec des unités de la 3 ème Gebirgsdivision et de la 97 ème Jägerdivision, nous surprenons les avant-pointes ennemies qui s’étaient déjà aventurées loin d’Apostolowo, nous rejetons une partie des éléments de la 8 ème Garde hors d’Apostolowo et faisons encore une énorme quantité de prisonniers. Le bulldozer russe essaie furieusement de percer mais il est arrêté. Avançant parallèlement à nous et constituant le poing gauche du coup de boutoir allemand, la 24 ème PzD (Panzerdivision) va chercher à son tour à réduire l’avancée ennemie de la 8 ème Garde qui avait dépassé Apostolowo et à verrouiller la percée de l’adversaire rouge devant le fleuve Ingulets. Ô mon Dieu, que se passera-t -il avec les nombreux blessés couchés dans la neige fondue ? Les troupes de choc russes ne prendront pas de gants avec les malheureux ! Le sort va leur être cruel car nous n’avons plus d’infirmiers. Et toujours l’on entend le cri déchirant « Infirmiiier ! Infirmiiiier ! » Ce sont des cris insupportables, et tu ne peux rien tenter pour les aider. Aussi longtemps que tu possèdes des munitions, tu peux espérer ralentir l’avancée du redouté Iwan. Je suis en plein doute devant le surnombre ennemi qui attaque sans s’accorder de pause.
Jeudi le 10 février 1944
20 heures. Pas de lune. Neige. Lugubre nuit froide en perspective. Notre troupe chemine sans bruit le long des positions russes. Nos vestes camouflées blanches nous rendent invisibles. Nous évoluons sans un mot, sans un coup de feu. Nous entendons les Russes s’entretenir dans leur point d’appui. Ils ont réussi à franchir en fin d’après-midi le fleuve avec deux canots à moteur et à escalader la rive escarpée. Nous les avons observés, sans tirer pour ne pas dévoiler notre position. Mais les Russes ont remarqué quelque chose. Un garde hurle : « Stoï, Parole. » Notre lieutenant Netzer crie : « allons-y. » Nous faisons feu en courant, leur place est investie. L’arme blanche, c’est l’atout. Celui qui résiste est éliminé. Nous submergeons la base russe : cinq morts et sept prisonniers de leur côté. Nous déplorons trois blessés, dont un grave (blessé aux poumons). Les armes de l’adversaire (surtout les pistolets-mitrailleurs avec leurs cartouchières rondes) sont appréciées ; nous les gardons ainsi que leurs sacs remplis de cartouchières de réserve. Nos fusils sont fracassés sur les rochers. Nous chapardons également leurs grenades que nous accrochons autour de nos ceinturons. La grenade quadrillée russe qui ressemble fort à notre grenade lisse (Eihandgranate) est reconnaissable grâce à sa goupille de sécurité sur le haut. La nôtre, plus encombrante à manier, dispose d’un couvercle qu’on dévisse en bas et qu’on lance comme une grenade à manche, après la rupture de la cordelette.
11 février 1944

Nous sommes positionnés le long d’une hauteur (finalement pour quel résultat !) serrés au point qu’il nous est impossible d’avancer. Le Russe nous tire à bout portant comme sur le champ de foire. Plus d’espoir, tout est plat, aucun abri. Je suis couché sur le dos, entre deux morts que j’ai attirés vers moi. Une protection bien mince mais suffisante pour faire bloquer les balles dans les corps sans vie de mes camarades. Venant de la direction 17 heures, les orgues-de-Staline nous apportent leurs salves mortelles. A quelques centaines de mètres de mon emplacement, j’aperçois le départ des fusées pointées droites au firmament (à 85 degrés). Lorsqu’elles ont plafonné, j’observe la vrille qu’elles amorcent dans un hurlement et un craquement inqualifiables. Les impacts ne font pas de gros cratères, mais rasent tout dans un rayon de dix mètres.
Contre les obus à compression (Pressluftgranate) aucun corps humain n’est taillé pour surmonter leurs effets dévastateurs ; les habits sont déchirés, le sang coule de la bouche, du nez et des oreilles. L’ennemi va faire rappliquer son infanterie tantôt, lorsque la boucherie sera à son comble. Des pièces d’artillerie détruites sont disséminées partout. Derrière un canon automoteur, de petits groupes de notre infanterie s’avancent pour recueillir les survivants. Les canons d’assaut sur chenilles (Sturm-geschütze) proviennent d’une formation blindée de montagne. Rapides, efficaces, les tueurs-de-chars tirent au milieu des lanceurs russes. Les camarades qui nous sauvent descendent des structures, empoignent les blessés qu’ils chargent sur les canons d’assaut : « Attention. Agrippez-vous, nous fonçons vers Marinskoje ».
Ouf ! il était midi moins une ! Nous avons été remplacés par une unité de la 3 ème division alpine venue de Gruscherwka. A peine ai-je eu le temps de souffler que j’apprends que nous sommes à nouveau encerclés. La 5 ème Garde est sur nos talons et a percé près d’Apostolowo (à droite de nous). La 3 ème Garde attaque frontalement au sud, et fonce vers l’Ingulets (fleuve) pour se réunir à la 5 ème . Sur notre droite, le puissant Dniepr coule au milieu des marais. Nous sommes déposés non loin de Marinskoje et partons nous retrancher sur une hauteur dominant le fleuve. Un bruit que je crois reconnaître s’amplifie bientôt. « Peut-être des tanks », me dis-je. La pétarade s’accroît, je vois effectivement apparaître des canons d’assaut allemands peints en blanc qui s’installent derrière le coteau (direction 9 heures) en crachant férocement leur feu tout en s’approchant de nous. Je vois distinctement les coups directs provenant des pièces soviétiques.
Peu de temps après, les Stormovik nous attaquent et font des piqués de vautours. Leurs tirs sont paralysants. On distingue l’éclatement lumineux des balles de 20 mm qui frappent bruyamment le sol ; ça tonne autour de moi. Les lourds avions invulnérables remontent et se cabrent dans un vacarme indéfinissable avant de lâcher leurs bombes à fragmentation. Non loin de moi vrombissent les panzers de tout à l’heure. Distance 200 mètres. Voilà les Stormovik qui piquent sur les tanks : c’est un feu d’enfer ! Deux tanks brûlent. Torche vivante !
Cette scène horrible persistera à jamais devant mes yeux. L’un des tankistes parvient à s’extraire du cercueil embrasé, court vers moi les deux bras étendus, vraie Jeanne-d ’Arc en flammes. Ses yeux immenses d’où s’extrait sa vie arrachée percent l’auréole des flammèches qui le consument, il rôtit dans sa propre fournaise. Cherche-t-il mon secours ? Je prends mon PPsh aux 71 coups (arme russe très efficace) et je tire sur le Panzermann qui avance inexorablement vers moi.
Avec son aspect de ramoneur momifié, il titube sous la rafale, se redresse mais ne tombe toujours pas. Une nouvelle dose et le voilà qui s’agenouille à mes pieds, poupée de charbon de bois désarticulée, qui se désagrège bientôt en brandons gris-cendre sanguinolents. Seigneur pardonnez-moi cette offense à votre créature, mon ami, chair comme ma chair ! Le malheureux à qui j’ai abrégé les souffrances faisait partie de la 17ème Panzerdivision.
12 février 1944
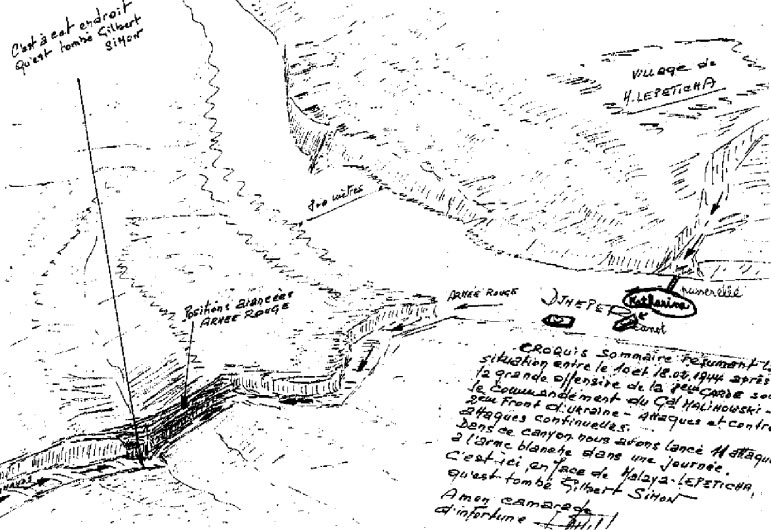
Après avoir vu sauter la passerelle, pris pied sur l’île de Katharina, traversé en bac à moteur le fleuve et tenu la dragée haute aux lances ennemies, on nous demande maintenant de tenir tête à la puissante avant-garde russe dans les défilés. Dominant les hauteurs naturelles, nous avons une vue splendide sur la basse vallée du Dniepr, progressivement grignotée par les avancées ennemies qui profitent du couvert qu’offrent les ravins de la vallée. J’ai ainsi dû participer à dix contre-attaques (à la 11 ème j’étais seul) pour retenir les chasseurs de tête adverses. Imaginez-vous une vallée encaissée et étagée, comme le canyon du Colorado. La terre meuble, lessivée durant des millénaires, a fait place à des plates-formes sur lesquelles se sont installés les snipers russes. A chaque attaque, nous stabilisons la ligne de front et bloquons provisoirement leurs forces d’intrusion. Que de morts inutiles pour ces parcelles sans histoires ! Les parois lisses des falaises, vous le savez, ne présentent pas d’anfractuosités pour s’y planquer et faire le coup de feu. Il faut simplement avancer dans la gorge, culbuter à la grenade et au poignard la tranchée russe et culbuter mort ou blessé à son tour, avant, après ou pendant l’assaut.

Beaucoup de camarades tombent de vie à trépas (Jean Reiter de Soetrich, René Bergmann de Hagondange).
J’écrirai plus tard à la maman de mon meilleur ami que son fils Gilbert fut tué sur le coup par une balle en pleine tête : or, je le vis mourir misérablement, il se vida de son sang par le fait d’un éclat en plein ventre. A l’attaque, pas d’état d’âme ! A chaque opération, je me retrouve miraculeusement épargné. Les sifflements autour de ma tête me font l’effet de bourdonnements malfaisants.
Je cours sur le tapis ensanglanté des copains, j’en reconnais quelques-uns. Vorwärts ! Ils sont devenus fous, nos officiers ! Le fond de la vallée est hérissé de rochers et d’excavations creusés par les eaux de ruissellement. Le Lieutenant nous rassemble après chaque attaque.
« Hier her ! Auf meinem Kommando, zum Angriff. Par ici, tous ! A mon commandement, à l’attaque ! » Lui-même se joint à notre groupe, calé en dernière position. Je rejoins sous les tirs ma compagnie décimée, mais pour un bref répit. « Allez, hop ! Vorwärts ! » hurle notre gradé, le dos courbé derrière un rocher.
« S’il continue à nous envoyer à l’abattoir, je vais me mutiner et abattre ce donneur d’ordre planqué » jure entre les dents un fantassin inconnu. Une nouvelle vague dont je fais partie doit aller à nouveau se sacrifier ! A un moment, j’ai devant moi un commissaire politique, un homme à la carrure épaisse.
Son visage est à trente mètres devant mon visage, un visage aux gros sourcils, une de ces gueules qu’on n’oublie pas. L’homme à l’uniforme bleu soulève de l’index sa casquette frappée de l’étoile. Il observe à la jumelle le panorama sanglant. Pan ! une balle de ma part à ce moment et adieu futur chef d’état russe !
Adieu, Brejnev ! Mais je savais que si je le faisais, je serais rayé de la carte des vivants. Un commissaire politique doit être vengé, quel que soit le prix du sang à payer ! Adieu Brejnev ! Tout porte à croire que l’illustre personnage se trouvait en ces lieux.

Sa biographie que j’ai consultée indique bien qu’il a œuvré en première ligne au Kouban et dans le Südabschnitt. Léon Zitrone que j’avais consulté m’avait conseillé de lui écrire. Le courage et un manque d’appui politique m’ont fait défaut. Dommage...
Copie de la photo trouvée dans les bagages abandonnés par un commissaire politique sur la presqu’île de Taman fin juillet 1943.
Brejnev, était-ce toi ou ton sosie ? Positionnée face à la presqu’île de Kertch, Taman était entièrement encerclée par les Allemands. Les soldats russes y ont bravé l’étau adverse, et surtout la faim avec quelques poignées de graines de tournesol pour survivre et ne se sont pas rendus. La vallée de la mort, un fond de vallée abrupt où reposent tant de porteurs d’eau de chaque camp, est devenue tristement célèbre. On a retrouvé dans les papiers des prisonniers russes des empreintes de patato-tampon. Il précisait que l’heureux détenteur de ce sigle « a combattu dans le petit pays (Malaja Semlija) des grands héros. » Verdunograd ! J. E. A la onzième fois, j’ai anéanti seul à la grenade une patrouille russe. Avant cette dernière contre-attaque, j’avais pu m’abriter dans un trou naturel (une marmite creusée par les galets) assez profond surmonté d’un bosquet. L’angle de tir restreint ne permet pas aux tireurs d’élite russes de m’atteindre. Leurs coups ajustés passent au millimètre près le long et autour de mon casque. Je constate que ce sont des balles provenant d’une arme automatique qui m’encadrent, car elles arrivent par rafales. Je fais le mort. Sans espoir de retour, j’attends le jugement dernier. « Zip, Zip », je me mets d’abord à compter les impacts de balles s’enfonçant tout près de mon casque protecteur. « Zip » à un centimètre de mon crâne. Je me fais tout petit. « Zip, Zip » le souffle passe près de ma tempe.
Je me tasse et je me ratatine. « Zip, Zip, Zip, Zip » les balles creusent à côté de ma tête un trou sans cesse agrandi. « Zip, Zip », à chaque impact, de la terre et des bouts de silex giclent, frappent mon casque inerte et me recouvrent d’une chape protectrice. Je fais ainsi le mort durant une longue heure, acteur-né sans le savoir. En face, le tireur satisfait d’avoir inscrit un x...ième Niemetz à son tableau de chasse laisse tomber ses jumelles. Les tireurs d’élite s’ingénient à cartonner partout où la présence d’un soldat teuton le trahit. Pourquoi vouer une telle haine à son ennemi jusqu’à lui envoyer soixante-dix balles ? Pour en faire de la chair à pâté matérialiste ? Je devine, non loin de moi, la présence d’un irréductible Allemand, qui, à lui seul, veut tenir le Monde ! Petit présomptueux mais qui me sauvera du couperet de la faux mortelle tout à l’heure. Un moment d’inattention du chasseur patenté, vlan ! Vif comme l’éclair, j’exécute un roulé-boulé. Me voilà courant dans le fond plat, pan ! pan ! Les mitrailleurs surpris ratent lamentablement la cible. Sauvé pour l’instant, je me retrouve au fond d’une providentielle anfractuosité mais qui pourrait se retourner en souricière mortelle. La nuit approche. Le coriace Allemand qui planque dans son repaire continue à faire tout seul le coup de feu. Des ombres ennemies se profilent et s’avancent dans le décor.
Que faire ? Se rendre à des cosaques, c’est la mort assurée. Les bonnets-de- fourrure se concertent. Des lucioles blanches illuminent les falaises. Il me faut agir rapidement : balancer la première grenade devant, la seconde et la troisième au milieu du paquet et avec l’effet de surprise créé, bondir hors de la cavité et mitrailler le reste. La vie est à ce prix ! Rapide comme l’éclair, j’agis en conséquence. Je cours au milieu de la patrouille interloquée. Je cherche encore à m’emparer d’une mitraillette russe qu’un blessé (ou mort) serre dans ses mains revêches. Peine perdue, sous les balles, je rafle le bonnet d’astrakan d’un cosaque et je file vers l’arrière. Tenant toujours la « baraque », l’intraitable Stabsgefreiter (caporal-major) vissé comme l’huître dans son recoin inexpugnable m’interpelle. Je lui signifie que je viens d’éliminer une patrouille. « Tu n’as pas entendu le raffut ? - Gut, sehr gut, sauve-toi. Je te conseille de lâcher ta prise de guerre. » En me jetant au loin le couvre-chef, il ajoute : « Oui, mon gars. Les Russes sont sans pitié pour le détenteur d’une telle chapka de prestige. Vas-y ! File par la crevasse perpendiculaire ! - Adieu, cher inconnu qui m’a prêté main forte ! » L’héroïsme banal n’est pas un vain mot. Nous serons finalement 5 rescapés (dont 2 survivants de l’Inf. Pionier Komp. 52, le Stabsgefreiter et moi-même) de l’une des péripéties de l’opération appelée « Damenwahl, au choix des dames » !
13 février 1944

Ce jour-là, j’ai sauvé un pilote allemand du Jagdgeschwader de Rudel, l’as des as. Je vais vous en narrer les circonstances. (Ndr : Rudel écrit à ce sujet : « Un vent glacial soufflait chaque jour sur le pays, la température tomba à -20-30 C°. Notre 1er Schwadron était stationné depuis quelque temps à Slynka, au nord de Nowo Ukraïnka. Lors d’une sortie vers l’est, le Flg/offizier Fickel fut contraint d’atterrir après avoir été atteint par des tirs. Le terrain où il avait touché terre s’avéra propice pour rejoindre son avion abîmé, je parvins avec ma machine volante à le prendre à bord comme mitrailleur arrière. En peu de temps, nous fûmes de retour ; le malheureux perçut un nouvel appareil..... »)
Au moment des faits, notre unité se trouve sur les berges à l’ouest de Marinskoje. En ce début d’après-midi, venant de la direction 9 de ma gauche (cf. se référer à la position des aiguilles d’une montre), un Ju 87 (Stuka) survole à basse altitude nos tranchées. De la direction 12, surgissant de devant, un Yak tire sur le Stuka et disparaît dans mon dos.
Après son virage, le Yak s’apprête à réattaquer et revenant de la position 6, il déchire l’empennage allemand si bien que les membrures de l’assemblage apparaissent avec le restant des signes représentant la croix gammée. Le pilote russe, après une boucle revient à la charge, mais ne tire point. Il cherche à faire atterrir le Stuka. Soudainement, le Yak fait un looping – une acrobatie splendide !- et revenu derrière sa victime, cherche à lui faire sentir le plancher des vaches.
J’appelle le tireur n° 2 pour caler la MG sur ses épaules et mets le Yak en joue. Les deux avions volent bas, tout va aller vite. Aujourd’hui encore, je vois les deux équipages, surtout le pilote russe avec son bonnet de cuir. Je suis absolument sûr qu’il m’a localisé. Mon tir fuse, imparable ; je sais à la traînée des traçantes que je tape dans le mille.
Pausch m’a toujours recommandé de partir à la collecte des traçantes et d’en insérer une à chaque cinquième cran ce qui permet de voir la trace des balles perforantes. Le Yak remonte avec une fumée épaisse et file vers les lignes russes.
Remarque : ce n’était pas de la fumée classique mais bien un fort dégagement noir qui prouvait que le moteur était touché. Je reste convaincu qu’un as russe était à bord et qu’il essayait de désarçonner l’aviateur allemand soit en le faisant poser près du fleuve soit en l’entraînant vers les lignes amies. Balischoji Spassiba Towaritsch !Dommage que l’Armée Rouge ne puisse présenter de tels gentlemen, la guerre aurait connu un autre climat.

Ce jour-là, fusion à Marinskoje avec 2 divisions (la 3 ème Gebirgsdivision et la 17ème ). Les Russes (5ème Stoss Armée) ont percé les grands marais de la Plagna larges de 8 km, ce qui leur a permis d’y prendre pied et de surprendre nos arrières. Nous n’avons plus aucun repère, tout est désordonné, l’ennemi se faufile dans nos rangs en petits groupes. Le secteur est mamelonné, partout des morts. Je rampe vers le sommet. Là, à coup sûr, doivent encore être présents des gars de mon unité. A cent mètres devant moi se profile une sM.G . 34, le tireur est mort à son poste au milieu de nombreux cadavres, il présente un visage gonflé.
Je rampe vers le défunt. En le tirant vers moi il va amortir comme bouclier humain les balles et me servir de camouflage. Le tué porte l’arme en bandoulière ; une caisse de munitions est ouverte. Je récupère l’engin, j’essaie d’appuyer sur la détente, le levier d’armement déverrouillé est encrassé. Après nettoyage, l’arme est prête au tir. Une balle, telle un rayon laser (anachronisme !), brûle et tonsure une raie sur mon crâne. Les ricochets mortels miaulent autour de l’abri humain constitué par les cadavres que j’ai attirés sur moi.
A un moment, une fusée rouge atterrit devant ma figure. L’éteindre eût été fatal, car les Russes voyeurs auraient concentré le feu sur ma position. Une nouvelle balle chaude m’érafle le haut du crâne et coupe mon calot en deux. L’ennemi vient au contact. Il me faut avancer sous la mitraille, sinon je ne donne plus cher de ma peau !
En me défilant, je constate que des camarades sont en danger. En effet, devant moi, à trois cents mètres à ma gauche, se tasse un groupe vêtu de tenues de camouflage blanches, caché dans un repli de terrain rocheux. Il essaie en vain de s’esquiver mais des tirs de mitrailleuse l’en empêchent. De la rive, l’infanterie russe conquiert petit à petit le terrain pentu, elle est protégée par un véhicule qui ouvre la marche. Du feu est tiré du toit du lourd engin chenillé qui se rapproche. Je m’aperçois que l’ennemi vient aussi de surgir derrière nous ! Le groupe va sans doute être capturé d’un moment à l’autre : surpris, il ne sait plus où fuir pour s’extirper du piège mortel. Iwan s’enhardit et compte nous anéantir sur la ligne de front. De mon œil alerte, je vois le groupe d’officiers allemands de tout à l’heure acculé cette fois à un promontoire, bien mal en point, d’autant plus qu’une chenillette vient prêter main forte à l’adversaire. J’empoigne la sMG 34 que j’avais réparée peu de temps auparavant, une bande est engagée. Dois-je tirer ? Ou me taire pour éviter les balles de réplique ? Il n’y a plus à hésiter.

Oktryt ogon, ouvrir le feu, comme le crient si fort les germanovores soldats ennemis. Je décide de tirer sur l’automitrailleuse chargée de munitions (je l’ignore à ce moment) qui s’embrase et éclate dans un brasier fulgurant. Cette déflagration tonitruante crée un mouvement d’arrêt chez l’assaillant.
Je hurle sur le haut du parapet : « Vorwärts » et quelques copains me suivent pour bousculer les Russes qui plient bagage. Rescapé quasi miraculeux face au danger mortel encouru, le général Schörner s’approche et me félicite.
Il ouvre son manteau de fourrure, décroche sa propre croix-de-fer 1 ère classe et me la remet aussitôt, me nomme sergent sur-le-champ. Il ne comprend pas qu’un homme qui a à son actif deux insignes de chars détruits (on les distingue sur la manche, Ndr), ne soit pas encore sous- officier. « Je ne cours pas après les honneurs, mon seul but est de ne pas tomber vivant aux mains des Russes » lui dis-je.
Il demande à son Adjutant de prendre mes coordonnées et l’adresse de mon père. Tenant parole, il écrivit plus tard une lettre à mon père... « tapfer, unerschrocken, unverzagt in Stürmen, Gott möge Ihn schützen ! (vaillant, intrépide, courageux dans les tempêtes, Dieu, protégez-le !)
14 février : Bolschaja-Kostromka
On nous signale qu’au nord du village, sur la route vers Apostolowo, se situe l’aérodrome de l’escadrille de Rudel. Nous avons l’ordre impératif de le maintenir ouvert pour que les oiseaux-canons qui nous soutiennent puissent terrasser les pointes blindées soviétiques qui ont percé la ligne de défense allemande. Nous sommes jetés par ci par là dans la bataille. Le cercle se rétrécit, les blindés de la 8 ème Armée de la Garde roulent direction sud pour se réunir à la 3 ème afin que le piège se referme sur notre unité en déroute. On combat férocement. L’on ne fait pas de prisonniers. Par radio, on nous communique que la 24 ème Panzerdivision (PzD) vient à notre rescousse et transperce avec succès les incursions des unités rouges. Discipline, organisation, obéissance : il n’y a plus d’autres mots pour réussir notre savante retraite. Les ordres tombent comme un couperet, ein Fallbeil !


15 février : Apostolowo
Nous partons à l’attaque du secteur d’Apostolowo où des éléments de la 258. I.D . et de la 3. Gebirgsdivision combattent durement. Au Sud, la 24. PzD a transpercé l’encerclement de B. Kostromka ; nous sommes sauvés.



Désormais notre groupe de combat est sous le commandement direct de la 24. Vers 13 heures, nous rejoignons les restes de la 258 et de la 3 sous la protection des panzers. Ordre : percer direction Krivoï-Rog. Vers le soir, nous sommes transportés sur des camions de la 24 PzD. Nous sommes épuisés mais hors du chaudron : nous dormons assis, homme contre homme, ça tient chaud. Plus tard, j’essaierai de me souvenir de ces événements et comprendre comment nous avons pu extraire nos têtes du nœud coulant. Il y aurait trop à dire sur le déroulement des combats d’Apostolowo. Folie mais je vis, Wahnsinn aber ich lebe (cf. photo).
16 février
Nous avons roulé toute la nuit. Un court arrêt à Novoïkajinka (remplissage d’essence des camions LKW et quelques transferts d’hommes sur d’autres véhicules). Nous obtenons du café chaud et un petit paquet destiné aux combattants im Grosseinsatz, et qui contient biscuits secs, cigarettes Juno, quelques douceurs. Une telle surprise, je n’en avais pas connue auparavant sauf durant ma formation à Noël à Demytrowka. Le voyage continue direction N-O . Un feu d’artillerie impressionnant nous parvient du Nord. Vers 10 heures, nous arrivons dans Zvenyhorodka, où s’effectuent les distributions de nourriture et de café chaud provenant directement de la roulante. Sous-officiers et chefs d’unité vont aux ordres. Cela me semble devenir sérieux.

Un officier S.S. de la 1 ère PzD nous donne les consignes d’assaut que nous allons mener avec la L.A.H . (Leibstandarte Adolf Hitler). « Nous allons être conduits dans les lignes d’arrêt près de Buzanka et de là nous marcherons direction Nord vers Lysanka. Vous êtes désormais le Kampfgruppe Bäke. Des pionniers vont venir nous donner les renseignements concernant la cible à atteindre. Nous allons mener un combat frontal là où l’on ne nous attend pas, nous allons devoir maintenir ouvert le goulot sur une largeur de 10-12 km. Parallèlement, les camarades enchaudronnés (eingekesselt) chercheront à percer le cercle. A gauche et à droite de ce goulot, se tiendront les chars Tiger et Panther pour assurer la sécurité. Des unités des 16ème et 17ème PzD chercheront à percer du côté du fleuve Gilnoï Tikitsch, c’est-à -dire à l’ouest de Bila Cerkva.
Quant à la 24 ème PzD, elle entreprendra un large détour pour bloquer toute percée blindée soviétique qui proviendrait du sud, sachant que la brèche envisagée par l’adversaire nous ferait très mal si elle perforait notre flanc découvert. Les gars, il s’agit de sauver 50 000 hommes qu’Iwan veut anéantir ! Parmi eux se trouvent des éléments de la Wallonia, de la Germania et de la Wiking avec de nombreux blessés qui ne doivent pas tomber entre les mains ennemies. Iwan ne connaît pas de pitié. Un ultimatum de reddition a été refusé par le Kommandeur Stemmermann (qui fut tué durant la percée). Le succès de cette Aktion dépend seul de nous tous. Bonne chance à tous !» Je profite pour écrire chez moi. Vers 13 heures, notre convoi quitte le village de Zvenyhorodka sous les tirs des tanks et des chenillettes avec leur quadruple affût. Vers 16 heures 30, nous sommes à Buzanka pour être ravitaillés en nourriture et munitions.
Gradés et sous-officiers partent au rapport. Dans la nuit grise, nous roulons jusqu’à Lysjanka, des tirs d’artillerie nous frappent venant de devant, de gauche et de droite. Des précisions nous sont apportées, nous partons vers nos positions, droit devant nous. L’assaut doit démarrer à 5 heures, Iwan est sur les dents, prêt au combat. Des lucioles montent sans arrêt au firmament pour éclairer le décor. L’ennemi se tient sur ses gardes, mais ignore apparemment notre progression dans la pénombre laiteuse. Nous sommes ardents des deux côtés. La fièvre du combat nous rend nerveux, nous taisons nos inquiétudes aussi longtemps que possible. L’activité des patrouilles pour détecter Iwan n’est guère facile dans la neige où il s’agit de se faire invisibles et de ne pas se faire remarquer. Le gris d’encre de la nuit, la lune et les étoiles aux abonnés absents, vont faciliter à pas de loup notre approche du chaudron.
Ma lettre du 16 février 1944 à Mathias Ernst habitant Adolf Hitlers Strasse 7 à Hargarten (Westmark).
Cher père, Je ne sais pas si cette lettre te parviendra. Notre chef de compagnie nous a demandé avec insistance que chacune de nos missives soit distribuée à des camarades, dans l’espoir que l’une ou l’autre d’entre elles parvienne à ses destinataires. Nous avons pu sortir de l’encerclement de la boucle du Dniepr après de très lourds combats et de sévères pertes. La 24 ème Panzer Division nous a libérés alors que nous étions acculés dans le secteur Bologna- Apostolowo.
A Marinskoje, j’ai sauvé la vie du général-colonel Schörner et de six officiers en rameutant quelques camarades pour foncer courageusement contre une unité russe qui avait abordé le rivage, venant de la Plagna et que nous avons anéantie. Les avant-gardes russes s’étaient déjà profondément infiltrées dans nos lignes lorsque je lançai la contre-attaque. Le général a fait annoter ton adresse par son officier d’ordonnance, l’Adjutant. Il m’a promis qu’il écrirait au vieux monsieur (toi, père !) pour lui dire qu’il était fier de moi, ton fils. Il m’a épinglé sa E.K .l et m’a avancé au grade de sergent. Nous avons combattu 16 jours et 16 nuits.
On nous a rassemblés pour aller étoffer un groupe de combat nouvellement créé et, dans la foulée, nous devrions être dirigés dans le chaudron de Tcherkassy pour délivrer nos unités encerclées. Nous avons beaucoup de neige et il fait très froid. Il faut que je termine car le temps consacré à l’écriture de notre courrier nous est compté. Je vous embrasse tendrement, en particulier mon petit frère Joseph. Je vous embrasse de tout cœur. A bientôt. Sous-officier Ernst. Inf. Pionnier 9 Zbv bei der 24 Pz Div im Raum Tcherkassy. Je n’ai plus de numéro postal puisque nous sommes provisoirement affectés à la 24 Pz D. Depuis Noël 1943 je n’ai plus reçu de vos nouvelles.
Historique :
Etablie sur la Panther Linie courant le long du Dniepr, la VIIIème Armée allemande occupe un large saillant dans les lignes soviétiques dont Korsun est le centre. Joukov veut utiliser la tactique qui a permis à l’Armée Rouge de détruire la VIème Armée de Paulus à Stalingrad. Il déploie les 1 er et 2ème fronts d’Ukraine afin de constituer deux lignes d’encerclement autour du Kessel de Korsun, ceci pour anéantir les troupes allemandes prises au piège et empêcher les renforts de rejoindre les unités encerclées. Hitler préconise de résister sur place pour fixer l’adversaire. Pour von Manstein qui désobéit aux ordres du Führer, il s’agit de ne pas rééditer le désastre de Stalingrad mais de procéder à la rupture de l’encerclement. Il envoie le groupe Bäke et ses gros Tiger ainsi que la Leibstandarte à la rencontre des troupes assiégées pour leur ouvrir un couloir d’où le Gruppe Stemmermann a reçu l’ordre de se frayer un chemin sanglant vers la liberté, soldé au prix de lourdes pertes.
17 février 1944.
Dans le chaudron du Mal et de la Mort ! Il est 5 heures du matin lorsque fuse l’ordre : « en avant, direction Colline 239 ! » Notre pointe d’assaut se fraye un chemin entre Oktyabr et Pochapintsy jusqu’à Komarovka. De Schenderovka s’extraient des troupes de la Wallonia soumises aux tirs russes car Iwan tire au hasard, la vue est mauvaise et il neige. De mon côté gauche surgissent des blindés, d ’abord un seul vite suivi de deux autres. Est-ce des tanks allemands ? Soudain, un cri d’effroi ! Ce sont des T.34 qui surviennent de notre gauche. « Vite, schnell, deux Panzerfaust, schnell, schnell ! » Une explosion retentit, un tank brûle, puis surviennent peu après deux autres détonations. Accompagnant leurs blindés, des fantassins de l’Armée rouge lèvent les mains en l’air, des coups de feu éclatent.
« Aujourd’hui on ne fait pas de prisonniers, en avant camarades ! » Devant nous s’étend une forêt dans le secteur d’Oktyabr que nous devons atteindre. Etablis devant une clairière, nous sommes attaqués par un escadron de cosaques à cheval. Ils ont tiré le sabre et crient « Pobieda, Pobieda, Victoire ! » et foncent sur nous. Sous le feu des MG, leur assaut s’écroule.
Cavaliers et chevaux sont terrassés par terre dans la contrée enneigée. Quelle folie, cette tuerie ! De ma droite, venant de Komarovka, une auto-chenillette 2 cm Vierling tire rageusement de tous ses fûts.

Un T.34 apparaît en feu, son équipage quitte l’engin. La chenillette continue de tirer sur tout ce qui bouge. Maintenant nous voyons arriver des charrettes chargées de grappes humaines qui sortent de la forêt. Avec le même empressement, d’autres petits groupes jaillissent des futaies et foncent fébrilement vers nous. Une charrette se dirige vers la clairière à gauche de nous. Un cri breffusedenotrecôté:«Halte!Quiestlà? - Bourguignons ! » me revient en retour l’écho. Je crie vers ceux qui s’approchent : « Parole ! Donnez le mot de passe ! - Bourguignons ! » Je leurs réponds : « approchez vite, schnell. » Et tout à coup se tiennent devant moi des soldats en uniforme allemand parlant le français ! Suis-je devenu fou ? Est-ce un rêve ? Nous nous étreignons. « Nous sommes de la division d’assaut Wallonie » disent-ils. Mais nous ne pouvons guère nous attarder en conciliabules. J’entends seulement qu’ils disent avec beaucoup d’effusion « camarades, merci ! ». Des groupes épars progressent vers nous, provenant de Komarovka. (cf. récit de Klein Rudolph, rescapé du chaudron de Korsun). Brusquement éclate le vrombissement de moteurs poussés à l’extrême par une horde de tanks russes. Seul celui qui l’a vécu personnellement peut le rapporter. Cette atroce scène que j’ai vécue, c’est comme si j’avais été frappé d’un arrêt de sang ! Blutstillstand ! Spectacle paralysant ! Trop souvent, face à une meute de tanks, les groupes de sécurité se sauvent et celui qui se sauve est un homme mort ! Et les groupes exténués qui arrivent par vagues se jettent par terre dans la neige sans chercher à se défendre. Tout va trop vite.
Les monstres foncent vers les charrettes sous un feu sauvage. Les charrettes des blessés sont broyées, triturées sous nos yeux. Il n’y a pas de pitié, pas de grâce de l’autre côté. Seulement popieda, popieda ! Iwan est ivre de sang, il ne veut aucun Woyna Pleny seulement des Niemski kaputt, kaputt ! Maintenant leurs panzers apparaissent de tous les côtés. Les troupes éparses de la Wallonia qui s’extirpent de la nasse s’arrêtent tétanisées, elles lèvent les bras. Certains soldats essaient de fuir mais se cassent en deux, terrassés par le feu des MG installés à bord. Cette tactique du rouleau compresseur, c’est sûr, a été rôdée, par les équipages.
Tout ce qui bouge est mis bas, c’est un meurtre bestial auquel nous assistons et on ne peut pas intervenir ! Que pouvons-nous tenter avec nos Panzerfaust sur des blindés placés à 100-150 mètres devant nous, sans obstacle naturel pour nous dissimuler ? Absolument rien ! Tirer d’aussi loin équivaut à balancer une chiquenaude sur un blindage. Si nous avions par malheur ouvert le feu avec nos mitrailleuses, nous serions tombés foudroyés par la grêle d’obus tirés des panzers. Sans réaction, sans moyens, nous assistons à un spectacle affreux, celui du laminage de corps sans défense, écharpés par les intraitables chenilles d’acier.
Un tel meurtre collectif horrible, on ne pourra pas, dans toute sa vie, l’oublier ! La haine et toujours de la haine, aussi longtemps que je vivrai, restera ancrée à jamais dans mon cœur et ne pourra pas s’éteindre. Ce crime de guerre est monstrueux et à nul autre pareil. Je demande au lecteur de comprendre mes écrits au travers de cette forfaiture (eine Schandtat !) qui s’est déroulée devant mes yeux. Dans les années à venir, sans doute trouvera-t -on le courage d’en parler, on ne peut pas tolérer qu’un crime aussi horrible puisse rester impuni. Damnés doivent être ceux qui l’ont perpétré, comme leurs descendants ! Des survivants de la Wiking et de la Wallonia qui ont réussi à s’extirper de la nasse peuvent en témoigner. Nous et les camarades de la LAH, on ne nous croira pas ! Seul celui qui l’a vu peut accréditer mon témoignage, je veux rester honnête et objectif, seule la vérité peut nous libérer l’esprit. Je suis un Muss Soldat mais cette horreur, je ne pourrai jamais la taire.
18 février 1944
Sortant du village de Morynci étendu à droite de nous, des hordes de T.34 attaquent en nombre. Nous retraitons lentement, de nombreux T.34 brûlent, éliminés par les Panzerfaust. Sur notre gauche, des éléments épars de la Wallonia percent jusqu’à la 1 ère S.S. Panzerdivision. « Jungs, le goulot doit impérativement être maintenu ouvert. » Combat total retardateur ! Des hommes débandés de la Wiking et de la Germania se poussent vers nous, ils sont exténués. Ils nous racontent des scènes incroyables : « des convois entiers de blessés ont été écrasés par les T.34. Les Rouges ne font aucun prisonnier, tout est abattu. Tous les véhicules ont été perdus. Des colonnes entières ont été laminées, charcutées entre les chenilles des tanks ennemis. Pas de prisonniers... » Les mêmes mots sortent des lèvres de tous les rescapés, tous unanimes pour décrire l’horreur vécue. Nous-mêmes le savons, l’ayons vue de nos propres yeux.

Nous venons de découvrir le cadavre d’un jeune S.S. à qui les Russes ont coupé le pantalon, lui ont tranché entièrement le sexe et l’ont fourré dans sa bouche. Peut-on à notre tour imaginer après ces horreurs épouvantables laisser la vie sauve à des prisonniers ? En face, ce ne sont plus des soldats mais des monstres.
Mon Dieu, quand toute cette horreur prendra-t -elle fin ? Dans mon carnet « Notes de guerre sur le front de l’Est » je porte témoignage sur les atrocités commises par l’Armée Rouge le 17 février 1944 dans le chaudron de Tscherkassy dit aussi « poche de Korsoun ». Lors de notre contre-attaque sur la côte 239, située entre les saillants d’Oktyabr et Pochapintsy, j’ai été le témoin oculaire des atrocités perpétrées par l’Armée Rouge.
Son crime est inexpiable ! Je laisse aux lecteurs la primeur de mes notes de guerre afin de réfléchir, je leur laisse le soin de lire le récit du correspondant de guerre soviétique qui donne des détails effrayants sur ce massacre que d’ailleurs le Général

A. Guillaume confirme dans une étude de documents annotés avec une préface du Général de Lattre de Tassigny. Je cite un extrait : « le général Rioumkine qui a visité les villages reconquis a vu Goroditche et Chevtchenkovski-Korsun. Il est revenu roulant des yeux fous.
« Quelle destruction ! quel massacre ! Vous n’avez encore rien vu de pareil ! » dit-il haletant et pourtant Rioumkine a participé à la bataille de Stalingrad ! En relisant mes notes d’antan sur notre contre-attaque en vue de dégager les unités bloquées dans la souricière de Korsoun, il y a cette blessure profonde que je ressens toujours aussi lancinante, indélébile dans ma mémoire, ce carnage d’une telle intensité auquel j’ai assisté impuissant et qui a engendré une haine indescriptible en moi. Y aura-t-il un jour un Tribunal international pour juger cette bestialité ? pour juger le Commandant de chars Volodia Kor..., sans aucun doute héros de l’Union Soviétique ?
Que penser de l’hypocrisie du Capitaine Om... qui relate la calcination des voitures de la Croix-Rouge avec ses occupants, ces sanka qui étaient sacrées pour nous. Questions à mes lecteurs : « Combien de Malgré-Nous y ont péri ? Nul ne le saura jamais. Mais que faire, quand une propagande habile maquille ses crimes en exergues vengeresses ? « Salissez, salissez, messieurs, il en restera toujours quelque chose. » Jamais ma parole ne sera assez puissante pour exprimer mon dégoût, je ne vivrai jamais assez longtemps pour crier mon indignation, la justice des hommes n’appartient qu’aux vainqueurs.
Bilan de la poche de Korsoun :

26 000 tués ou portés disparus, 10 000 tombés lors de la rupture de l’encerclement, 30 000 ont été libérés.
Le Kessel de Tcherkassy est nommé aussi « chaudron ou poche de Korsoun ». Les éléments du 1 er front d’Ukraine au Nord et les troupes de Koniev au Sud en avaient réussi l’encerclement pour espérer en faire un mini-Stalingrad.
L’Armée Rouge avait renforcé les lignes d’encerclement en y massant des forces considérables (côte 239).
Mais désaxant le sens de la percée, l’état-major allemand préféra porter l’effort au sud-ouest, là où la couture du piège fermé était la plus fragile. Le groupe Bäke ainsi que la Leibstandarte Adolf Hitler (L.A.H .) foncèrent vers Schenderowka pour extirper la Wiking, la Wallonia et de nombreuses autres unités hors du bouillant Kessel.
Six divisions allemandes subirent de lourdes pertes et abandonnèrent tout leur potentiel militaire sur place. Certes, chaque camp criait victoire : von Manstein avait réussi le dégagement, Koniev fut nommé Maréchal de l’Urss pour avoir écrasé le chaudron.
19 février 1944
Dans la nuit, notre unité complètement épuisée est relevée et transportée via Lyssianka vers Buzanka (tenue par la LAH). Les fantassins ont eu consigne d’évoluer à l’arrière des panzers, en groupes ouverts sur les deux ailes, bien espacés entre eux. Les blessés ont été hissés sur les blindés et les autres véhicules.

A Buzanka, nous obtenons de la nourriture, du café et des boissons alcoolisées. Celui qui distribue le manger à la Gulaschkanone (cuisine roulante) crie sans interruption : « Lentement, camarades, avalez sans hâte, avec mesure, pour que le manger ne vous reste pas sur l’estomac. Il vous faut à nouveau vous habituer à la nourriture. » Nos uniformes équivoques et les nombreuses puces font reculer les cuistots. Nous sommes méconnaissables, effroyables dans nos chiffons et nos barbes.
Totalement épuisés, comme des boxeurs soûlés d’uppercuts ! L’anecdote suivante mérite d’être rapportée. « D’une maison vient de sortir un adjudant, je veux dire, bien soigné. Un caporal que je connais s’arrête de manger, fixe ses yeux sur le Feldwebel puis il court vers lui, veut l’embrasser et de joie crie son bonheur : « Joseph, Joseph ». Le sous-officier se retourne tout surpris et très étonné, il lui rétorque : « Qu’est-ce qui vous prend ? Vous êtes fou ? » Le caporal s’arrête, interdit, puis il dit : « Bon Dieu, tu ne reconnais donc plus ton frère ? » Alors un cri sort de la gorge du Feldwebel, il reconnaît son frangin au ton de sa voix, son frangin amaigri, barbu et bien sale. Il en oublie les puces, la boue. « Comment, tu étais là-dedans, dans ce... chaudron ? Mince alors, et tu vis encore après tout ça !»
Et il emmène le rescapé dans son quartier. Il est clair qu’à l’image de l’adjudant qui ne reconnut pas son frère, beaucoup d’autres fantassins de l’arrière n’auraient pas identifié leurs amis exténués et affamés, suite à la grosse Scheisse à laquelle ils avaient participé. Après avoir vidé nos gamelles, nous recevons encore un quart de thé arrosé au rhum. Notre unité est répartie dans des logis tant bien que mal et nous pouvons nous requinquer pour la nuit dans cette localité. Devant les maisons sont couchés les morts ; leurs cadavres gelés sont superposés sur plusieurs couches. Dans notre cantonnement gémissent les blessés, surtout ceux qui souffrent de graves engelures. Ils attendent leur évacuation.
20 février 1944
Sur les coups de 8 heures, tous les chefs des unités sont convoqués pour être éclairés sur la situation. Un officier supérieur S.S. nous donne les informations suivantes : « En maintenant l’ouverture de la nasse, la présence des chars Tiger et Panther a permis de sauver plusieurs dizaines de milliers d’hommes dont le Gruppenführer Gille, le général Lieb du 13ème Corps et le chef de la brigade d’assaut Wallonia, Léon Degrelle.
Les pertes, nous les estimons élevées. Le chaudron est maintenant aux mains des Soviets. On combat encore ici ou là localement, mais Iwan terrasse sans pitié les derniers combattants pris au piège. Soldats, vous avez été témoins des actes de cruauté ennemis. Ceci est le vrai visage du Bolchevisme, ne l’oubliez jamais ! » Notre marche de repli se dirige vers la ville d’Uman qui est un important nœud de communications, dotée encore d’un aérodrome, cible de choix des Soviets. Nous devons protéger le terrain d’aviation pour faciliter l’évacuation des blessés.
21 février 1944
Il a arrêté de neiger, la vue s’est éclaircie, mais maintenant surviennent les avions Stormowik. Ils cherchent à nous ceinturer, à nous prendre en tenailles dans nos colonnes de véhicules, et à nous terrasser. Heureusement, leurs bombes manquent les cibles car les pilotes ne les ont pas lâchées à basse altitude comme ils en ont l’habitude. Deux avions Fockewulf surgissent et le danger du « crachat aérien » disparaît. Mais Iwan est en marche avec le soutien intense de son artillerie. Cela signifie qu’il va attaquer avec toutes ses forces réunies : ce nouvel assaut agressif s’appelle nivellement du front et écrasement de toute résistance !
Nous quittons Buzanka et rallions Kut où s’entassent beaucoup de morts sur les bas-côtés de la route. Les pointes russes ciblent le fleuve Bug et la ville d’Uman qui dispose d’un très grand aérodrome. Une nouvelle pince d’encerclement se profile. A droite, de fortes colonnes blindées ennemies rappliquent à nouveau en cherchant à nous couper la retraite. Les Russes tâtent continuellement vers l’avant pour se renseigner sur nos lignes de défense. L’initiative est de leur côté. Ils possèdent les hommes et du matériel en grande quantité. Pour Iwan ça ne donne que Pobieda, pobieda ! Et pour nous, nazat, nazat. Vous n’aurez rien !
Ma lettre du 21 février 1944
Chers parents, la lettre de la semaine passée est toujours encore dans ma poche (lettre du 16 février). Tout alla tellement vite ce jour-là, nous dûmes nous préparer pour l’intervention. On nous embarqua pour être acheminés sur les lignes d’attaque. Il neigeait continuellement, ce qui ma foi, était tout aussi bien. Les avant-gardes russes, échelonnées en longueur étaient ainsi paralysées et nous, nous pouvions bien avancer pour les surprendre. Dans la nuit, les camarades se sont mis en mouvement et nous avons marché sur les Russes. Nos avions nous ont parachuté des munitions : chez nous silence radio (absolute Funkstille). Le 17 février, vers 6 heures, il faisait clair.
Grosses chutes de neige. Ce fut un jeudi noir avec des combats très, très meurtriers avec Iwan. Notre groupe de combat (Bäke, Ndr) fut incorporé au groupe L.A .H ., la Leibstandarte Adolf Hitler. Nous avons avancé jusqu’à la colline 239 et avons ouvert le goulot (Flaschenhals) d’où s’échappèrent la Wallonia et de faibles éléments de la Germania. Lorsque j’obtiendrai un congé, je vous raconterai ce qu’ont perpétré les bandits rouges. C’était effroyable ce qu’ils ont manigancé avec leurs tanks. Je dois conclure, on m’appelle. Au revoir.
22 février 1944
En ce mardi, nous nous retirons sur Baky, entourés d’intenses tirs d’artillerie. La vue du front ressemble à un fer à cheval. Et les avions Iliouchine 1 et 2 essayent de larguer leurs tapis de bombes sur nos voies de ravitaillement à l’arrière pour couper les liaisons nourricières. Les Me 109 et les Fockewulf leur foncent dessus et sont victorieux. (J’ai observé deux crashs d’avions ennemis).
L’aérodrome d’Uman n’est pas trop loin par rapport à notre position si bien que nous pouvons compter sur l’appui aérien en très peu de temps. Souvent surviennent les Iliouchine sans leurs chasseurs d’escorte. Dans ce cas, la suprématie n’est plus de leur côté, car, lorsque nos chasseurs arrivent, les Stormovik déguerpissent vite fait sous les rafales tirées par les aguerris pilotes allemands. Mais Iwan est coriace, il revient toujours et cela énerve. Des tracts pleuvent de nuit sur nos tranchées, ce sont des laissez-passer du Comité National de l’Allemagne libre, qui nous invitent à passer de l’autre côté. « Soldats allemands, venez, rendez-vous à l’Armée Rouge, nous vous garantissons une bonne nourriture, des soins et un retour rapide dans vos foyers dès la fin de la guerre. » Mais comment croire à un tel mensonge lorsqu’on a été témoin de crimes inhumains ? «Mieux crever dans l’honneur que de s’évader chez eux ! » Combattre, et toujours combattre pour passer à travers l’enfer !
Comme tous les Landser, je veux réussir à me faufiler entre les mailles périlleuses du filet, je veux rester en vie. Seul celui qui est volontairement fort a une chance de s’en sortir. Ici il s’agit de sauver sa vie nue, coûte que coûte dans toute la brutalité de l’existence. Dans la nuit nous atteignons la localité de Manziwka éloignée d’un certain nombre de kilomètres de la ville de Podibna qui est située sur la grande Rollbahn d’Uman. Des éléments de la 1 ère S.S. Pzd et des tanks de la 47ème Pzd tiennent tête dans de sanglants combats face aux T.34 avant-coureurs qui nous assaillent pour atteindre le grand aérodrome d’Uman. Nous avons reçu le soutien des canons de 88, et également l’appui des canons quadruples de la Flak montés sur affût mobile. A gauche de nous, des canons automoteurs sont venus en position. Cela promet du beau spectacle !
23-24 février 1944
Alors que nous nous rassemblons, nous apercevons un grand immeuble décoré de branches de sapin et un grand panneau peint portant l’inscription suivante « Soyez les bienvenus » suivi d’une plus grande affiche placardée à l’entrée du bâtiment : « Seid willkommen, Helden aus Tcherkassy ! » Ces pompeux souhaits de bienvenue aux héros de Tcherkassy ne nous sont pas destinés. « Ils ont été adressés à quelques grosses huiles que nous avons sauvées du désastre, elles n’ont pas eu le cul refroidi, et cela fait longtemps qu’elles se sont envolées d’Uman pour recevoir les félicitations du Führer » s’exclame, très dépité, un sergent S.S. .
L’homme a du courage pour fustiger ce décor imbécile. Ainsi, des peintres et des décorateurs ont été recrutés pour effectuer un tel travail alors que nous manquions de renfort pour lancer des contre-attaques sanglantes sur une ligne de front mobile, très longue qui aurait nécessité plus d’appui humain et qu’Iwan à tout moment pouvait culbuter. Elle est tout simplement inconcevable cette comédie !
Comme nos véhicules ont été réquisitionnés ailleurs, nous attendons de nouvelles consignes. Les fantassins s’écroulent de sommeil dans la neige. Le 1 er tireur de la MG, le caporal-chef Gruber, surnommé Willy, me dit : « Viens, nous allons en maraude. Peut-être reste-t -il quelque chose à se mettre sous la dent suite aux joyeuses agapes tenues ici pour ces profiteurs ? Un verre de cognac me ferait le plus grand bien, qu’en penses-tu ? » Alors que nous fouinons dans le secteur à la recherche du liquide bienfaisant, une odeur agréable de pommes de terre nous chatouille les narines. Elle provient d’une maison située en retrait. Lorsque nous ouvrons la porte, un fumet capiteux vient à notre rencontre. Une odeur de pommes de terre rôties qui vous met les papilles en chatouille nous emmène dans une vieille chaumière. Willy, le dur-à -cuire, me suit. Nous éventrons la porte d’entrée. Un sac-à -patates est vautré à table, les bretelles en évidence sur sa panse bedonnante. Une belle blonde, sa maîtresse à n’en pas douter, lui mijote une fricassée de patoska.
Voilà un bonze du Parti qui se vautre sans gêne dans le pain et les jeux (panem et circenses) pendant que nous, les gladiateurs modernes, nous nous égorgeons pour que Monsieur puisse à l’arrière se payer du bon temps ! « Ihr Schweine ! Raus !» fulmine-t -il en nous voyant reluquer à l’envie sa tablée. Accrochée dans un coin, sa veste brune arbore sur la manche un brassard blanc-rouge avec le svastika ajouré dedans. Sûr de lui, le malotru insiste : « Ihr Schweine ! ‘raus ! Als Plünder zeige ich Sie an bei der Ortskommandantur!» Une rafale de mitraillette décochée à cinquante centimètres au-dessus de la tête l’apostrophe. Se faire traiter de pilleurs (Plünder) par un profiteur ! La coupe est pleine ! Un bidon de cinq litres d’huile trône sur la table.
Une mine d’or alors que notre troupe crève de faim et se tape du pain rance et gris ! «Alors, Krumpakäfer, tu t’empiffres en égoïste ! Tu sais qu’un doryphore (Kartoffelkäfer) est un insecte nuisible et tu l’es ! » Le régisseur pâlit, 1’attitude de mon comparse qui joue du couteau et veut s’en servir, n’arrange pas l’entretien houleux. « Ecoute, tu connais Jesse Owens, le vainqueur des Jeux Olympiques de Berlin. Il a gagné le 100 mètres à la grande fureur du Führer, paraît-il. Sais-tu en combien de secondes ? » interroge Willy, très remonté. - Dans les 10 secondes peut-être ! - Ecoute, je te donne 12 secondes pour filer. Enlève encore ta culotte bouffante avant de piquer ton sprint. - Les gars, je vais me plaindre à ... - Taille-toi, Patapouf ! »
24 février 1944
Au matin nous retournons dans nos tranchées à l’est de Manziwka. Iwan pousse toujours de tous les côtés pour tester notre résistance. Il se regroupe, se renforce, sa logistique est en panne pour l’instant car son ravitaillement souffre de la longueur des trajets. Mais il viendra, dès qu’il sera réapprovisionné pour culbuter nos positions. Sa tactique n’a pas plus de secret pour nous depuis les retraites du Don et du Kouban. D’abord il procède par un grand coup, se ressource, puis assène un nouveau coup comme le ite missa est à l’église (la messe est dite) ! Le climat est imprévisible : à midi un vent souffle sa chaleur printanière et dès le soir rugissent les rafales de neige dans cette terre de désolation.
26 février 1944. Podibna

Nous sommes positionnés devant Podibna. Iwan tambourine sans arrêt et essaie avec son infanterie de détecter les points faibles pour percer. Nos canons mobiles interviennent chaque fois que le surnombre et l’encerclement nous menacent. Ils disparaissent très vite pour ne pas être repérés. Iwan a du mal à les localiser, les canonniers allemands connaissent leur affaire.
Vers 11 heures, l’artillerie russe tire un feu sauvage sur nos tranchées. A 11 heures 30, les tirs s’arrêtent sur nos positions arrières, et déjà sans nous accorder un moment de répit, vrombissent les T.34 suivis des troupes d’assaut. Un feu démentiel de réplique fouette et balaie les sections d’assaut russes ; leurs blindés cherchent à transpercer nos défenses. Et là, survient l’incroyable miracle : 6 T.34 éclatent en flammes dans notre dos !
Des Tigres postés au village les ont déquillés avec leur canon de 88 ! Les autres T.34 tournent les talons.
 Et comme à la parade, le restant du cortège cuirassé est réduit en ferraille. Vers 15 heures, il commence à faire nuit. Un lieutenant suivi de deux hommes arrive dans notre position : « J’ai besoin de trois gars qui sont rompus à la pratique de la dynamite. »
Et comme à la parade, le restant du cortège cuirassé est réduit en ferraille. Vers 15 heures, il commence à faire nuit. Un lieutenant suivi de deux hommes arrive dans notre position : « J’ai besoin de trois gars qui sont rompus à la pratique de la dynamite. »
Je me présente comme Panzerknacker et désigne encore deux camarades que j’estime capables de détruire des tanks. « Nous allons montrer à Iwan que nous sommes encore très combatifs pour mettre leur boutique sens dessus dessous. » Au même moment, notre intendance vient de faire sauter ses dépôts de carburant.
Quel gâchis alors que le Sprit si vital (carburant) va manquer aux turbines de nos panzers ! Nous nous formons pour le départ. Le lieutenant demande : « Qui est prévu pour assurer la sécurité du groupe ? - Moi », dis-je. Il réfléchit un instant puis me glisse : « Vous resterez ici. Il me faut quelqu’un de sûr pour assurer notre retour, pas que nos propres gens nous tirent dessus ! » Le lieutenant me précise qu’il signalera son retour par une traçante verte. Treize silhouettes se fondent dans la nuit. (Elles reviendront sans problème).
28 février 1944
En ce temps de neige, malgré le vent qui souffle en rafales ininterrompues sur la steppe, l’offensive d’hiver des Russes roule. Pleines de doute et d’appréhension, nos compagnies décimées se bagarrent et résistent contre les hordes menaçantes que rien ne semble retenir. Mon groupe, -nous sommes en fait encore cinq hommes-, a le devoir de tenir dans de sales trous enneigés jusqu’au dernier homme, comme on nous l’a dit si gentiment. Nous constituons l’arrière-garde parce que l’état-major allemand est en train de raccourcir le front. Voilà pourquoi nous sommes jetés en pâture à Iwan pour que certains des nôtres puissent encore en réchapper.
Nous savons que ce trou sera notre tombe. Que faire d’autre ? Si nous nous sauvions en ces instants, nous serions tirés comme des lièvres. Le coupant vent d’Est mord, la neige cingle nos visages, encolle les yeux. Nous tirons sans interruption, dans le secret espoir de pouvoir tromper Iwan sur notre effectif de réplique. L’étau se resserre.
Dans notre dos surgit un canon automoteur (Sturmgeschütz), ce sont des camarades de la L.A.H . qui viennent nous libérer du piège et qui nous aident à grimper sur la cuirasse d’acier. Le blindé tire sans arrêt, exécute un demi-tour parfait et file dans un tempo démentiel. Absolument incroyable, ce qu’ont pu réaliser les gars ! Je ne pourrais jamais oublier cette péripétie. Merci beaucoup, les amis. Mains serrées, bref au-revoir et en avant.
29 février 1944
Nous sommes ramenés sur un char Tiger jusqu’à Staraya Barbani et nous arrivons dans une chaumière (Kate) où du café et de la nourriture nous sont servis. Un Sturmbannführer (commandant) en veste fourrée blanche accompagné de quelques officiers arrive et nous serre les mains. « Jeunots, c’est fantastique ce que vous avez démontré tout à l’heure, seuls face aux Russes. C’est moi qui ai ordonné l’envoi du Sturmgeschütz pour vous extraire du guêpier. Reposez-vous, nous reconstituons ici une position d’arrêt. Pour vous cinq, j’ai ordonné un jour et une nuit de repos complet. Vous l’avez bien mérité, vous recevrez une part de notre ravitaillement. Dormez, nous verrons la suite des événements vous concernant. En attendant, grâce à vous, nous avons pu ramener sains et saufs les blessés jusqu’à Uman. »
2-3 Mars 1944
Mon groupe est intégré au groupe de combat Koralewski. Je m’annonce à la lisière du village au lieutenant- colonel (Obersturmbannführer) Koralewski. Je me présente avec mes 4 camarades. Le gradé est originaire de Haute-Silésie et il est bien renseigné sur notre cas. « C’était bien toi et tes hommes qui étiez dans les trous donnés perdus de Podibna lorsque le canon automoteur vous a récupérés in extremis, il y a, je crois, 4 jours de cela. - Oui, c’était nous ! - Chapeau, les gars ! Sur vous on peut compter ! » Il nous installe à la périphérie du village. Nous partageons la position avec ses gens. Ce sont des trous individuels de forme carrée. Comme les chaumières aux toits enneigés sont proches, les fantassins peuvent à tour de rôle aller se réchauffer et pouvoir revenir très vite dans les trous terreux, en cas d’attaque. Le feu des obusiers adverses nous surprend, puis des tirs éclatent comme des coups de fouet dans notre secteur, suivis d’un tir court de mitrailleuses, puis cela redevient à nouveau plus calme. Iwan tâte la position devant nous, mais il ne tire pas encore avec son artillerie dans le village. Sans doute imagine-t -il y installer ses quartiers, et puisqu’il y sera tantôt, il ne veut donc pas brûler les maisons où il cantonnera bientôt. Iwan entretient sa poussée avec ses incessants feux de harcèlement et nous envoie encore des patrouilles pour nous maintenir constamment sous pression.
4 Mars
Les combats éclatent à nouveau. Il est 8 heures du matin. Sur un front large de 180 km, l’Armée Rouge passe à nouveau à l’offensive. De gros tirs d’artillerie annoncent le bond en avant que s’apprête à faire l’adversaire. Il le fait ainsi depuis l’été dernier, c’est toujours la même chanson : pilonner lourdement, écraser les fantassins allemands dans leurs trous et attaquer en masse. Après le terrible feu de roulement, viennent leurs panzers suivis au plus près de leur infanterie. Le caporal Erbrecht reçoit une blessure nette de rapatriable au bras droit. L’infirmier en convient : « Tu en as de la veine ! Un bon Heimatschuss, ça vaut le coup de l’encaisser ! » Un ordre nous parvient : départ du Kampf- gruppe Koralewski sur Dmytruski qui est une localité distante de quelques kilomètres de Starya-Barbani. Les chars Tigres couvrent notre retraite puis les monstres partent à leur tour sur Dmytruski.
Du 5 mars au 6 mars 1944
Dmytruski doit être tenu, car c’est le dernier village avant la ville d’Uman où est implanté l’aérodrome qui pourvoit à notre ravitaillement et qui récupère les blessés pour les convoyer en Allemagne. Il neige sans arrêt, nous sommes couchés dans des trous individuels. Devant nous, l’artillerie russe martèle continuellement. Des batteries d’obusiers ennemis rallongent leurs tirs et les T.34 apparaissent devant nous. Une effroyable situation ! Les lourdes chenilles qui meulent avancent lentement, les voilà en action sur un trou vers ma droite. Un colosse d’acier s’est arrêté et commence à tourner sur lui-même. Ses chenilles s’enfoncent dans la terre et aplanissent l’abri.
Personne ne peut secourir le malheureux, la grêle de tirs est trop intense. Si quelqu’un s’amusait à cet instant de sortir de son fossé, il serait immanquablement troué ! Il est impossible de s’approcher pour plaquer une mine aimantée ou lancer une Tellermine dans les chenilles. Je ne distingue plus rien au milieu de la poudre brûlée. Un T.34 passe à côté de mon abri, très près du bord. Ne pas paniquer ! C’est terrible les scènes qui se déroulent autour de nous.
Chaque vie humaine est hachée, ou alors elle est enterrée vive. Un destin horrible contre lequel on ne peut pas s’opposer frappe tel ou tel écrabouillé. Nous sommes plongés dans le combat face à Iwan qui veut toujours avancer et qui hurle à mort « Pobieda, Victoire. » Derrière nous, les Tigres tirent à outrance et inlassablement. Des affûts mobiles les épaulent et fournissent un feu d’arrêt rasant en tirs antiaériens (2 cm). Tard dans l’après-midi du 6 mars, un arrêt des tirs a lieu. Mais tout est en flammes, c’est l’enfer. Les tanks brûlent, des cris déchirants d’appel fusent vers les infirmiers, la localité brûle derrière moi. Je n’ai plus de liaison, il me semble que tous les trous individuels sont nivelés. Les mains en porte- voix, je hèle les rescapés : « Groupe Koralewki, où êtes-vous ?» Il n’y a pas de réponse. Un tir de mitrailleuse fuse dans le ciel pour éclairer le champ de bataille et le rendre encore plus lugubre. Grâce aux traçantes qui se dirigent sur moi, je sais où Iwan est maintenant localisé et comment il tient sous son feu la localité établie derrière moi, au moment où je file le long des champs établis autour du village. Je bats en retraite. Une tempête de neige s’est enclenchée, j’ai enfilé ma capuche et je serre fermement mon PPsh (mitraillette russe).

7 Mars 1944 Blessé à l’aine et à la main gauches :
La tempête souffle en rafales continues dans l’étrange paysage. Il faut que je retrouve mon unité. Je ne peux plus m’orienter, j’avance à l’aveuglette. Je me débrouille pour avoir le vent cinglant dans le dos et je file à perdre haleine durant de longues heures; le Mpi me ballotte autour du torse. Les bourrasques hurlantes m’accompagnent dans le fond de vallée. L’œil sur le qui-vive, toutes sortes de pensées vous assaillent : ne pas se faire surprendre, ruser avec plus fort que vous, avoir le doigt dans le gant perforé, prêt à l’usage sur la gâchette et le pistolet à portée de main. Les versants des deux talus semblent se rapprocher de part et d’autre de la cuvette, le défilé prend bientôt fin. Je m’avance, prêt à enjamber un pont de bois lorsqu’un guttural « Stoï » coupe mon élan. Une fraction de seconde plus rapide que le garde russe gêné par la neige virevoltante, je sors mon pistolet et lâche deux coups qui font mouche. Lui aussi, me décoche encore cinq balles avant de s’écrouler. Deux impacts perforent ma main gauche et les trois autres me labourent tout le côté gauche.
Heureusement pour moi, le chargeur accroché en réserve le long de l’aine dévie l’impact mortel de l’un des projectiles, lequel m’aurait sans doute perforé la colonne vertébrale ! La sentinelle et moi culbutons quinze à vingt mètres plus bas, dans le gué enneigé. Je me réveille une éternité plus tard : la lune répand sa lumière laiteuse sur le duo immobile que nous formons. Je mets un temps fou à reprendre mes esprits : je réalise bientôt que je me trouve en face d’un Russe qui me dévisage avec ses yeux vitreux. Non, il ne va pas encore me retuer. D’effroi, je veux lui arracher la mitraillette bloquée dans ses mains crispées. Peine inutile, son corps raidi tente dans un effort fugace de me résister dans une lutte de corps-à-corps irréelle. Lorsque je me rends compte que ma rafale décochée dans les décors n’avait pas de raison d’être, je recouvre progressivement la plénitude de mes moyens.
La douleur de l’épaule fracturée me fait horriblement souffrir mais je peux néanmoins bander ma main fracassée en la nouant avec un chiffon que je garrotte fébrilement avec les dents. Comme je suis bien ceinturé par ailleurs, je ne me rends pas encore compte de ma blessure au flanc gauche, seuls les pieds gelés m’arrachent des jérémiades continues. Mon cher Jean, ici tu ne peux moisir, il faut filer ! La fuite en avant : Je déambule dans la campagne enneigée, tombant par ci, me traînant à quatre pattes par là, en continuels bonds en avant. Une meule de foin se profile dans le décor, je m’affale devant l’entrée. Quelques soldats allemands y ont élu domicile ; un vieux bougeoir (Hindenburgerlicht) dispense sa clarté laiteuse sur ces fantômes abattus qui me déclarent vouloir se rendre aux Russes. « Der Krieg ist vorbei, la guerre est passée. » D’ailleurs, un vieux paysan les garde et s’arrangera à les livrer à la première patrouille le moment venu.
A leur mine défaite, je sais que mon espoir réside dans la fuite. Je quémande encore à un infirmier une piqûre contre le tétanos (j’ai la chance infinie de trouver un Sanitäter). L’ennemi a déjà investi les environs, je tente pourtant la sortie. Que d’efforts surhumains ai-je consentis pour extirper mon corps affaibli de la neige si exténuante ? Je tombe bientôt sur un abri dans lequel je sombre de fatigue. L’obscurité commence à étaler son ombre lorsque j’émerge de mon repos salvateur. Ai-je dormi six heures ? ou bien les aiguilles ont-elles fait le tour complet du cadran ? Je ne le saurais jamais. Qu’importe ! Ragaillardi, je repars de plus belle ; la neige bien enveloppante gêne mon avance. Soudain, des impacts de balles soulèvent des geysers blancs à côté de moi. Je devine au bruit lent de l’arme que c’est une mitrailleuse russe et je fais le mort dans un salto digne de cascadeur.
Merci à mes sauveurs russes :
J’ai repéré en point de mire une chaumière à moins de 500 mètres de ma position. J’y rampe avec l’énergie du désespoir, les ténèbres me facilitant la progression. Epuisé, je culbute à l’intérieur de la demeure. Une vieille dame et son fils de 10-12 ans me secourent. « Panje, du hapen fiel smertch. Monsieur, tu as beaucoup mal» me murmure le garçonnet dans un allemand approximatif. La brave dame s’active pour me réchauffer les pieds, me fait boire une tisane avant de me traîner avec l’aide du petiot sur une charrette. Elle me recouvre encore d’une pelisse tandis que le cheval s’ébranle. Les cahots sur la piste gelée m’arrachent des cris étouffés.
Le gamin me glisse un goulot dans la bouche : je sens la chaleur réconfortante d’une gnôle de piètre qualité mais qu’importe ! Elle me requinque les tripes. Le brave garçon inconnu, très prudent, s’arrête chaque cent mètres d’autant plus volontiers que les balles traçantes (accompagnées des balles perforantes) venues des deux lignes se croisent au-dessus de notre attelage qui bascule bientôt vers une vallée débouchant sur un village. Une lampe de poche amie s’attarde sur notre équipage et subitement, un formidable cri de joie troue l’attroupement. Mon Oberleutnant Frantz Müller qui m’a reconnu m’embrasse dans un mouvement de tendresse. Le gradé qui avait été blessé par une balle explosive à la tête (le 9 janvier) et dont le casque avait atténué la gravité de l’impact me prodigue des encouragements ; n’écoutant que mon courage, je lui avais, en effet, sauvé la vie à cette occasion. Une gratitude infinie nous liait depuis cette époque pas si lointaine.
Je suis évacué dans un char Tigre :
Au courant de la situation d’encerclement dans lequel sa compagnie va bientôt se trouver, Müller se sait condamné à la captivité. (Condamné à 15 ans pour la destruction du pont routier à Rostov sur le Don en tant que commandant d’unité, il fut libéré sept ans après). « Toi par contre, tu t’en sortiras du guêpier, je vais t’aider ! » Il appelle par radio un char Tiger dans lequel on me bascule. « Lebt wohl ! » Adieu mon lieutenant. Le blindé s’enfonce dans l’inconnu, je suis certes malmené par la puissance du monstre qui arrache tout sur son passage mais je fonce libre, avec l’état-major replié dedans, vers un aérodrome de campagne (est-ce celui de la ville d’Uman qui tombera le 10 mars 1944 ?) où rugissent les moteurs des Ju 52. Sous la mitraille, je suis éjecté de la tourelle et je tombe de tout mon long sur la terre gelée au milieu des déflagrations. « Lauf ! Cours ! » Je le fais tel un ressort. Je prends à nouveau quelques éclats dans les jambes, mon pouce droit est lacéré. Je cours à perdre haleine dans les tourbillons aveuglants de la neige soulevée par les hélices. La porte de la carlingue est ouverte, on me happe par le bras pour me propulser à l’intérieur. Au seuil de la mort, je réalise que seule une énergie folle vous permet de survivre.

Odessa vers le 10 mars ?
C’est à bord d’un avion Ju. 52 que j’atterris dans la ville d’Odessa enneigée, je ne suis pas très sûr de la date, étant mi- conscient. Une séance de lavage et de nettoyage est la bienvenue tandis que je fais l’impasse sur le manger. Ai -je les intestins perforés ? Le bras infecté m’inquiète. A partir de cet instant, j’allais errer seize jours dans la nature avant d’être opéré à Arendsee ! Je suis immédiatement conduit dans un hôpital. Je crois bien que j’étais plus mort que vif ; seule ma volonté de fer de jeune homme me permet de rester en vie. Durant cette escale, je me force à rester lucide et dégourdi car je sais que, dans la situation où je me trouve, je ne me réveillerai plus, vaincu par la souffrance. Dans ma semi-conscience, je vois une sœur-infirmière et un chirurgien s’adresser à moi pour que je leur réponde, et sans doute veulent-ils tester mes facultés pour savoir si je vaux encore la peine d’être soigné ! « Où devons-nous commencer ? - D ’abord, s’il vous plaît, opérez-moi le bras gauche qui cogne follement au point que je ne peux plus endurer cette douleur intolérable. - Oui, oui, jeunot, mais je constate que tu as encore une fracture de l’épaule gauche et une blessure à travers la hanche. Ta jambe gauche m’inquiète, tu as par ailleurs les deux pieds déjà tout bleus, c’est une engelure au second degré. - S’il vous plaît, occupez-vous en priorité de ma main et de mon bras, faites le reste après.
(On me découvrira encore une balle fichée dans la jambe droite). Le chirurgien prend ses ciseaux pour entamer mon bandage plâtré qui était englué de sang (ce qui l’avait durci davantage), il le découpe. La vision est horrible. Le pus s’écoule sous pression en morve verdâtre, il fuse à 20 cm de haut à travers les deux impacts de balle. Il pue affreusement. Les poux dérangés grouillent dans mon pansement pourri. Les paumes de la main commencent à gangréner, le bras est diablement enflé. L’infirmière se met sur le côté, on sent bien que l’odeur cadavérique l’incommode. Le chirurgien prend son scalpel et incise mon avant-bras tout comme le haut du bras pour que l’humeur brune toute sanguinolente qui s’y est accumulée puisse s’écouler. - Ce jeune homme a un cœur solide. Dieser Bursche hat ein gutes Herz. Ma sœur, administrez-lui une piqûre antitétanique. Et toi, mon gars, mords sur tes dents, je dois couper la chair putride. » J’entends encore qu’i1 appelle son infirmière pour envisager l’amputation. J’essaie de lui résister puis je sombre dans le coma sous l’effet de la douleur réveillée.
D’Odessa à Tarnopol :
Je perçois dans une vague lucidité que ma situation est indescriptible. Malgré tout je suis heureux, pour l’instant, de m’en être tiré à si bon compte même si mon état de blessé suscite les plus vives inquiétudes. Je retrouverai tous mes esprits bien plus tard, bercé par les trépidations d’un wagon à bestiaux qui m’emmène loin d’Odessa, bombardée par l’artillerie lourde ennemie. Une atroce odeur de pourriture s’exhale de notre wagon, la porte entrouverte revivifie l’atmosphère empuantie, la fraîcheur des lieux me réveille. Prenant mon courage à deux mains, je demande à l’adjudant-chef infirmier : «Etes-vous sûr que j’ai encore ma jambe ? mon bras ? » Je n’osais pas trop le constater de par moi-même. « Rassure-toi, tu es comme neuf ! » J’avais donc échappé à l’ablation de mes membres charcutés.
Après tout, le médecin avait dû revoir son analyse pessimiste relative à mon bras et à mes pieds. En tout cas concernant mon opération, je suis resté dans l’ignorance la plus totale ne sachant pas si de quelconques soins avaient encore pu m’être prodigués après l’opération d’antisepsie ; le coma dans lequel je végétais m’avait éloigné du monde réel durant quelques journées. Dans le wagon se trouve un poêle de campagne (Bunkerofen) qui dispense un peu de chaleur à l’intérieur. La puanteur est écœurante. Lorsque les miasmes sont trop pestilentiels, on ouvre la porte coulissante, pour un temps très court car le vent froid très vif y pénètre. Un peu d’oxygène bienvenu rafraîchit l’atmosphère méphitique. J’essaie de me soulever, il me faut aller au petit coin. Bienveillant, l’adjudant-chef infirmier me tend un pistolet. « Je te le viderai tout à l’heure. - Merci. D’où venez-vous ? - Je viens de Hamburg - Ettoi? - de Lorraine. - Tu es un engagé volontaire ? - Non! - Mais alors comment se fait-il que tu sois dans l’armée allemande (beim Barras) ? - Tu sais, notre Gauleiter Bürckel, (nous l’appelons par dérision Bürleiter Gauckel, par extension Gockel = coq) l’a ordonné.
Et c’est ainsi que de mon statut de Français je suis devenu Allemand ! - Tu me racontes des histoires. Est-ce vrai ? - Oui, je te le confirme. Je suis un Muss soldat (soldat obligé). - Chacun d’entre nous l’est aussi mais vous les Lorrains, vous êtes l’exception qui confirmez la règle d’un peuple allemand pris comme vous en otage par un système fasciste » conclut-il . Et voilà mon Hamburgeois qui commence à me parler en français ! Je suis stupéfait et je lui dis : « Où as-tu appris le français ? - J’ai appris l’anglais et le français, j’étais dans une grande maison d’importation de café où il fallait être polyglotte. Je suis venu deux fois à Calais avant guerre et je m’étais rendu une fois à Paris. Tu vois, j’ai 5 blessures de guerre et je suis maintenant dans les Services de santé. Tu sais, nous les Hamburgeois, nous sommes des commerçants. La politique ne nous intéresse pas ou plutôt, celle des BRUNS nous déplaît singulièrement ! - Qu’entends-tu par BRUNS ? lui demandé-je. - Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, j’étais membre de la jeunesse communiste, je me suis battu contre les S.A. (Sturm Abteilung) en chemise brune et au bout du compte je fais la guerre contre les Communistes ! - I l me semble que je rêve. Dis-moi, comment t’appelles-tu et d’où viens-tu exactement ? - Walter Bayer de Hamburg Altona. »
C’est incroyable que dans ce wagon de marchandises, au milieu de tant de misère, je puisse entendre quelqu’un s’exprimer en français et qui plus est, de manière audacieuse au point de fustiger les comparses de Hitler. Je lui demande : « Sais-tu où ce train nous emmène ? - I l se dirige sur Tarnopol et vraisemblablement encore jusqu’à Lemberg qui est la gare-terminus, ma foi si tout se passe bien ! - Que veux-tu insinuer par là ? - Si les partisans ne font pas sauter le train ou si Iwan ne nous submerge pas de bombes et ne nous jette pas dans le Dniestr, alors oui, tout ira bien ! - Est-ce que la situation est aussi grave ? - Oui, Iwan tente de percer à travers les Carpates. Déjà, plusieurs de ses pointes de combat cherchent à nous couper la voie ferrée sur laquelle nous circulons. La ville de Tarnopol est la cible, elle est devenue le point de mire des autres groupes blindés soviétiques qui vont chercher à la cerner par plusieurs axes de pénétration. Dans le wagon règnent la pestilence et les gémissements. La plupart des blessés sont très faibles, ne réagissent pas face à leur torpeur, et c’est mieux ainsi.
Comme mes blessures sont stationnaires, le valeureux secouriste me demande gentiment de le seconder. Je dois ainsi bloquer avec ma main plâtrée le bras noir d’un blessé qui hurle comme un cochon qu’on égorge. « Serre les dents, mon saligaud ! » dit-il au quidam. Avec une pincette, il lui arrache lambeau par lambeau sa peau brûlée avant d’extraire de sa paume une balle... sa propre balle de mutilé que le chef-infirmier jette avec dégoût contre la paroi. Puis il administre une gifle retentissante à l’automutilé qui tombe par terre. « A cause de toi, un autre va mourir ! » A quoi cela rimait-il d’aller dénoncer ce pleutre ? Nous roulons sans nous arrêter jusqu’à Jampol. A travers la porte entrouverte, s’engouffrent vent et fraîcheur. Depuis deux semaines, j’ai perdu la notion totale des évènements. Pris à nouveau de fièvre, j’ignore quel jour nous sommes. Je distingue seulement la journée de la nuit. Et le train continue d’avancer.
A Kamenets-Podolsk, c’est la halte. Nous recevons de l’eau et du café. On nous attribue aussi un breuvage chaud qui me fait du bien, avec quelques tranches de pain beurrées à la margarine. Un rapide contrôle pour vérifier s’il n’y a pas de morts dans le wagon, sans doute aussi un changement de locomotive et à nouveau roule, roule notre brave train. Puis le convoi arrive lentement en gare de Tarnopol et s’arrête au quai. Des infirmiers circulent de wagon en wagon et crient : « Les hommes arborant des affiches rouges sont à débarquer sur le quai. » L’adjudant-chef s’approche de moi : « Jean, surtout ne descends pas ici, je tâcherai de t’emmener le plus loin possible. Si tu te laisses débarquer ici, tu es un homme perdu. J’ai appris que les Russes ont percé en direction de Pinsk, d’autres unités sont passées à côté des marais du Pripet. Ils poussent à la fois sur Rovno et Tarnopol. N’entends-tu pas leur artillerie qui cogne tout près ? Les Russes ont accéléré leur avancée pour réduire le front d’Ukraine, leur artillerie s’entend déjà dans les proches localités. Ecoute, je t’arrache le billet de blessé grave, car, vois-tu, tous ces malheureux avec leur carton rouge vont être débarqués ici pour gêner intentionnellement l’avancée ennemie. Tu me suivras comme mon ombre ! » Une foule d’éclopés encombre les quais.
Pensait-on honnêtement que les charitables Russes allaient jouer les Samaritains et retarder leur avance pour les soigner ? Après le transfert des blessés graves sur les quais encombrés, les sœurs-infirmières nous apportent du café et du potage. Les tirs ennemis s’accentuent, sans doute pour détruire les liaisons ferrées. Notre nouveau convoi s’ébranle et arrive encore à s’extirper par miracle de la nasse.
Dieu merci, nous sortons de la zone du danger. « Jean, notre destination finale est Lublin, me susurre tout bas Walter. Là-bas, nos chemins vont se séparer. - Cher Walter, en aucun cas je ne pourrai jamais oublier ta précieuse aide. - Jean, des hommes bons existent partout même chez les Communistes ! - Je le sais, les peuples sont bons mais les SYSTEMES politiques détraqués rendent les gens malheureux ! - Oui Jean, les Allemands sont des soldats très courageux, sans rechigner ils accompagnent leurs officiers partout où le devoir les appelle, et même jusqu’au fond du gouffre, s’il le faut ! Mais ils sont de très mauvais révolutionnaires, en sus d’être des comparses (Mitläufer) d’un régime qui les conduira à leur propre perte. » Nous arrivons à la gare de Lublin. D’innombrables trains et transports de soldats stationnent les uns à côté des autres sur les voies.
Un haut-parleur hurle : « Soldats, remettez vos armes, il est strictement interdit de détenir une arme et de l’emmener à l’hôpital. Les contrevenants risquent des peines sévères. Achtung ! Prêtez attention ! Chaque blessé passera individuellement par la salle d’épouillage. Aucune couverture, aucun habillement ne pourront être emmenés. » Je m’arrange pour planquer mon ange-gardien métallique dans les triples caleçons. J’aurai la chance après l’opération de retrouver mon pistolet ainsi que la grosse bague (amulette et porte-bonheur de mon grand- père) que je portais autour du cou. Après les séances de nettoyage, des trains express sont mis en route via Varsovie sur Hamburg et sur Berlin. La ventilation vers les différents hôpitaux suit d’après une programmation bien définie. J’embarque en 1 ère classe, mais à partir de ce moment-là, je ne sais plus rien.
Au lazaret d’Arendsee :
C’est seulement deux semaines plus tard que j’émerge de ma torpeur. Je suis hospitalisé à Arendsee dans l’Altmark, non loin de l’Elbe, entre Wittenberg, Salzwedel et Magdebourg. L’établissement se nomme Schützenhaus. J’ai de vagues souvenirs à mon réveil. Nous sommes couchés, dans une salle, lit contre lit. Une infirmière m’entoure et me dit : « Jeunot, tu es maintenant chez toi, tout est passé, tu es ici comme à la maison... » Mon premier souvenir vague et confus me retrouve ficelé sur mon lit-des- souffrances.
Mes nuits tapageuses, si peu secrètes, ont dû glacer d’effroi les soignants : je hurlais ma peur dans les nuits si longues à voir le jour. J’avais à mes côtés, dans mes rêves de folie, la présence continue de fantômes démoniaques. Les trois-quarts de la chambrée hurlent également leur détresse ravalée : les blessés à la gorge, les brûlés affreusement rôtis, les trépanés sont solidement garrottés et crachent en d’affreux borborygmes la misère de la guerre. J’ai à côté de moi un caporal qui ne peut plus parler, ses cordes vocales sont perforées. Il s’appelle Edmond Kotowski ; il est originaire de Dortmund.
Lorsque les médecins s’adressent à lui, aucun son ne sort de sa bouche. Il avait été touché au cou, la cartouche était ressortie à 2 cm de sa colonne vertébrale. Puis, subitement, une nuit, il se met à parler : « Emil, Bertha, César, j’appelle » et il répète inlassablement son indicatif : il était téléphoniste (Melder). Les médecins viennent chaque nuit s’entretenir avec lui, je ne sais plus combien de temps, avant qu’il ne se décide à s’exprimer en plein jour ! Il y a aussi le Feldwebel Patmöller avec une horrible plaie à l’omoplate gauche provoquée par une balle explosive russe.
Et puis le sergent Joseph Alt, l’Unterscharführer (sergent SS) Harald Bögelsack, Gunther Kruppa de Berlin (un marin dégradé ayant œuvré sur une vedette dans le Pas-de-Calais). Il y a encore Bruno Wilk, un ancien sergent polonais, maintenant caporal-chef. La sœur infirmière est pleine de douceur ; je perçois dans une somnolence irréelle ses doigts de tendresse sur mon visage marqué. « J’ai perdu un fils qui te ressemble. Alors raconte-moi tes malheurs afin que je puisse les exorciser ! » Elle me rapportera par la suite mes propos décousus, mes cris de terreur, mes expressions russes incompréhensibles pour elle (elle les avait notées). Elle se préoccupe de moi comme une mère pour son enfant !
Souvenirs. Souvenirs...
Revenu progressivement à moi, je me débattais dans mon lit de tortures avec mes insomnies peuplées de visions diaboliques. Un général venait, tel un psychologue nous ressourcer : « Oubliez tout cela, chers compagnons. » Mais les images cruelles défilaient, intenables, dans ma conscience comme dans un circuit sans fin.
Je me souvenais durant le R.A .D . de ma formation à outrance dans la Kriegsabteilung.
Pour la Wehrmacht, cette instruction précoce de base, c’était toujours cela de pris. Logique de guerre ! Cette formation anticipée de fantassin avant l’heure, si vite assimilée auprès des jeunes, n’était plus à réapprendre dans le futur métier des armes. Je devenais un guerrier rompu aux subtilités et aux ficelles des combats à surmonter. Je me rappelais de mon travail juste derrière le front dans une escadrille de Stukas aux ordres de Rudel, l’as des as. Il fallait armer les avions, baliser les pistes. J’étais Waffenwart (aide-pourvoyeur) au Geschwader Immelmann.
Je me souvenais, à Lyon, du trafic de sous-vêtements de charme et de l’attentat manqué de peu.
Partant de Vienne, il m’arrivait de devoir convoyer et accompagner des soldats blessés et malades à l’hôpital de Lyon. Pendant qu’on les soignait, je profitais du quartier libre pour flâner et surtout pêcher « en eau trouble » la noire marchandise de luxe. Le capitaine Hanicka m’avait chargé de lui dénicher de la lingerie féminine, genre dessous coquins et bas nylon affriolants. Les marchands sollicités refusaient poliment toute transaction. Je tentais ma chance au foyer du soldat dont la surveillance était assurée par des gardes-mobiles français.
Je fis connaissance avec une belle Lolita -dont la mère avait été speakerine clandestine à la radio des Brigades rouges espagnoles -et qui me proposa de dénicher lesdites choses si prisées. En liant plus amplement conversation, elle me mit en garde contre les actes terroristes pouvant à tout instant frapper les Allemands. « D’ailleurs, me dit-elle dans un souffle, un officier allemand vient d’être abattu dans un square !
Fais attention, les résistants balancent des grenades sur les troupes éparses puis se fondent dans les immeubles, leur forfait accompli...» Me voilà prévenu et sur mes gardes. Deux jours après, j’accompagnais un adjudant dans l’annexe du Soldatenheim. Méfiant, je préférai plutôt emprunter la porte latérale que le grand portail avec son escalier imposant.
A peine franchi le seuil, je distinguai le départ lumineux de deux coups de revolver venus du fond sombre d’un couloir. Tandis que je dégainai pour tirer, le corps d’une innocente secrétaire tituba à quelques mètres de moi. Le hasard voulut que la malheureuse empruntât au même instant un vestibule perpendiculaire et me servît de bouclier humain. Elle fut tuée sur le coup à ma place. On boucla très vite le quartier. Un S.S. me demanda de relater les événements, je m’éclipsai en refusant de répondre à un interrogatoire, à mon avis soporifique. Ma petite amie en larmes fut heureuse de me retrouver sain et sauf. Je me rappelais de nos six jours d’errance dans la steppe.
Nous étions positionnés à 30 hommes, en ligne de crête, sur un mamelon-hérisson qu’il s’agissait de défendre contre vents et marées. Un beau matin, silence inquiétant ! La compagnie avait plié bagages, nous laissant seuls dans la mouise. Sans doute, une estafette affolée, chargée de nous avertir, s’était-elle planquée dans un coin et avait dû raconter, bien navrée, qu’elle n’avait pas retrouvé notre section ! L’adjudant Pausch qui nous dirige est un homme d’expérience, un de ces légionnaires qui font la gloire de la troupe et que toutes les armées du monde envieraient dans leur sein. Rompu aux ficelles du combat, il sut jour après jour nous sortir du Niemandsland élastique que nous tendaient ou détendaient les unités russes lancées sur nos talons. Nous suivîmes durant six nuits leur trajet parallèle, empruntant les forêts, les marécages et les hautes herbes, dormant le jour.
« Imprègne-toi toujours de la carte d’état-major, là où tu te trouves. En cas de coup dur, tu sauras où aller... » m’avait répété le Feldwebel durant la formation. Subsister avec l’eau croupie, manger crue l’oseille, dormir mouillés, patauger dans l’eau, voilà la carte de notre menu du jour renouvelée chaque soir. Le mois d’août chauffait la steppe, ce qui nous permit de surmonter les éprouvantes randonnées nocturnes. Mais un matin, une patrouille ennemie nous localisa : armes blanches et coups de feu eurent raison de cinq de leurs éléments mais deux des nôtres trinquèrent aussi. L’un, blessé au ventre, expira. Mais l’autre Kumpel (camarade) qui mettait notre vie en danger dut se plier au fatidique diktat : « Tu restes, on t’arme.
Ou tu te suicides ou tu fais confiance aux Russes. Choisis ! On ne peut pas te brancarder, avec toi sur la civière les copains exténués se feront déquiller. Maintenant, c’est chacun pour soi, hélas sans toi... » Lorsqu’on approcha enfin de notre ligne de front et qu’on hurla désespérément en allemand, rien n’y fit, nos propres gars tiraient sur nous ! Nous étions coincés entre le marteau et le svastika. L’adjudant nous groupa trois par trois. « Qu’importe si les deux ou trois premiers groupes vont essuyer les plâtres, il faudra bien que nos mitrailleurs se rendent compte de leur boulette à un moment donné ! » Les trios fonçaient à intervalles réguliers.
Lorsqu’on s’aperçut enfin de la méprise, cinq des nôtres gisaient étendus dans le décor. Un officier, hors de lui, s’emporta : une corvée administrative l’attendait avec des rapports fastidieux à pondre où il lui fallait expliciter l’impair à sa hiérarchie. L’horrible bonhomme explosa lorsqu’il s’aperçut que quelques-uns des nôtres avaient troqué leur Schmeisser, une mitraillette fragile comme une montre, contre des armes russes si rustres ! Les Heeresdientsvorschriften (instructions règlementaires de l’armée) étaient bafouées. « Valait mieux pour nous ne plus être revenus » siffla l’adjudant, amer entre ses dents !
Je me souvenais de la misère des combattants bloqués dans la steppe.

Quand tu avais attrapé la gale (Krätze), tout ton corps frissonnait, tu te grattais jusqu’au sang. L’infirmier te donnait une poudre, tu te déshabillais dans l’abri et un camarade te saupoudrait de ce truc blanc (Zeug). D’où venait la gale ? Sans doute des poux d’habits, de ces amis inséparables aux mœurs sanguinaires. Le seul moyen de les exterminer était de bénéficier d’un quartier libre auprès d’une station d’épouillage (Entläusungstelle). Mais joie de courte durée, ils se multipliaient comme le chiendent dans le blé. Une autre maladie, la fièvre wolynienne laissait plus d’un fantassin patraque. Les ganglions enflaient, de vrais nœuds sous les aisselles, suivis de ballonnements dans le bas-ventre et d’une hyperthermie paralysante. Tu pouvais à peine remuer, tellement tu te sentais faible.
Tu éprouvais une telle soif et personne n’était là pour l’étancher face à tes tremblements de dents, tes frissons, ton haut-le-corps. Si le médecin disposait de quinine, il t’en administrait. Mais il faudrait t’envoyer au Lazarett ! Mais où se trouvait-il, ce putain de lazaret ? Crever... et tout serait achevé.
A voir ton camarade lui aussi atteint, tu devinais ses pensées. Ses cernes, ses traits émaciés trahissaient son inquiétude. Tu étais bien impuissant devant sa détresse. Pourvu qu’il se rétablît avant qu’Iwan n’intervînt ! Autre fléau calamiteux : la fièvre des marais (Sumpffieber) que les infirmiers désignaient sous le vocable de malaria, maladie infectieuse provoquée par les moustiques femelles. Les fièvres, les suées, les tremblements sans fin, les vomissements, parfois, accompagnaient les forts accès. Quinine ! Quinine ! J’avais toujours trois comprimés avec moi. Dès que je percevais les signes avant-coureurs, je prenais un cachet. Prudence n’est-elle pas mère de sûreté ? Vorbeugung ist die Mutter der Porzelankiste ! Et puis tu souffrais de la chiasse (Dünnschiss).
Elle arrivait parfois si vite que tu n’avais pas le temps de déboucler ton ceinturon que déjà la tarte-maison enveloppait le pantalon. Pas question de changer de sous-vêtements face à l’ennemi, et où d’ailleurs les prendre ? Que faire dans cette puanteur à faire fuir un fossoyeur ? Lequel de nous était assez maniaque pour s’embarrasser de papier- chiottes ? Le papier journal servait à rouler les papirossa qu’on remplissait de mahorka pour les fumer en guise de cigarettes. Comment t’essuyer ? C’est simple, tu prenais de l’herbe, un bout de chiffon, tes mains ou autre chose pour enlever ton cadeau poisseux. Les mains, tu te les nettoyais dans la neige ou tu les rinçais avec ton urine.
Tu avais même de l’eau chaude à ta disposition ! Oui l’homme est un cochon qui s’ignore avec la vie de chien qu’on lui fait mener dans la bauge de son existence ! Par ailleurs, pas question de te promener au-dessus de ton trou ou d’aller aux feuillées dans la haie voisine, l’œil malin du fusil adverse t’avait vite dans son collimateur !
Je me souvenais des cinq escadrons de cavalerie cosaques, des volontaires kalmouks.
 Ils avaient établi leur base autour de la Plagna, une contrée basse, marécageuse, englobant une espèce de lac ovale de 8 x 15 km d’étendue où les partisans pullulaient dans les recoins reculés et impénétrables. Caractéristiques de la troupe cavalière : habits feldgrau, épaulettes rouges pour les cavaliers. Les chefs suivant leur grade avaient des barrettes argentées. La patte-de-col avec deux épées croisées était identique pour l’homme de rang jusqu’au lieutenant. Sur la casquette fourrée, on avait brodé une cocarde avec deux épées croisées en rouge. Chaque tribu arborait un bandeau de couleur différente au bras. Leur chef portait une chéchia, les officiers le bonnet d’Astrakan. C’étaient tous des volontaires qui combattaient pour les Allemands depuis l’été 1942. Ils provenaient des villages de yourtes établis dans les steppes kalmoukes et se disaient ennemis jurés des Soviétiques. Beaucoup étaient originaires de la région d’Elitsa et avaient suivi avec armes et bagages, femmes et enfants, la 16ème Division d’infanterie motorisée : cette dernière unité avait comme emblème les fameux chiens courants, on l’appelait die Windhunde. Depuis l’automne, ces milices pro-allemandes avaient été impliquées pour chasser les partisans dans les marigots inextricables de la Plagna. Un chef d’escadron avec qui j’avais fumé lors d’un ravitaillement de vivres qui m’avait conduit dans leur base (cf. dessin du haut), m’avait avoué que ses hommes étaient impitoyables. Le gradé qui s’exprimait bien en allemand me tapa amicalement sur l’épaule : « Petit Français, tu peux compter sur nous, nous ne faisons pas de Plennis, de prisonniers. Il me serra la main : « Lorsque tu reculeras, nous avancerons. Nous mourrons pour que tu vives. Ne nous oublie pas ! »
Ils avaient établi leur base autour de la Plagna, une contrée basse, marécageuse, englobant une espèce de lac ovale de 8 x 15 km d’étendue où les partisans pullulaient dans les recoins reculés et impénétrables. Caractéristiques de la troupe cavalière : habits feldgrau, épaulettes rouges pour les cavaliers. Les chefs suivant leur grade avaient des barrettes argentées. La patte-de-col avec deux épées croisées était identique pour l’homme de rang jusqu’au lieutenant. Sur la casquette fourrée, on avait brodé une cocarde avec deux épées croisées en rouge. Chaque tribu arborait un bandeau de couleur différente au bras. Leur chef portait une chéchia, les officiers le bonnet d’Astrakan. C’étaient tous des volontaires qui combattaient pour les Allemands depuis l’été 1942. Ils provenaient des villages de yourtes établis dans les steppes kalmoukes et se disaient ennemis jurés des Soviétiques. Beaucoup étaient originaires de la région d’Elitsa et avaient suivi avec armes et bagages, femmes et enfants, la 16ème Division d’infanterie motorisée : cette dernière unité avait comme emblème les fameux chiens courants, on l’appelait die Windhunde. Depuis l’automne, ces milices pro-allemandes avaient été impliquées pour chasser les partisans dans les marigots inextricables de la Plagna. Un chef d’escadron avec qui j’avais fumé lors d’un ravitaillement de vivres qui m’avait conduit dans leur base (cf. dessin du haut), m’avait avoué que ses hommes étaient impitoyables. Le gradé qui s’exprimait bien en allemand me tapa amicalement sur l’épaule : « Petit Français, tu peux compter sur nous, nous ne faisons pas de Plennis, de prisonniers. Il me serra la main : « Lorsque tu reculeras, nous avancerons. Nous mourrons pour que tu vives. Ne nous oublie pas ! »
 Je me souvenais de ce toubib aux armées qui avait charge de corps et qui aurait dû être l’émanation même de la déontologie.
Je me souvenais de ce toubib aux armées qui avait charge de corps et qui aurait dû être l’émanation même de la déontologie.
Des milliers d’entre eux ont été des thaumaturges quotidiens, des faiseurs de miracle permanent. Que dire de l’attitude de ce couard qui demanda à se faire automutiler sa main ? Sa main si adroite pour ligaturer, couper, panser, guérir, secourir ! Une rafale venue de l’arrière du groupe les emporta, lui et sa main. Il est vrai que des deux côtés de la barrière, il existait différentes catégories de salauds, des Dreckschweine que je qualifie de criminels. J’appelle assassin le copain qui élimine cinq prisonniers russes qu’il doit conduire de nuit et seul au poste de commandement. La peur a fait de lui un lâche ! J’appelle meurtriers, les soldats d’en face qui exécutent dans un entonnoir creusé par l’obus leurs prisonniers à la grenade. Malheur aux vaincus !
Je me souvenais dans le Kouban d’un officier assassin qui obligea huit de ses hommes à aller s’emparer pour la gloriole d’un drapeau russe près de Novorossisk en juillet 1943.
L’attaque réussit mais deux des nôtres restèrent sur le carreau. Fier comme Artaban, le gradé déroula le fanion au pied du colonel. « Je vous l’offre, Herr Oberst ! - Vous êtes tous fous ! A quoi sert cet héroïsme, avez-vous à déplorer des tués ? - Mon colonel, à six nous sommes partis, à six nous sommes revenus pour la gloire du Vaterland ! » L’enfoiré avait menti et deux innocents avaient «glorieusement » disparu des tableaux de l’effectif, morts en héros !
Je me souvenais de la bataille de la Wotanstellung,

Le 9 octobre 1943 à une heure inhabituelle, l’une des plus sanglantes batailles de la campagne de Russie. Le Maréchal Tolboukhine attaqua avec 45 divisions d’infanterie, 2 divisions d’infanterie motorisée, 3 corps de chars et 2 corps de cavalerie, soit 800 chars, 400 batteries d’artillerie, 200 orgues-de- Staline ! Sur un front de 15 km, l’artillerie soviétique martela comme un marteau-pilon nos positions, à raison de 15000 obus à l’heure, soit un obus par mètre. (cf. Terre brûlée, Verbrannte Erde de Paul Carell, éditions Robert Laffont) Autour de nous, des gémissements qui vous serrent la gorge ! Des gars blessés perdant tripes et sang en abondance perdaient la raison et s’enfuyaient ! La chance aux rares survivants dans cette terre labourée ! Plus de roulante ! Plus de pain pour tenir le coup ! Plus d’emballage orange à entrouvrir pour goûter la margarine si douce ! Rien sinon les tirs, le maintien désespéré des lignes sans cesse éclatées, la mort. Au soir du 27 octobre, la 111 ème Division d’infanterie dont je faisais partie ne comptait plus que 200 hommes !
Je me souvenais d’Oktoberfeld,
ce champ de récoltes macabres. Un adjudant et moi occupions les ruines d’une cave avec ses pans de murs déglingués, en plein milieu du champ de bataille. L’infanterie russe s’infiltrait entre les masures. Les T.34 roulaient et grondaient comme des chiens de garde autour de nous. « Ne t’avise pas à tirer, me dit-il . Découverts, nous n’aurions plus aucune chance de nous en sortir... » Le bonhomme, un vieux de la vieille, savait maîtriser sa conduite au lieu de piaffer comme les héros d’opérette au moindre éternuement. Non loin de nous, les Russes chargeaient les morts, les blessés et même les prisonniers sur les carrioles à ridelles. Nous fîmes superbement les fantômes, saupoudrés de plâtras, en mimétisme parfait avec les pierres démolies. Un peu plus tard, une contre-attaque allemande bouscula l’emprise ennemie. Nous étions les uniques rescapés.

Je me souvenais des attaques-surprises des Iliouchine I et II(avions monomoteur et bimoteur).
Dans leurs cabines blindées, les pilotes de ces oiseaux-de-fer déchaînaient le feu céleste. Je me souvenais plus particulièrement... de cette attaque des avions Stormovik sur nos panzers. Plusieurs blindés brûlaient. De la tourelle environnée de flammes, sortit mon illuminé, les bras vers l’avant, mû par une énergie décuplée et qui s’avançait vers moi. J’ai dû tuer l’infortuné tankiste, agenouillé devant moi, pour lui abréger ses souffrances alors qu’il grésillait comme une torche de suif. Est-ce comme ça en Enfer ? Je me souviendrai à vie de cet inconnu qui se carbonisait devant moi, sans recours face au Monstre de feu qui le dévorait à grand feu. L’odeur de chair grillée m’oblige aujourd’hui encore à détester le poulet.
Je me souvenais des Pressluftgranaten (obus à air comprimé).
Ces obus, lorsqu’ils explosaient au sol, provoquaient un souffle d’air comprimé qui faisait éclater les poumons des hommes (leur emploi est interdit par la Convention de La Haye). Lorsque nous avons dû reconquérir les berges du Dniepr, l’artillerie allemande y envoya une salve de ces obus soufflants. A peine débarqués de nos Sturmboote, avons-nous escaladé la rive pour créer une tête-de-pont. Dans un périmètre de cinq cents mètres, les morts, nombreux, présentaient tous des visages bleuis, aux oreilles et nez sanguinolents. Pour nous intimider et faire cesser l’envoi de ces pétards mortels, un message ennemi nous fit comprendre qu’en cas de récidive, la réplique serait terrible. Les Allemands acculés avaient-ils pioché dans les fonds-de-tiroirs pour y dénicher ces dotations extrêmes ? Quel était le pourcentage de ces engins meurtriers par rapport aux obus classiques ?
Je me souvenais du tir aux grenades de phosphore.
Dans la panoplie des différentes classes d’obus figuraient également ces machiavéliques obus libérant le phosphore. J’ai ainsi eu le malheur d’arpenter un champ de bataille où s’étaient concentrés les obus phosphoriques des deux camps. Des geysers immenses, illuminés par une pluie de mille feux répandaient une fumée blanche au sol. Malheur aux fantassins frappés par cette liquidité qui, telle le plomb en fusion, perforaient les peaux humaines en cuisant les chairs, allant parfois même jusqu’à la perforation des membres atteints.
Je me souvenais de la façon de creuser un abri,
Dans le sol gelé pareil au béton alors que nous étions pressés par l’ennemi. C’était d’ailleurs une calamité lorsqu’il fallait s’enterrer dans la gangue dure comme du granit, histoire de se mettre au plus vite à l’abri. L’astuce consistait à faire uriner plusieurs hommes à genoux à l’endroit choisi, extraire la terre ainsi réchauffée, y placer un explosif de 100 g et le faire détoner. L’excavation grignotée permettait d’y placer une seconde charge plus importante et par ce biais, élargir la fosse, avec en fin de parcours un pétard de 3 kg. Bonjour les dégâts ! Le terrier était ensuite recouvert de troncs et autres branches : il constituait, en attendant mieux, un havre salutaire face aux avions, ou une écurie d’appoint (Notstallung) lors des feux roulants ou durant les intempéries.
Je me souvenais du Fünf Fingerverteidigungsystem,
De ces installations de mitrailleuses placées en éventail comme les 5 doigts de la main, et réparties tous les 60 à 80 mètres, le long de notre ligne de défense. Les faucheuses étaient secondées par une première ligne de couverture de canons de 20, eux-mêmes épaulés en seconde ligne par les redoutés 88. Camouflé, érigé en réseau constitué de barbelés, de chicanes et autres tranchées en zigzag, ce dispositif visait à rendre notre glacis impénétrable. En cas de charge héroïque de l’adversaire, la Aristellung située à quelque 5 km à l’arrière, venait à la rescousse avec les gros calibres. Un adversaire qui aurait par extraordinaire pu se glisser dans ce labyrinthe devenait alors une proie facile. Mais ce dispositif, faute de moyens de couverture aérienne et par manque de munitions, ne joua plus, par exemple lors de ma retraite du Kouban et sur la ligne Wotan, un rôle très efficace. La machine-à -perdre était en route...
Je me souvenais de mes corps-à -corps,
je me souvenais du poignard russe qui m’avait presque éborgné (j’en garde une cicatrice bien vivace au front !), je me souvenais de la horde sautant la tranchée et qui me piétinait au milieu des dépouilles. Je me souvenais de mon premier mort, cet inconnu ennemi et adversaire, mais un homme comme moi, où le plus rapide des Grabendolch (poignard de tranchée) eut le dernier mot. Je me souvenais... que la vie ne tenait parfois qu’à un fil, qu’il fallait en toutes circonstances être le plus félin, le plus véloce pour brandir et dégainer la lame, qu’il fallait les yeux bandés pouvoir remonter en un clin d’œil toute arme et garder comme un viatique, toujours prêt, le pistolet de secours. Ces épisodes continuent de tambouriner comme des voix prisonnières sur mes tympans, j’entends encore comme si c’était hier mes paniques, mes cris d’effroi.
Je me souvenais de mes combats à l’arme blanche.

La terreur du Russe que l’on savait intraitable, -les soldats de la Garde l’avaient clamé haut et fort qu’ils ne feraient pas de quartier !- faisait qu’on se battait jusqu’à la dernière extrémité. Les copains avaient juré de s’entraider, de résister et de braver plus fort qu’eux pour sortir l’ami du pétrin. Savez-vous qu’on utilise l’arme blanche plus souvent qu’on ne le croit, surtout lors d’attaques- surprises sur les postes de garde ou lors de coups-de-main. La baïonnette classique donne de piètres résultats. Lorsqu’il faut asséner d’estoc, la prise en main de l’arme doit être ferme. Le poignard de tranchée ou le coutelas de parachutiste étaient plus appropriés dans les barouds. Il avait même fallu sortir des cartons les anciennes armes de 14-18, les affûter en bilames acérées dans les étaux des armuriers à l’étape arrière.
C’est qu’en face, les cocos étaient mieux lotis ! En effet, les tribus asiates avaient fabriqué des rasoirs aux lames biscornues, barbelées, à quatre filets (d’ailleurs interdits par la Convention de Genève à cause des blessures qui se ferment et provoquent des hémorragies internes), des coupe-choux aux noms magiques : kandjars, kriss, yatagans. Au fur et à mesure de l’expérience acquise, la formation avait appris aux recrues les points vitaux à frapper (comme dans les écoles des gladiateurs) : coup sec en remontant sous les côtes, percussion de bas en haut dans la région du cœur, ou rupture des artères du cou et des épaules par le tranchant de la lame.
Le cercle de défense se résumait à la longueur du bras. Vif comme sait l’être un prestidigitateur, il fallait sortir l’arme en un éclair (l’extirper de la botte était un geste trop long, cette fraction de seconde de retard profitait à l’adversaire). Un dispositif astucieux fait de lanières maintenait le fourreau à hauteur du sternum, la préhension pour saisir l’arme était alors ultra-rapide, il fallait l’avoir à portée de main pour prendre l’avantage....
Je me souvenais de l’épisode du puits lors de la grande retraite du Don vers le Dniepr.

Je stationnais dans un gros bourg en compagnie d’une unité en réorganisation. La nuit précédente, un partisan fut horriblement mutilé par l’explosion d’un colis piégé (EZ mine 200 g) en l’occurrence un bidon que l’infortuné avait soulevé par curiosité.
Cet inconnu ignorait que les Allemands disposaient de détonateurs à ressort aux effets imparables. Cette nuit-là, je peux l’affirmer maintenant, la garde allemande dans l’abri échappa à la grenade du curieux. Il avait eu pour mission de neutraliser les sentinelles et sans l’anicroche du colis piégé, sans doute aurions-nous été salement éprouvés.
La grenade qu’il camouflait explosa en même temps que le détonateur et le charcuta horriblement. Se sentant en pays conquis, la Wehrmacht faisait parfois preuve de naïveté auprès de la population qu’elle pensait acquise à sa cause. D’innombrables recrues (Hiwis) apportaient d’appréciés services mais les rendaient également aux Russes. (Ici deux Hiwis qui travaillaient pour notre unité viennent à ma rencontre. Ils traversent la Schlauchboot-brücke qui enjambe le Sucho Elancik au sud de Ekaterinovka.
Menacés par la poussée ennemie, nous déménagions nos forces en direction de Maloklisanovka, photo prise le 14 octobre 1943). J’avais eu l’insigne chance d’être retiré huit jours du front (9-16 janvier 1944) et je passais en solitaire des moments de détente à l’arrière. Attablé, je savourais ces instants de rêverie, une cigarette aux lèvres.
Je fus bientôt intrigué par les manigances d’une matka qui s’approcha du puits pour y faire descendre de... lourds seaux mais qui en remontait des vides ! Je la suivis et bientôt je la tins en joue avec mon pistolet. « Tu es devenu fou.Que fais-tu ? C’est une innocente ! » s’écria un forgeron de l’équipage du Train, outré par mon attitude, alors qu’il était occupé à ferrer un ardennais non loin de là.- Va me chercher le capitaine, et tu comprendras ! »
Pour corroborer mes dires, on attacha à une cordelette cinq ou six grenades à main qui explosèrent dans le puits. Une grenade asphyxiante y fut balancée. Provenant du fond, quelques gémissements s’entendaient. Après la disparition des volutes de fumée, un volontaire descendit dans le boyau et remonta l’unique rescapé, un blessé qu’on s’empressa d’interroger. Tous, nous venions de l’échapper belle. Le commando avait eu ordre de nous anéantir la nuit même.
Je me souvenais de la puissance de feu terrifiante que deux sections russes en marche pouvaient distribuer.
Accolés, les bras dans les bras, ces intrépides fantassins avançaient, leurs mitrailleuses-camemberts trouant l’adversaire comme du gruyère. Que pouvaient faire cinquante fantassins allemands avec leurs carabines à cinq coups ! Une force de frappe de sept mille balles contre un bouclier de deux cent cinquante ! Que voulez-vous qu’ils fissent ! Qu’ils mourussent !
Je me souvenais de mon retour au front dans la tête-de-pont de Nikopol.
La nuit du 26 novembre 1943 était d’un calme laconique, pas d’événements particuliers à signaler sauf qu’à 7h 30, les avions blindés Iliouchine nous survolèrent et nous réveillèrent pianissimo. Les damnés engins avaient adopté une technique bien simple : lancer d’une hauteur de 200-300 mètres des séries de bombes éclatantes, puis descendre comme des vautours sur nos positions et nous arroser avec leurs salves. Un feu mortel brillait et sortait des gueules fixées dans leurs ailes. Cela craquait dans tous les coins. Les pilotes cabraient leurs lourds monstres pour reprendre de l’altitude ; latéralement à mon trou, un avion ennemi frôla le sol avec sa roue arrière. Je saisis mon arme lourde et je tirai sur le mitrailleur arrière qui disposait d’une mitrailleuse 12,7 à balles explosives. L’aéronef grimpa. J’encadrai tout de suite l’appareil ailé d’une gerbe de balles fusant de ma MG. Mes tirs ricochèrent sur la carcasse et la cabine.

La bête volante en réchappa, ce n’était pas de veine ! Les moteurs rugissaient et les explosions crépitaient toujours plus assourdissantes et couvraient les appels au secours « Sani, sani ». Mais qui donc oserait s’aventurer hors des trous alors que le combat faisait rage ? Vers 8 heures, les premières troupes de choc se pointèrent avec un démoralisant «Urräh ». Groupées comme des processions de fourmis conquérantes, elles dégageaient un mur de feu.
Nos mitrailleurs attendirent l’ordre de tir et dégorgèrent des bandes entières qui vidaient les caisses de munitions trop vite à leur goût. Les escouades renouvelées ne se décourageaient pas. Notre système « 5 doigts de la main » fonctionnait admirablement. Les attaques furent jugulées. La nôtre allait démarrer. « Baïonnette au canon ! En avant ! A l’attaque ! Hurra ! » et nous voilà à sauter hors de nos tranchées.
O mon Dieu, quelle vie misérable ! Plutôt être mort que de choir blessé, de rester cloué au sol sans défense et de ne pas pouvoir être ramené à l’arrière. La vengeance de l’ennemi était si cruelle. Vers 10 heures, notre estafette fut touchée : la balle tirée à courte distance lui avait fait faire un salto.
C’est presque impensable qu’un homme de 65 kg puisse voler en l’air ! Il présentait une blessure horrible au visage, au-dessus de la mâchoire supérieure. Sa tête doubla de volume. Deux camarades se précipitèrent sur Assel qui ne donnait plus signe de vie. Je suggérai que nous l’enterrions dignement dès la fin des tirs d’artillerie. Je lui pris son livret militaire et je lui brisai sa plaque d’identité en deux. Malheureusement pas moyen de l’inhumer, le feu adverse s’amplifiait et une contre-attaque se dessinait. Des tirs sauvages provenaient de nos scies-de-Hilter (mitrailleuses) et les grenades accompagnaient bruyamment l’attaque. « Baïonnette au canon ! A mon commandement, en avant, marche. » A travers le bruit d’enfer, sautant par- dessus les troncs qui pourrissaient dans la vase du marais, nous avançâmes. Ywan était coriace et ne reculait qu’à petits pas. Entretemps la nuit était tombée. « Mon cher Assel, tu n’auras pas de tombe. Ne nous en veux pas.
On a pensé honorer ta mémoire et respecter tes dernières volontés. Hélas, ce n’était pas possible. » Vu la fureur des combats et la lassitude, les morts de la journée ne trouveraient pas de sitôt une sépulture décente..... Mais le lendemain l’adjudant Pausch me rapporta qu’Assel vivait, qu’il avait été ramené à l’arrière par les brancardiers. « Ce n’est pas possible ! Alors voici sa plaque et son livret qu’il faut lui rendre. Dire que nous voulions l’enterrer vivant !!! Mon Dieu que je suis content, pourvu qu’il s’en tire !»
Je me souvenais de mes sorties nocturnes,surtout l’une d’elles.
Le lieutenant avait décidé de faire un coup-de- main. Foutue guerre ! Nous nous reposions à dix kilomètres de la ligne du front après avoir enduré une semaine d’intenses assauts. A peine installés depuis vingt-quatre heures pour goûter un semblant de quiétude méritée, et déjà sonnait le rappel ! Dès 15 heures, nous avions été mis sur le pied de guerre. Un cherry brandy de 3/4 litre pour deux ragaillardit les énergies vacillantes en ce début de décembre. Explosifs, grenades, mines furent distribuées. On avança dans la nuit qui tombait. La position d’artillerie (Ari Stellung) fut dépassée. La difficulté commença ensuite, il fallait maintenant ramper, sous peine de servir de cible à des tireurs d’élite patentés. Un obus éclata au hasard. Pourvu, pensais-je, qu’il ne provoquât pas l’allumage automatique de la mine sur mon dos (Zündübertragung) ! En file indienne, le cul au ras des touffes d’herbe persillées par le gel, on avança vers les postes des mitrailleurs allemands établis sur la HKL. Des fantassins nous renseignèrent sur le mot de passe. Les tireurs de sMG avaient été informés de notre rentrée aux alentours de minuit : deux fusées vertes à une minute d’intervalle sonneraient notre retour. De sa main pointée, un sergent nous indiqua le passage obligé. « Attention aux deux Schützenminen (genre de mines anti-personnel) à 20 mètres du grand entonnoir ! »
Un garde nous y accompagna pour neutraliser les engins. (Le fil-piège qu’un pied ennemi pourrait accrocher par inadvertance en s’approchant des postes serait à nouveau tendu cette nuit même, après notre retour). Notre artillerie était également prévenue : deux grenades sifflantes (Pfeiffgranate) lui indiqueraient une forte résistance subie de notre part dans le Niemand’s land et interviendrait alors pour participer à notre dégagement. Ach, la proverbiale minutie teutonne, réglée comme sur du papier à musique qui ne laissait rien au hasard ! L’incursion en pays hostile débuta. A pas feutrés, chacun se coulait dans les pas de l’autre et retenait son souffle. Il fallait profiter du temps couvert et d’un vent léger pour capturer l’observateur avancé. Des lucioles éclairaient de temps en temps la campagne au relief indistinct. Pourvu qu’on ne tombât pas sur une patrouille russe composée de têtes brûlées, ne reculant pas même devant le Diable !
Le lieutenant faisait passer ses consignes par signes de la main : arrêt prolongé, silence, en avant, stop, baissez-vous sont des messages universellement connus et que le commando déchiffrait sans problème au fur et à mesure de notre progression. Notre attente, les nerfs sur le qui-vive, dura des heures. Un baroudeur rejoignit l’officier. La masse éventrée d’un blindé d’un modèle dépassé gisait entre des levées de terre retournées. Les mains moites, la sueur perlant sur ton front, la gorge sèche étaient les signes de tension extrême que tu vivais. Deux éclairs de lame. Trois bonds. La cache était vide....
Je me souvenais d’avoir rampé parmi les cadavres gelés
À leur dérober le sac à provisions : rations de guerre, croûtons, biscuits secs emplissaient mon havresac. Et dans la pénombre, je me sciais au poignard des tranches de cette nourriture appréciée. Elle avait parfois un goût doucereux, et au matin, je découvrais le sang séché d’un camarade sur la tranche brunâtre. La faim est une méchante consommatrice qui ne recule devant aucune pitié !
Je me souvenais des tournées d’inspection du juteux dans notre Erdbunker.
A côté du ’pitaine, vous aviez son sous-fifre, la peau-de-vache maison, je veux nommer le juteux Kneifer, Prussien dans l’âme. L’animal ne tolérait aucune entorse au règlement. « Ihre Bude gleicht nach einem Saustall ! Votre gourbi ressemble à une porcherie ! » hurlait-il en essuyant ses bottes cirées (à la margarine ?) sur notre litière faite d’enveloppes provenant de cosses de maïs. S’imaginait-il que notre abri devait ressembler à la salle de garde du Alte Fritz ? Le plafond de notre cambuse était fait de rondins de bois et de planches de tout venant. Notre bunker n’avait rien d’extraordinaire : on y descendait par un escalier protégé disposant de pare-éclats latéraux pour briser l’impact des satanés éclats de mortier. Le Spiess tenait à ce que les marches d’escalier fussent toujours décrottées quand sa majesté arrivait. Monsieur ne venait qu’aux beaux jours lorsque le soleil de Crimée avait asséché les couloirs de circulation ; autrement, il nous fichait une paix royale surtout quand il pleuvait ou qu’il dégelait par exemple.
Je me souvenais de mes tours de garde dans la tranchée.
Je battais interminablement la semelle contre le parapet, mon esprit vagabondait. J’essayais parfois de comprendre la stratégie militaire, mais ramenée à mon humble échelle, j’y perdais mon latin. Je pensais au fond de moi-même : « C’est terrible ! Iwan ne t’a personnellement rien fait, il faut qu’il te tue ou que tu le tues s’il ne le fait pas, voila résumée ma dialectique ! Si tu cours vers les lignes russes en exhibant un papier du National Freies Deutschland, si tu cries « Sdajus, ne strelatje » es-tu sûr d’être sauvé ? Peut-être te retrouvera-t -on énucléé, torturé, abattu à bout portant ? Crois-tu espérer la clémence des redoutables unités de la Garde de Staline, lorsque, de tes yeux, tu as vu les crimes abominables commis, sexe enfoncé dans la bouche des malheureux ? Non, tu ne pourrais jamais t’enfuir chez les Russes ! Avez-vous déjà pataugé deux heures continues dans le Schlamm ? Lors des gardes interminables, les bottes humides vous fripaient les pieds, la glaise rébarbative en séchant s’écaillait comme une mue. La bruine fondait les décors, vous étiez seul face au danger. Vous voyiez encore devant vous un casse-cou, parfois deux : c’étaient des observateurs avancés qui scrutaient le paysage et renseignaient l’artillerie. Missionnaires rompus aux sacrifices de la messe allemande, ces héros brandissaient le sabre pourfendeur sur l’athée rouge. Ils étaient logés comme des ermites ; un peu d’eau, une ration de guerre, des armes réconfortaient leur âme de vengeurs.
Dans le froid vif, nos vestes camouflées à double revers s’avéraient idéales pour affronter le rude hiver. L’un des côtés était blanc et se confondait avec la campagne enneigée. L’autre face était innovante : le tissu de camouflage ne se laissait pas détecter par l’infrarouge du char adverse ! Un capuchon que je qualifierais de formidable nous protégeait du froid mordant, il suffisait de tirer et de nouer le cordon au plus près du cou.
La paire de gants était attachée à une cordelette pour en éviter la perte. Le gant droit était muni d’une échancrure qui permettait d’assurer la mobilité de l’index. Finis les doigts collés sur le chien de fusil gelé ! Sous l’enveloppe humaine pouvait aussi se cacher la bête immonde, acculé comme le rat dans un recoin et qui saute à la gorge du ratier pour l’impressionner. La guerre le voulait ainsi : pour sauver sa peau, l’homme devenait un loup. Ses gestes calculés et calculateurs avaient été cent fois refaits et analysés. « Si Ywan culbute la ligne devant toi, que fais-tu ? » Trois grenades prêtes et amorcées, le pistolet dans le revers gauche de la veste et que tu dégaines en une seconde, le poignard huilé que ta main mille fois entraînée fait jaillir du fourreau docile, voici ton credo. Tu t’appuyais bien évidemment sur la fiabilité de ta mitrailleuse. Les cartouches et le mécanisme de percussion étaient protégés de l’humidité par la toile de tente, bonne-à -tout-faire. Les bandes avaient été soigneusement repliées dans les caisses, chaque cinquième balle était une traceuse pour guider ton tir ravageur. Tu étais prêt, l’œil en alerte, le doigt flexible. Dans le paroxysme de l’affrontement, la cantate monotone serinée par les sMG fredonnait le requiem in aeternam. Que d’innocentes victimes allaient encore tomber, proies de l’arbitraire !
Que d’orphelins, de veuves partiraient encore remplir de leur tristesse la Vallée des Larmes ! Et toi, étais-tu heureux de ton sort, justicier de mes bottes ? Un cochon en première ligne vivait très mal sa condition. Il avait faim, il avait soif, il avait froid, il était fatigué, il était submergé de poux et de puces, il s’écroulait de fatigue, vaincu par la misère des lieux. Que valait cet homme grognon ? Peu de choses ! Si la machine humaine crevait et qu’elle bénéficiait d’une chance posthume d’être enseveli, on lui pliait sa plaque d’identité en deux, on en prélevait la moitié, on récupérait le Soldbuch et les affaires personnelles qui étaient transférés au poste de commandement. La bête ou du moins sa carcasse était signalée comme éliminée. Le chef de compagnie allait écrire un mot de condoléances à l’eau de roses qui contenait tout un pâté d’expressions compassionnelles : « ce fut un valeureux soldat, mort en héros (sur le coup sans souffrir) pour le Führer, le peuple, la patrie... »
Un mort était à nouveau à remplacer ! Ohé la recrue ! Vite ! Par ici ! L’effectif étant à nouveau rempli, tout redevenait d’aplomb. Le cher macchabée avait rejoint le Walhalla, le ciel des Germains. Le capitaine détendait sa crampe d’écrivain public, le facteur ramènerait la missive à la veuve de guerre, les gosses arboreraient le crêpe noir. Que savait-on en fait de ce compagnon de route arrivé au bout du chemin de la vie ? Célibataire ? Marié, Qui pourra assécher les torrents de larmes de son épouse éplorée, de ses parents catastrophés ? Comment oublier la peine infinie dans le regard des orphelins ?
Je me souvenais avec délices du repos bien mérité qui suivait le tour de garde lorsque je revenais vers mon poste d’accueil,

Enterré et façonné habilement par les pionniers, notre trou rectangulaire était surmonté de poutres, de troncs disparates et de branchages qui alternaient avec la terre étalée sur plusieurs couches. La tranchée débouchait par un double coude vers l’intérieur de l’abri ; ses méandres servaient à bloquer net tout éclat d’obus tombant à proximité. Des clous fichés dans tous les coins accueillaient les frusques, un fil ébarbé servait de sèche-linge au-dessus du fourneau rustique.
Tout un bric-à -brac pendouillait et tapissait les alcôves. Le rentrant avait toujours une place attitrée près du poêle alimenté avec les cosses égrenées du maïs. Il enlevait son casque, se coinçait dans le tas des endormis, ceinturon libéré, sac à pain déposé. Puis, réchauffé, il tranchait son pain avec le poignard, positionnait les tranches sur la tôle bien chaude.
Au préalable, il fallait vérifier si des têtes-de-girofle grillées (poux) n’embarrassaient pas la plaque du petit fourneau. Le feu devait seulement couver car la télémétrie russe était précise et plus d’un obus envoyé trop près étouffait nos jurons. Mais en baissant l’ardeur du foyer, on provoquait la colère de la sentinelle relevée qui ne pouvait pas chauffer sa gourde, griller son pain ou sécher ses bottes et ses habits.
Comme la neige sucée avait perturbé son estomac, il lui fallait réactiver sa circulation avec un breuvage fumant. L’idée de siroter un café ersatz te faisait oublier le pétrin quotidien. Un sourire malicieux barrait bientôt ton visage : les poux venus se frotter comme des coucous à ton panse-bête, étaient récoltés avec hargne dans le duvet velu et grillaient en tournicotant sur la tôle. Tout à l’heure, la sentinelle relevée allait gratter la plaque du poêle bricolé, elle essuierait le poignard des rognures carbonisées avant de griller une tartine bienvenue....
Je me souvenais de mon cadeau de Noël 1943.
Avec d’autres frères d’armes, j’avais été retiré de mon unité pour une formation poussée me permettant l’accès au grade d’élève-officier K.O .B . (Kriegs Offiziers Bewerber), en compagnie exclusive de sergents, moi-même n’étant que caporal-chef. Le cours d’instruction (Lehrgang) portait, en cette avant-veille de Noël, sur les charges creuses H.3, mais il avait été allégé en raison des festivités. L’ambiance était à la kermesse : la bière (Steinegger Bräu) coulait à flots. Des chants fusaient, des prières étaient marmonnées.
Mon ami, le sergent Winter avec qui je partageais le séjour de l’instruction, marié, deux enfants, originaire de la Hesse, n’était visiblement pas dans son assiette. Fébrile, il m’apparaissait, en plus, assez nerveux, incontrôlable dans ses réactions et très tendu comme si une prémonition funeste l’avait déjà prévenu de son sort. « Morgen früh, wenn Gott es will, werde ich wieder bei dir sein ! Demain matin, si Dieu le veut, je serai à nouveau à tes côtés ! » me dit gravement le sergent Winter. - Ne radote donc pas avec tes sombres pressentiments » fis-je en éclatant de rire pour le rassurer, Staline nous laissera tranquille pour Noël, symbole de la Paix dans le monde !
Le lendemain, après que notre section ait surmonté une première incursion de l’ennemi alors que j’étais de garde, le tant redouté cri d’alarme « Panzer, Panzer » retentit subitement dans le froid glacial. Des explosions trouèrent à nouveau l’air et firent se dresser Winter, l’air hagard et absent. Sacrébleu, des blindés venaient spécialement nous gâcher la fête solennelle de Noël. Affolé à la vue des monstres blindés, le malheureux s’élança, courant éperdu entre la meute. J’avais vainement hurlé « Winter, Wiiiinter ! mais bon Dieu, couche-toi ! » pour qu’il s’aplatisse, mais les cliquetis féroces des chenilles et les vrombissements des véloces engins l’avaient littéralement fait disjoncter. Il fut étendu comme une crêpe dans un magma informe et sanguinolent. Face à la vague meurtrière, j’ai frappé le sol de mes poings vengeurs. Le capitaine cherchait à me raisonner.
Rien n’y fit : j’avais juré la perte du trouble-fête ennemi. Il faut savoir que lorsqu’une vingtaine de tanks russes s’aventuraient entre nos lignes, deux seulement en moyenne retrouvaient leurs bases de départ. Les tankistes ennemis étaient souvent chargés de faire des actions d’incursion et de dérangement (Störaktionnen) pour tâter les lignes de résistance allemandes. Lorsque le dispositif du Fünf Finger System fonctionnait, que les canons de 2,2 cm puis les canons de 8,8 étaient bien positionnés en première et deuxième lignes de couvertures, les heures des T.34 étaient comptées.
En effet, dans les trous individuels installés dans la première tranchée, nos mitrailleurs et leurs pourvoyeurs, rappelons-le, avaient la mission de hacher l’infanterie d’accompagnement et de faire sauter les monstres en tirant sur des points névralgiques, tels les bidons d’essence d’appoint. Rompu aux ficelles de la guerre, le tireur vétéran se décaissait un abri à double sortie pour éviter l’écrabouillement lors de la patinette du char. Les plus téméraires d’entre eux profitaient de l’angle mort pour lui propulser une charge magnétique (Wurfmagnet) sur la structure métallique tout en tirant sur la cordelette pour armer la mine.
« Adresse, sang-froid, détermination doivent être les qualités premières du trompe-la-mort ! », nous avait seriné inlassablement le formateur. Il faut reconnaître qu’une meute de chars en ordre d’attaque, c’est terriblement impressionnant sur le mental du soldat posté en première ligne. Souvent, le fantassin reste comme pétrifié et oublie de laisser passer les monstres pour avoir, à son tour, leur structure arrière plus vulnérable en ligne de mire.

S’il tente de fuir devant eux, il est perdu. Au contraire, s’il se terre et accroche les troupes qui accompagnent l’assaut des blindés, l’attaque ennemie perd de sa consistance. Les chars ennemis, sans leur logistique d’appoint, passaient pour des cercueils ambulants.
C’est facile d’en parler mais ceux qui connaissent cette peur qui prend à la gorge et qui vous glace le sang dans les veines, sont tous de mon avis : il faut une sacrée dose de maîtrise de soi-même pour ne pas flancher dans pareille situation. Rappelons aussi que, pour ce qui a trait au combat rapproché pour lequel j’avais été formé (Einzelkämpfer), tout est différent.
Le tueur de chars était un type choisi pour son self-control devant le danger, notamment pour son inébranlable attitude lors des attaques de panzers ennemis sur nos positions. Lorsque le craqueur place sa charge creuse H.3 (Haft-Hohl-Ladung 3kg) magnétiquement adhérente par ses tripodes sur la paroi du blindé, il doit s’arranger pour que deux ventouses au moins sur les trois de la mine adhèrent à l’acier. Le collage ainsi assuré permet de tirer le cordon détonateur sans risquer de voir culbuter la mine sur le sol, faute d’attraction aimantée suffisante.
Difficile à décrire la personnalité de cet homme : est-ce du courage simplement ? ou ce petit plus du P’tit poucet qui ose affronter plus Goliath que lui ? Peut-être aussi cette forme d’inconscience de l’homme jeune qui croit aux vertus militaires et aux sacrifices qui en découlent ? ou finalement la terreur de tomber vivant entre les mains sanguinaires des unités blindées de la Garde de Staline ? Facile à dire, moins facile à faire quand il faut faire le bond hors du trou individuel et affronter le mastodonte dans un angle réduit, hors de la vision de l’équipage.
Sincèrement c’est un quitte ou double, vous n’êtes plus dans un état normal. Ce sont des gestes appris, précis, ordonnés et pilotés par une force qui jaillit brutalement du fond de votre habitus. Etais-je à l’époque des faits, un kamikaze sans le savoir ? Toujours est-il que l’entraînement maîtrisé avec la H.3 vous conférait une puissance phénoménale destructrice, surtout avec le Brennzünder de type 7,5 qui vous laissait moins de 8 secondes pour déguerpir ! Je déraisonnais, troublé par la mort de mon ami. Inconsolable devant le corps de Winter si horriblement mutilé par les chenilles du char, et peu enclin à accepter les ordres du Hauptmann, je ruminais ma vengeance. Le ciel trop clair ne prédisposait pas à une attaque latérale de ma part. Malgré la terreur qu’il inspire, le T. 34 a d’incroyables angles morts qui le conduisent souvent à sa perte. Tel un tueur programmé, j’attendis que le blindé revînt sur ses pas. L’obscurité s’était étalée ; ce fut un jeu d’enfant de lui coller derrière la tourelle ma mine, de contourner l’engin et de m’aplatir au moment où l’explosion le souleva de terre. J’en réchappai avec une surdité bien ancrée depuis cette affaire... »
Je me souvenais... dans les transes de mon être torturé, de la destruction de mon deuxième T. 34,
Cette fois-ci avec un Panzerfaust. Durant notre formation de craqueur de chars, on nous avait appris que la roue motrice à l’arrière, ou bien les engrenages de transmission pris pour cible, surtout lorsque l’animal cuirassé présentait son flanc de trois-quarts, constituaient quelques-unes de ses graves faiblesses. D’autre part, l’autonomie de parcours des tanks russes étant limitée à quelque 150 km en terre détrempée, le ravitaillement incessant en carburant obligeait les tankistes à disposer de deux réservoirs de secours sur leur structure arrière, endroit vulnérable par excellence. Mes balles incendiaires (Brand-munition) firent exploser l’un des containers en un feu d’artifice grandiose. Le conducteur s’arrêta, visiblement gêné par l’embrasement de son engin. Je réussis à m’approcher au plus près du char. C’est mon poing armé (Panzerfaust), projectile thermo-fusible approprié pour dompter la bête, qui eut raison d’elle !
Je me souvenais de Marchetti.
Ma confession à l’infirmière me ramenait à des visages que j’avais laissés à la fureur de l’ennemi. Ainsi, mon copain Marchetti originaire de la région du Haut-Adige, ou du moins son fantôme, virevolte devant moi encore aujourd’hui. Nous étions en pleine débandade dans la steppe uniforme avec des compagnons de différentes unités regroupées. On nous avait assigné une ligne de résistance à préserver : une Igelstellung, une position en hérisson. Il fallait impérativement maintenir à distance les troupes ennemies. Nous disposions d’un bon stock de munitions ; les silhouettes se tenaient à carreau face à notre mitrailleuse prolifique. La grisaille de la journée était émaillée par l’envoi d’éclairs de magnésium pour les empêcher d’approcher. Marchetti était sympathique : «Parli tedescho, Franchese ? Parles-tu allemand, toi le Français ? »

Nous devisions, dans notre trou, de choses et d’autres lorsqu’à nouveau la furia adverse chercha à nous anéantir. Durant tout l’après-midi, je fis défiler mes cartouchières pour freiner l’ardeur ennemie. Seul l’homme aux nerfs d’acier était capable de combattre.
Perdant les pédales et le contrôle de lui-même, l’Italien se leva soudainement et cria : « Pan, iddi souda» et s’affala au bord de son trou, affreusement touché à la hanche. Arrive derci, Alto Adige ! Adieu Heinz ! Je continuais de tirer mais la dilatation du tube surchauffé bloqua mes rafales. Ladenhemmung ! Enraiement ! « Tire ! Mais tire donc ! » me criait désespérément Heinz, le Gebirgsjäger (chasseur alpin). Quelle poisse ! Le tube déformé ne voulait pas s’extraire. Heinz, de la gauche, sortit de son trou et déboula dans le mien avec un fût de rechange.
Il s’agissait de faire vite, les Russes profitant du temps mort pour courir vers nous. D’un coup de botte frappé sur le levier d’extraction, j’arrachai le tube rebelle qui chuinta et grésilla dans la boue. Mes doigts brûlaient, j’enclenchai le mécanisme. Miracle, la bande mortelle re-défilait. J’aperçus le sourire de Heinz et ses mains jointes qui imploraient la miséricorde divine. Il me dévisagea, puis s’approcha, intrigué, pour toucher ma blessure au front et constata avec moi qu’une balle de tireur d’élite s’était coincée dans la hausse de tir ! Le choc sur l’arme qui avait percuté voilà peu mon casque avait provoqué l’estafilade sur ma poire (Birne). La pression ennemie s’accentuait ; certains de leurs tireurs ne nous laissaient plus de répit. Soudain Heinz s’écroula, terrassé. Je cherchais à le retenir dans sa chute. Mais son corps inerte s’affala, un bloc de sang coagulé qu’il vomit encore m’éclaboussa. Pauvre type ! Pour moi, sans doute cela serait bientôt la fin. J’entendis la mitrailleuse qu’on repositionnait en face, je tirais comme un forcené. Les Russes allaient m’avoir, c’était certain. En m’empêchant de faire feu, ils s’appliquaient à placer leur aboyeuse en tir plongeant sur mon abri. « Ils ne m’auront pas » fis-je en plaçant une grenade amorcée sous le menton. Des larmes de désespoir impuissant coulaient. Vive la vie, maman !« Maman, aide-moi ! Si tu me sors du pétrin, je te ferai lire des messes d’actions de grâce au couvent de Téterchen ».
Ma maman partie si jeune en me laissant orphelin à trois ans m’a indéniablement sorti de l’enfer ! J’avais l’impression qu’un brouillard salutaire et qu’une brume bienvenue épaississaient la contrée comme le voile d’un manteau protecteur. Je n’allais plus m’embarrasser de l’arme, je la jetai, je courus, plongeai, me ratatinai dans l’herbe, m’éjectai pour atterrir toujours plus loin, hors du piège mortel. Au bout de 20 mn de ce jeu du chat et de la souris, j’arrivai devant nos lignes. Un claquement sec de mitrailleuse qu’on arme et la double sommation d’usage me firent hurler de colère. Les sentinelles circonspectes savaient que devant elles il y avait un homme qui ne connaissait pas le mot de passe. Un pas de plus, et il était mort. « Leck mich am Arsch... ». C’est finalement grâce à cette expression scatologique que je leur tombais dans les bras. Dans notre unité, nous avions instauré de tels mots de code et de passe pour revenir dans nos lignes. On me ramena au bunker où un capitaine chafouin semblait me cataloguer comme suspect. « Vous n’avez donc pas entendu tout au long de 1’après-midi la pétarade de nos armes à la gauche de votre position ! » explosai-je, hors de moi. Il me réclama le Soldbuch, je lui découvris d’un geste rageur mes décorations.
Je me souvenais de mes implications dans des unités nouvelles (Sprengtrupp, Pionier),
sans cesse re-complétées où les gars hébétés et écrasés laissaient venir. « Sais-tu prier ? » me fit l’un d’eux comme sur un ton de reproche. « Oui, tous les jours, j’implore la mère de Dieu » lui répondis-je, et il mourut à cet instant, frappé en pleine tête.
Je me souvenais d’une montée au front un peu particulière.
Un capitaine à cheval nous ramenait au front. Il paradait sur son canasson, évitant la poussière flottant sur la piste que nous, nous avalions. La piétaille avançait vers l’abattoir. Monsieur, l’air important, nous houspillait constamment. Sans doute allait-il rater sa partie carrée ou je ne sais quelle soirée de luxe. Un avion russe en goguette nous survola en battant des ailes. Mystère ! Aucune balle ne fusa de l’avion chasseur, mais nous, par instinct de conservation, nous plongeâmes tous à couvert tandis que l’élégant cavalier, précieux dans son attitude, mit un certain temps à descendre de sa bête ! Un coup de feu partit alors.
Un de mes voisins venait de tirer sur le gradé. Le geste n’avait pas non plus échappé à un lieutenant qui fit superbement l’ignorant, c’est-à -dire celui qui avait vu sans rien voir. Le Hauptmann tira deux coups de pistolet en l’air, histoire de rassembler la troupe et découvrir le coupable. « Désignez-moi le stupide imbécile qui a attenté à ma vie ! » Le silence se fit dans les rangs. Pour éviter à la halte prochaine un contrôle minutieux propice à retrouver l’arme concernée, l’audacieux profita de la marche pour nettoyer son fusil. Le lieutenant, un Sarrois, ne pipa mot. Etait-il communiste ? Craignait-il des représailles de la troupe solidaire contre lui en cas de dénonciation ? Le capitaine ne s’attarda pas : sans doute méritait-il maintenant une distinction pour sa bravoure, Retrouva-t -il les lambris feutrés d’un bon ministère après ce coup d’éclat ?
Je me souvenais de Jenior le caporal-chef,

Cet affreux qui avait osé voler un jambon fumé à une mémé russe. Mon sang n’avait fait qu’un tour. « Jenior, laisse ça sinon tu me passeras sur le corps ! »
J’étais provisoirement chef de section, le lieutenant m’en avait confié le commandement.
Nous étions arrivés devant une minable cahute à faire peur à un ermite ! Une dame se roulait de désespoir dans la boue après avoir constaté que sa cachette avait été éventée et son sac de jute dérobé. Jenior et moi, nous nous toisâmes.
Les hommes s’étaient regroupés, anxieux quant aux conséquences de la bagarre. D’une volte- face, j’assénai le plat de la crosse dans la figure du voleur qui s’écroula par terre.
Pour ne pas l’abaisser davantage, j’allai vers lui et lui intimai l’ordre de se relever.
Honteux qu’on eût pu lui rabaisser le caquet, il me proféra des menaces. « Je t’attends, mais tâche d’être le plus rapide ! » lui répliquai-je. Ses ecchymoses virèrent du bleu au noir en passant par un vert tendre.

Pourtant il ne me dénonça pas et devint au contraire un frère d’armes qui eut une mort injuste. En voici les circonstances : En janvier 1944, les tanks russes nous attaquèrent en fin de nuit.
Notre contre-attaque menée avec des Sturmgeschütze et de l’infanterie montée bouscula l’offensive. Nous investîmes un village puis menâmes une rapide attaque.
« Jungs ! Einzelfeuer ! Ne gaspillez plus vos munitions, au coup par coup ! » Une vingtaine de morts et de blessés gisait dans le secteur. Nous avancions bien espacés, le doigt sur la détente.
Jenior se tenait à droite de moi avec son fusil- mitrailleur. Un blessé russe levait les bras au ciel, je lui fis signe de rester couché et d’attendre les secours.
J’ai encore en moi la vision de l’enragé qui se saisit brusquement d’un fusil pour descendre le mitrailleur. « Jenior ! Atten... tion ! »
Survint le bruit assourdissant d’une détonation et voilà Jenior, touché de plein fouet.
Oui, les malheurs de la guerre suicidaire et le jusqu’auboutisme ont expédié cet ami ad patres. Mon voisin se rua à son tour sur le Russe et lui pulvérisa la cervelle.
« Arrête, inconscient ! Tu commets un crime de guerre! A cause de ton geste déplacé, d’autres souffriront de ta démesure. » Ce Russe héroïque avait appliqué les consignes : tuer l’officier ou le mitrailleur qui étaient des gens précieux, difficiles à remplacer.
Je me souvenais de l’ami mosellan bloqué comme observateur avancé dans un trou individuel rempli d’eau.
Le coin était vallonné, semé de haies qui constituaient autant de pièges. Planqué en haut d’une colline, il était relié à notre poste par un téléphone à fil (Stripe) ; une galerie savamment camouflée permettait d’accéder à son abri. Soudain, un cri précédé d’une explosion sourde retentit dans le secteur. Nous appelâmes le bonhomme : pas un bruit. « Je vais le chercher ! - Non, tu vois bien qu’il est foutu ! C’est de la folie ! T’es dingue ! Il y a un tireur d’élite avec son lance-grenade qui vous attend au tournant ! Après de longs palabres, nous décidons d’aller le chercher. Nous avons rampé sous les volées des obus de mortier en cette fin d’après-midi pour récupérer l’infortuné. Les Russes nous lâchaient des salves. Le malheureux était écroulé dans la boue, baignant au milieu d’une mare de sang. « Vite ! il faut le retourner ! Son cœur bat ! » Horreur, le ventre était ouvert : il fallut le bander. Je m’aperçus que le malheureux avait été émasculé, castré à jamais. Son sang collait comme une dette de reconnaissance à mes mains qui trituraient son bas-ventre pour récupérer et ressouder l’essentiel. Nous le hissâmes hors du trou, chacun tirant le corps avec le fil de téléphone sectionné que nous avions récupéré. Boum ! Sous les explosions, nous rampâmes dans la gadoue et épousâmes la terre. Ouf ! Tu es sauvé, mon cher Aloyse ! La cohésion « Tous pour un, un pour tous » était parfaite car on savait comment le Russe traitait les rescapés. Alors mourir pour mourir, autant le faire héroïquement pour sauver les copains !
Je me souvenais du bon peuple russe.

Les femmes russes que je rencontrais étaient d’humbles créatures, pareilles à ma maman que j’avais perdue si jeune, à toutes les mères du monde.
Chaque matin, à mon retour de commando, je venais embrasser une grand-mère bien adorable. Elle comprenait ma situation, je comprenais la sienne. Le peuple russe est bon : des femmes, des filles aux pieds nus venaient spontanément nous offrir le sel et le pain ! Malheur à vous, femmes si l’on vous a vu pactiser avec l’ennemi, votre frère !
Vous serez éventrées, violées, pendues pour ce signe d’hospitalité ! Beaucoup de villageois nous considéraient comme des sauveurs qui venions balayer à jamais l’idéologie rouge, honnie par ces gens simples de la campagne qui aspiraient à une existence simple, sans contrainte du Parti (cf . photo d’une manifestation de villageois ukrainiens favorables aux Allemands).
En attendant de travailler pour un monde meilleur, le communisme avait surtout instauré depuis deux décennies un régime de terreur en dékoulakisant la propriété pour en faire du collectivisme forcé.
Les Nazis, au lieu de s’appuyer sur les nationalismes retrouvés, instaurèrent la terreur dans les campagnes. Bolchevik kaputt ! Germanski Sibirien. Staline contre Hitler.
Les Soviétiques firent montre d’intelligence, ils surent reconquérir leurs populations en revalorisant leurs sentiments patriotiques, en parlant de la guerre sainte livrée à l’ennemi héréditaire, en évoquant l’héroïsme d’Alexandre Nevski (héros national russe ayant battu les Suédois à la bataille de la Néva) !
Pourtant brimée par les plans quinquennaux staliniens, l’humble nation, orthodoxe de cœur, fataliste dans l’âme, sut se forger un courage légendaire.
Les armées de la Garde -reliquat du tsarisme- furent recréées : on fit embrasser le drapeau à des millions de Russes, ce fut comme une intronisation à l’ordre nouveau ressuscité. Les prisonniers russes étaient autant à plaindre que leurs homologues allemands. La guerre en soi est horrible : c’est toi le vainqueur, tu peux décider de la vie ou de la mort d’Abel.
J’ai eu une conversation avec l’un d’eux, un Mongol. Encore une épithète blessante pour ces humains, venus forcés des steppes d’Asie Centrale.
Etaient-ils des Kirghizes, des Ouzbeks, des Kazakhs, des Ossètes ? Ils étaient là pour défendre le petit père des Peuples.
Il m’offrit son rasoir, en fait, un couteau acéré qui lui venait sans doute de ses aïeux, une relique. Je lui offris mon paquet de cigarettes.....
Je me souvenais de mes patrouilles, surtout de l’une entreprise début décembre 1943.
Le brouillard était dense, il s’agissait tout spécialement d’ouvrir l’œil, sinon les deux. De l’activité incessante troublait le glacis : il nous fallut donc aller voir ce qui s’y trafiquait. Nous avançâmes, Ywan en fit autant ce soir-là. Nous appelions cela « abtasten, tâtonner » et le pire se produisait toujours au retour du no mans land que nous avions arpenté sur des kilomètres. Moment sublime pour nous qui avions marché dans la ouate au point d’avoir perdu tout repère ! Où étions-nous ? Intrigué par notre approche, un tireur de sMG, sur ses gardes, voulut le mot de passe, sauf que celui chez qui l’on se pointa dépendait d’une unité voisine et ignorait le précieux sésame formulé chez nous. Comme il n’entendait rien, il arma. A nouveau le mitrailleur méfiant réitéra son ordre. Il ouvrit le feu auquel en écho lui répondit toute la contrée soudainement mise en alerte, avec des feux de Bengale comme décor.
Ce soir- là, au milieu de notre patrouille qui revenait au bercail, il y eut soudain des tirs courts et rapides, suivis de cris accompagnés d’une débandade. Ainsi, des Russes intrépides avaient pu s’approcher à portée de voix du poste, prêts à liquider la sentinelle, ici diablement perspicace ! et qui sait, une fois installés dans la place conquise nous fondre également dessus dans la foulée, au moment de notre prise de contact avec eux ! Que faire pour convaincre le bonhomme que nous étions d’authentiques Landser ? Heureusement nous avions établi un code, une deuxième Parole entre nous. Si le fantassin souvent stressé ne retrouvait plus son mot de passe (qui changeait tous les jours), il usait du LmaA ! (Leck mich am Arsch, lèche-moi le cul, permettez ici sa tournure triviale !) Le tireur nous demanda de venir les mains en l’air, vérifia par une ultime marque de sécurité si nous connaissions les noms des chefs de section et de compagnie et nous laissa plonger dans le fossé. Cela pourrait vous apparaître amusant sur le papier, mais en réalité le cœur s’affolait rageusement et les tempes cognaient. C’était l’instant où chacun devait garder son self-control et ne pas paniquer, les doigts étant à cran sur la gâchette. A peine étais-tu arrivé dans la tranchée bienheureuse, dare dare tu fusais vers l’abri que tu rejoignais épuisé et où tu t’affalais exténué.
Les mains moites, la sueur perlant sur le front, la gorge sèche étaient les signes de la tension extrême que tu venais de vivre. Tu cherchais l’air au bord de la rupture. Puis une cigarette que tu ne maîtrisais pas dans tes mains tremblantes, une flamme affolée sortant du briquet, trois ou quatre bouffées arrachées goulûment qui suffisaient pour la réduire en cendres, te calmaient progressivement. On nous compta. Qui manquait ? Combien de pertes ? Et retour dans le bunker du P.C. où un rapport était dressé oralement au lieutenant (ou au responsable) qui le diligentait par radio jusqu’à la hiérarchie établie à l’arrière qui voulait savoir s’il y avait eu succès ou échec de l’opération.

Du hast wieder Schwein gehabt, tu as eu à nouveau de la chance. C’est par ces mots laconiques que tu chassais du revers de la main la pluie de terre sur tes habits. Ton copain, der Kumpel du Tyrol, était un homme comme toi et moi (cf. photo). Tu le trouvais sympathique parce qu’il t’aidait à partager la misère qui était aussi la sienne. Pas un mot plus haut que l’autre ! Sûr de lui, il inspirait confiance. Il crachait comme toi dans les mains pour nettoyer les éboulis dans la tranchée, s’armer d’une pioche pour excaver davantage le poste d’observation et écoper l’eau jaunie des fossés. Il demeurait d’un calme olympien dans l’abri lorsque les mortiers catapultaient leurs torpilles ailées sur la ligne et il n’hésitait pas à monter sur le parapet pour scruter en face.
Ce n’était pas un égoïste : parti accomplir sa ronde, la place qu’il te laissait avec la tisane prête t’apparaissait comme un gage d’amitié. Il n’était pas loquace, c’était un gars du terroir. Ses propos reflétaient la sagesse séculaire d’un fils de la terre. Ses pensées vagabondaient vers son train de cultures que son vieux père et la frangine avaient tant de mal à gérer. Il y avait bien le prisonnier français de 1940 qui suppléait le vide et consolait l’âme sœur, mais que savait-il, ce Gaulois, des racines familiales, que comprenait-il au sol sacré de la patrie ? Tu avais sondé le Tyrolien pour connaître ses sentiments politiques. Il t’avait dit de manière habile dans son patois savoureux ce qu’il pensait de tout le Quatsch, de ces sottises et qu’il n’avait qu’une hâte : retourner cultiver son jardin.
Le Berlinois, l’effronté Sperling, ce moineau de banlieue avec sa grande gueule et son franc-parler, ne mâchait pas ses mots avec l’adjudant. Râleur invétéré, il zézayait en te parlant du Zswindel, (ce marché de dupes) et du Zstacheldrahtverbau (réseau de fils de fer barbelé) que lui et ta pomme allaient à nouveau devoir réparer. Il avait ses têtes et te sachant Français, il épinglait au mur de la contestation les affreux de tous les régimes. « Tu sais, dit-il, les nazis ont instauré une dictature de la Race qui écrase ceux qui n’ont pas les mêmes idées. A la limite, tu te tais et tu nages dans leur courant, ils te fichent une paix royale. Moi, je ne suis pas de leur bord et je peux me permettre de le dire ici avec tout ce qu’endurent nos familles laissées au pays. Mais tu vois, de l’autre côté chez Iwan, ce n’est pas mieux ! Ils avilissent l’individu et veulent mouler dans un carcan de fer le pauvre peuple qui en fera toujours les frais dans cette lutte des classes.
Détenant l’immense majorité, ce cher peuple ne connaît pas sa force ! Poussé à bout, il défait les rois et culbute les régimes. Prenez garde, puissants ! » J’aimais bien la compagnie de mon perroquet, gouailleur, toujours en verve pour sortir le bon mot. Pourtant ces derniers temps, les nouvelles de la capitale n’étaient pas roses pour lui. Goering, le pourfendeur de la Royal Air Force, qui s’était renommé par rodomontade Oncle Mayer si d’aventure un avion anglais avait l’outrecuidance de venir déverser ses cargaisons de bombes sur le Vaterland, était voué aux gémonies.... Assis en rond d’oignons autour du poêle chacun apprenait à connaître les individus de son groupe. Le râleur était vite mis à l’amende : corvées de nettoyage, pose de mines calmaient ses humeurs. La guerre si proche, à un jet de grenade, plaçait tout le monde sur le même pied d’égalité. Plus de demi-mesure ! Ici chaque bras était précieux, chaque homme, du plus humble eu plus honoré, devenait irremplaçable comme les maillons d’une chaîne !

Je me souvenais des spécialistes du portage de repas, les Spezi- Essenholer.
Vers le soir, les chercheurs de repas chauds se préparaient. Vers 17h 30, ils collectaient les gamelles et partaient à travers les tranchées vers nos cantonnements à l’arrière. Attention au cliquetis des gamelles, un tireur d’élite adverse attendait le passage des proies ! A 19 heures passées, les vivandiers revenaient, rapportant la tambouille aux camarades frigorifiés. Avant leur retour chez nous, tous les six avaient pu manger chaud près de la roulante. Devant une ligne de front stabilisée, chaque fantassin pouvait ainsi, par rotation alternée durant la semaine, bénéficier d’une nourriture chaude qui requinquait le trouffion. N’était-ce pas sensass ? Le sergent, fin gourmet, avait su choisir parmi la bande, des experts habiles dans la manière d’organiser la razzia à la roulante et de ramener, en sus des repas nécessaires, toute la nourriture qu’ils allaient devoir intelligemment chaparder.
Ils ne portaient pas de carabine mais un pistolet 08 et surtout plusieurs sacs à dos sous leur tenue de camouflage. Pendant que les camarades créaient la diversion durant la distribution, le plus roublard d’entre eux était chargé de voler tout ce qui était mangeable et buvable, en se faufilant autour des chaumières où étaient stockées les rations de guerre. Selon la chance, un saucisson, des pains, voire même des boîtes rondes de couleur orange contenant de la margarine faisaient le grand voyage. La grande capuche servait de barrage captif aux cigarettes Ernte 23 (les clopes étaient utilisées pour calmer la faim). Rares étaient les cigares qui nous parvenaient, leur opportune fumée faisait fuir les moustiques ! Le rabioteur professionnel avait toujours avec lui deux gourdes qu’il se débrouillait de remplir avec du Fusel qui n’était autre qu’une boisson brune alcoolisée : elle assommait et nous rendait courageux. Avec deux gorgées, l’on ne sentait plus le froid dans la figure et ça vous tordait agréablement les boyaux !......... Je me souvenais..., je me souvenais.... si fort que maintenant encore j’ai l’impression que mon âme gravée par les douleurs saigne dans sa chair bien trop lente à se cicatriser !

Fin de convalescence
Le docteur d’Arendsee était soucieux des blessés qu’il soignait. Pour faire retrouver à ma main l’entière aptitude de ses facultés, il n’hésita pas à me confier à sa fille Hannelore qui m’initia aux rudiments du piano. « Après guerre, oui, tu pourras raconter, mais maintenant occulte ton odyssée ! » Tant bien que mal, j’essayais de gommer ma tragédie en réapprenant à vivre au milieu de mes semblables.... J’ai volontairement escamoté des moments insoutenables que je n’ai pas voulu voir figurer dans mon témoignage. « Certaines photos ont été reconstituées à partir de tirages directs en 24 x 36 que le Colonel Kalden avait fait parvenir, en courrier particulier, à mes parents. Signé Jean Ernst. » Ndr : Jean Ernst désertera par la suite, se cachera et sera même recruté par les Américains lors de la Libération.

