Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197
Uncategorised
Le soldat embrigadé dans la Wehrmacht
« L’exploit, ils l’accomplirent avec leur corps, et sur un étroit sentier d’infortune, environnés du souffle de la gloire, ils ont quitté ce monde.. » Citation attribuée à Périclès.
L’intérêt des descriptions qui vont suivre va permettre au lecteur de mieux comprendre les conditions de vie du fantassin confronté au système militaire allemand en vigueur dans un bataillon, et son vocabulaire précis.
Ordre, hiérarchie, discipline régentent la vie de tout soldat ès-Wehrmacht.
La description détaillée et élaborée qui reprendrait à plus grande échelle les fonctionnements du régiment, de la division, de l’Armée et du haut commandement allemand n’a pas été abordée ; le bataillon est un élément-charnière où le Malgré-Nous se retrouve facilement.
La majorité des 132 500 Malgré-Nous a séjourné sur le front de l’Est. L’existence chaotique vécue au jour le jour avec les équipements divers échelonnés en profondeur face à l’ennemi, l’implication dans les unités, la vie militaire et l’enfer du décor concourent à rappeler aux Alsaciens-Mosellans leurs tribulations périlleuses et le baiser de la mort quotidienne. Le dispositif des forces, l’armement, l’entraînement bien rôdé des équipes évoluant en 1ère ligne, la guérilla entretenue et le climat hostile éclairent d’une vision nouvelle le lecteur néophyte plongé dans les choses de la vie sur le front de l’Est.
 a) L’uniforme
a) L’uniforme
L’uniforme feldgrau comportait un pantalon en toile qu’on fourrait dans les bottes cloutées. La veste grau grün qui disposait de poches latérales était serrée par un ceinturon solide. Le livret militaire était obligatoire et se casait dans les poches avant du treillis. L’une des moitiés de la plaque d’identité en aluminium (où figurait le matricule) était récupérée lors du décès, l’autre partie étant retenue au cou de la victime ( ou à son bras) par un cordon.
On retrouvait dans les poches du pantalon : lettres, photos, crayon, nécessaire de couture, allumettes, papier, cierge, canif, ouvre-boîtes, tabac, nécessaire de premiers secours, médailles pieuses, etc...
Le calot (Schiffchen) comportait une cocarde noire-blanche-rouge aux couleurs du Reich. Les habits d’hiver, qui n’avaient pas été pensés pour affronter le froid sibérien, subirent quelques modifications. La toile des treillis, la veste en laine légère furent tardivement remplacées par des étoffes plus chaudes, ajourées et prédécoupées (pour recouvrir l’uniforme classique) et réversibles (blanc ou camouflé). Pour les sentinelles, des manteaux en fourrure ou en peau de mouton furent distribués ainsi que des bottes de feutre et des pantalons ouatés. De nombreux Landser (fantassins) souffrirent du froid qui provoqua des engelures aux doigts de pied nécessitant des amputations. On inventa des "bottes" en paille.
Les Russes disposaient de bottes à pointure plus élevée. L’intervalle disponible, rembourré de paille, de papier journal ou de chiffon chauffait davantage le pied libéré, car il était ainsi en continuel mouvement.
b) L’équipement
Le ceinturon noir était fermé par la boucle sur laquelle était inscrit Gott mit uns (Dieu avec nous). Il était muni d’un passant permettant le port de la baïonnette. Des deux côtés de la boucle se portaient les sacoches de munitions (2 x 30 cartouches). Sur la fesse droite à l’arrière s’étageaient la gourde et la musette dans laquelle on trouvait la nourriture froide pour la journée, une boîte ronde en bakélite pouvant recevoir beurre ou saindoux, des munitions de réserve, la graisse pour armes, le nécessaire pour nettoyer les fusils, ainsi que la ration de guerre à laquelle il ne fallait pas toucher sans autorisation. Le troupier affamé y découvrait 500 g de biscuits durs en petits morceaux (Keks) et une boîte de conserve de viande pesant 200 g. Sur la gourde d’une contenance de 75 cl et protégée par du feutre se coinçait le gobelet. Sur le flanc gauche du treillis, vers l’arrière, pendouillaient la baïonnette, le masque à gaz et la pelle-bêche. Ce dernier outil était utilisé soit comme arme, soit comme hache pour ébrancher, soit comme bêche pour travaux de terrassement, abris, tranchées ou fosse pour installer le feu.
Poids exercé sur le ceinturon lors d’une marche ou au combat : ceinturon 250 g, 2 cartouchières chargées de 60 coups pesant 2060 g, musette vide 240 g, pain 500 g, conserve 200 g, boîte de graisse 150 g, gourde remplie 1070 g, bêche 1110 g, baïonnette 650 g, masque à gaz 1930 g, soit un total de plus de 8 kilos.
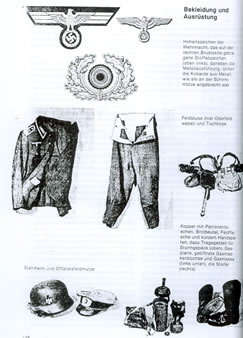 Le casque qu’on enlevait durant les marches était alors accroché aux cartouchières ; d’une épaisseur de 1,1 à 1,2 mm d’acier, il pesait 1,340 kg.
Le casque qu’on enlevait durant les marches était alors accroché aux cartouchières ; d’une épaisseur de 1,1 à 1,2 mm d’acier, il pesait 1,340 kg.
A cela il fallait ajouter un havresac fixé sur le dos par un dispositif fait de lanières et de bretelles croisées passant par la ceinture. Dans le havresac étaient fourrés : les treillis blancs, les lacets, le linge de réserve, mouchoir, couverture, linge de corps... Les ustensiles de cuisine (gamelle contenance 1 litre + 3 pièces de couvert) étaient utilisés pour recevoir la popote. Coincé dans l’attirail se nichait un sac en toile avec le nécessaire de toilette et de rasage. Très commode, une toile de tente de 1,270 kg surmontait le tout. De forme triangulaire (202/202/240 cm) trouée par 15 boutonnières et munie de 15 boutons doubles sur la base, camouflée de taches brunes, vertes et de rayures verdâtres, elle était imperméable. Plusieurs toiles de camouflage boutonnées ensemble formaient une tente-abri. Un trou dans le tissu laissait passer la tête et le "poncho" devenait un manteau de pluie qui faisait même office de civière en première ligne.
La roulante était hautement appréciée par les fantassins. Connus sous le sobriquet de Küchenbullen (dogues des cuisines) les cuistots avaient intérêt à requinquer le moral de la troupe en métamorphosant les vivres en solides repas. Wie die Verpflegung, so auch die Bewegung. A bonnes prestations alimentaires, bonne énergie rendue.
Les repas étaient présentés en plat unique le plus souvent. Quelquefois des morceaux de viande rôtie avec sauce, pommes de terre et salade étaient servis. Des fruits, du chocolat, des bonbons (Drops) agrémentaient parfois la distribution. A proximité du front, les combats déstabilisaient l’agencement régulier des repas (matin, midi, soir). La mobilité de la roulante et le sens de l’improvisation s’imposaient. C’est seulement à l’arrière du front que le soldat pouvait mettre ses pieds sous la table, ou lors du repos de sa compagnie. Les responsables chargés du ravitaillement de leurs collègues de la ligne de front profitaient de l’obscurité pour aller s’approvisionner à la roulante, judicieusement protégée, dont l’emplacement était connu des seuls initiés. Trois ou quatre soldats désignés quittaient leur poste et venaient récupérer le manger à réchauffer (ou servi froid) pour le lendemain.
Les vivres suivantes étaient à ramener par les Essenholer :
6 gamelles remplies de tambouille, plus 6 gourdes pleines de thé ou de café ainsi que le manger froid (en sus du pain, du fromage, des citrons, du tabac...) porté dans un sac.
Dangers encourus : le cliquetis des gamelles qui s’entrechoquaient, les éclats intermittents des lampes de poche, les bruits de pas dans le calme de la nuit alertaient l’ennemi qui envoyait une salve d’obus ou le tireur d’élite friand de cibles faciles. Les privations et la faim étaient terribles à surmonter lors des retraites ou pendant les durs combats. Officiers et soldats, ce qui est unique par rapport aux autres armées, dégustaient la même popote.
Nourriture froide par jour et par soldat :
750 g de pain, 45 g de beurre, saindoux, 120 g de saucisse en boîte ou fraîche, poisson ou fromage (tube), 200 g de marmelade (ou miel artificiel), 7 cigarettes ou 2 cigares ou 1 rouleau de Drops.
Nourriture chaude (en période calme)
750 g de pommes de terre, pâtes alimentaires avec 125 g de viande, 45g de graisse végétale ou animale, légumes, 15 g d’ingrédients, 8 g de café en grains ou 10 g de café ersatz.
Féculents continuels :
Patates séchées, pâtes, riz, semoule, orge perlée, maïs.
Viande : volaille, poisson, boeuf, porc, oeufs. Le Kommissbrot (pain de munition) et le pain gris (Graubrot) de 1,5 kg étaient cuits à haute température pour tuer les germes et les microbes de l’eau qu’elle fût polluée ou non.
Cantine (Marketenderei) : Vente de tabac, de spiritueux (3 ou 4 hommes pour une bouteille de cognac, de vin ou de champagne). Et bien sûr, les articles de toilette, le nécessaire pour écrire, le papier à lettres s’y achetaient.
c) Lieu de repos :
Après un séjour prolongé au front, la troupe relevée regagnait les bases arrières, à l’abri et hors d’atteinte des tirs d’artillerie adverse. A cause des avions, le parc de voitures devait être camouflé. Les sentinelles assuraient la garde de cette aire de repos car le maraudage des civils ou les attaques des partisans étaient toujours à craindre.
Le matériel déployé (boulangerie, boucherie de campagne, ateliers divers) devait pouvoir être rapidement rangé dans des cantines-coffres appropriés lors d’attaques-surprises ou durant les retraites.
d) Loisirs : Derrière le front, le repos mérité transposait pour deux à trois jours le fantassin dans un "royaume" plus paisible. Son esprit traumatisé par l’atmosphère démentielle vécue au quotidien se libérait progressivement du stress subi. Appréciant la réalité environnante, le soldat pouvait vaquer à ses occupations :lavage des effets, épouillage, "relâche" sur tout le programme, récupération psychique et physique, lecture, envoi de lettres, réparations, couture. Cette trêve permettait également de se ressourcer : jeux de cartes, théâtre aux Armées, radio (Wehrmachtbericht), baignades, sauna.
e) La poste aux armées :
Elle permettait le contact entre la mère-patrie et le front, entre le fantassin et sa famille. La lettre, la carte postale, les journaux, les paquetons de 100 g ou le paquet maxi de 1 kg mettaient 14 jours environ pour parvenir aux destinataires mutuels. On reprocha après guerre à la Feldpost l’espionnite et la censure. Tout était loin d’être vérifié ; en période "douteuse", les employés, sur recommandation du Feldpostmeister, procédaient à des contrôles inopinés sur des échantillons d’envois pris au hasard et labouraient d’un trait noir les propos outranciers ou défaitistes. Un blocage postal (Postsperre) intervenait parfois lors du transport de troupes, lors des regroupements ou durant les transferts d’unités au front, lors d’offensives ou pendant les retraites.
Le soldat avait un code postal (Feldpostnummer). En raison de l’espionnage, il ne pouvait être question de préciser le moral de la troupe, sa localisation. Dans les colis ne devait transiter aucun objet dangereux (balle de souvenir) ou périssable.
f) Le service de soins :
 En temps de paix, on qualifiait l’infirmier (Sani) de tourneur de pilules, de potard, d’apôtre riciné ou de charlatan (Pillendreher, Rizinusapostel, Hokus pokus macher). C’était l’hommage peu glorieux rendu aux infirmiers juste bons, disait-on, à distribuer l’unique poudre controversée de perlimpinpin. Les horreurs vécues sur le front de l’Est changèrent rapidement les reproches infondés en compliments continus. « Sani, Sani » devinrent le cri de souffrance et l’appel désespéré des blessés. Habillés de bleu foncé, porteurs du brassard frappé d’une croix rouge au bras gauche, les soldats-infirmiers ramassaient les blessés, les réunissaient pour former des nids sur le terrain, prodiguaient les premiers soins puis assuraient le transport par civière vers le Truppenverbandplatz du bataillon (poste de 1er secours).
En temps de paix, on qualifiait l’infirmier (Sani) de tourneur de pilules, de potard, d’apôtre riciné ou de charlatan (Pillendreher, Rizinusapostel, Hokus pokus macher). C’était l’hommage peu glorieux rendu aux infirmiers juste bons, disait-on, à distribuer l’unique poudre controversée de perlimpinpin. Les horreurs vécues sur le front de l’Est changèrent rapidement les reproches infondés en compliments continus. « Sani, Sani » devinrent le cri de souffrance et l’appel désespéré des blessés. Habillés de bleu foncé, porteurs du brassard frappé d’une croix rouge au bras gauche, les soldats-infirmiers ramassaient les blessés, les réunissaient pour former des nids sur le terrain, prodiguaient les premiers soins puis assuraient le transport par civière vers le Truppenverbandplatz du bataillon (poste de 1er secours).
Le médecin (Arzt) y avait aménagé en temps utile les locaux d’intervention médicale. Lors de coups durs, il procédait de manière urgente pour bander les mutilés, arrêter les hémorragies, piquer contre le tétanos, atténuer les douleurs, rafraîchir, réconforter, préparer le blessé vers le transport (un bulletin accroché au cou du blessé en précisait l’état).
Le Truppenarzt n’opérait pas, mais il portait sur lui une sacoche bourrée de médicaments. Les aiguilles étaient maintenues stérilisées dans de l’alcool. Les emblèmes de la Croix-Rouge devaient ostensiblement figurer sur les maisons, les tentes, les véhicules faisant office d’infirmeries. Le médecin, en période tranquille, veillait à la santé quotidienne de la troupe.
Les équipes de secours n° 1 ramenaient dans les Sankas (Sanitätskraftwagen, ambulances) les blessés graves vers le Hauptverbandplatz (HVP, poste de secours principal) en les récupérant auprès des postes de secours intermédiaires (Verwundeten und Krankensammelpunkte) ou près des arrêts d’attelages (Wagenhalteplatz).
En raison des difficultés sur le terrain, des charrettes légères (Panjewagen) tirées par de petits chevaux-poneys, remplies de paille et tendues de toile et même des traîneaux assuraient le transfert des charcutés vers l’arrière. Les équipes n° 2 avaient le devoir, sous la direction d’un chirurgien, d’établir un HV-poste d’appui sous des tentes ou des bunkers dès le début de la mêlée.
Chaque équipe possédait des malles d’osier ou de bois spécifiques contenant ses instruments chirurgicaux, son éclairage, son appareil de rayons X, ses produits de pharmacie...
Une équipe se composait d’un chirurgien, d’un ou deux médecins, d’un instrumenteur, d’un anesthésiste, d’un stérilisateur et des aides. Sur ces lieux de secours, on s’occupait des blessés grièvement atteints. Les blessés au ventre, à la tête, aux poumons, aux membres déchiquetés pouvaient être opérés sur place avec beaucoup de réussite puis, suivant la gravité, préparés pour un nouveau transport vers l’hôpital de campagne (Feldlazarett) qui se trouvait à 25 ou 30 km derrière le front, à proximité d’un hôpital civil, d’écoles ou de maisons réquisitionnées.
200 à 300 patients y étaient soignés (salle d’opération, salle de soins et de traitement) et dormaient dans des lits ou des paillasses (Strohsack). Une salle de quarantaine (pour fièvre pourprée, typhus, dysenterie) était aménagée pour enrayer la prolifération microbienne. Une prophylaxie draconienne était imposée et concernait la pureté de l’eau, les épouillages et les désinfections. Un éloge appuyé doit être fait à l’égard des brancardiers secourant sous la mitraille les blessés tout comme les médecins et leur sens de l’abnégation.
g) Le curé de la division (Der Divisionspfarrer) :
Dénigrés par la propagande N.S.P. (National-Sozialistiche Propaganda), ignorés des bulletins de guerre, les prêtres méritent d’avoir voix au chapitre. A chaque division étaient nommés un curé (Pastor) et un pasteur (Pfarrer). Ils étaient les seuls à ne pas être armés. Le curé portait un havresac, le pasteur un coffret.
Pour dire la messe, le curé mettait son aube et son étole au-dessus de l’uniforme, sortait du sac les instruments liturgiques ainsi que les livrets de chants. Des enfants de choeur s’empressaient de servir les offices, car l’inquiétude des soldats face aux dangers cherchait un réconfort moral et spirituel auprès de ces hommes d’églises qui subissaient comme eux les aléas de la guerre et qui comprenaient les dures humiliations des situations. Les messes avec absolution générale, tout comme la sainte Cène avant les attaques, étaient suivies pieusement. L’office divin avec confession et communion ou les oraisons avaient lieu tous les jours que ce soit derrière le front, dans des hôpitaux, les lazarets ou les bunkers. Les pasteurs des deux confessions poussaient l’évangélisation jusque dans les tranchées et les abris pour rassurer le fantassin. Blessés et malades étaient secourus moralement, certains dictaient leurs testaments ou leurs dernières volontés. Les hommes de Dieu envoyaient réconfort et consolation aux familles dans le deuil. Les ministres du culte veillaient au bon entretien des cimetières.
Un officier N.S. était là pour contrecarrer l’impact de la religion. Il n’y eut guère de convertis à la foi nazie. La renommée des curés n’était plus à faire, et le cri « Notre abbé se pointe » passait comme une traînée de poudre sur la ligne. Sa tête apparaissait dans l’abri enfumé. Arborant son missel, il ramenait quelques douceurs, cigarettes, tabac ou chocolat. Les soldats de Dieu partagèrent la vie commune de la troupe, à cheval, en voiture, à pied et souffrirent mille privations avec leurs ouailles.
h) Le camarade cheval de guerre :
Actuellement on ne pourrait plus imaginer trouver le cheval enrôlé dans une guerre dite moderne.
Animal estimé durant la 1ère guerre mondiale, il reprit du poil de la bête et servit admirablement les intérêts de la Wehrmacht dans sa lutte sur le front de l’Est.
Alors que les moteurs souffraient du sable et de la poussière en été, que les véhicules s’enlisaient par colonnes entières dans le bourbier en automne et au printemps, que le trafic se paralysait en hiver, les braves chevaux, eux, surmontaient les obstacles.
Un million de quadrupèdes fut affecté au service des divisions au commencement de l’offensive Barbarossa. En un trimestre (hiver 1941-42) 180 000 bêtes furent perdues des suites de malnutrition, des causes du froid et remplacées petit à petit par de nouveaux troupeaux. Le nombre élevé de 1 700 000 chevaux utilisés ne suffira pas à tracter l’invraisemblable parc à charrettes. Le Panjegaul (cheval russe), autochtone, suppléa les vides.
Petite bête tenace, increvable sous la chaleur comme sous la froidure, sobre, elle tirait, vu son gabarit, des mini-charrettes et ne put être attelée aux lourds canons. Les villageois, habitués au monde rural, plaignaient ces chevaux dociles et muets, éreintés et lessivés parce que pliant sous la charge des fardeaux.
Ces roussins emportaient de nombreux blessés dans les postes de secours. Parcourant des centaines de kilomètres par tous les temps, s’affaissant sur le timon, s’embourbant jusqu’à la croupe, crevant dans le limon teigneux, ces bêtes s’abattaient à bout de forces au bord de la route en attendant le coup de grâce tiré dans l’oreille qui mettait fin à leurs souffrances. Apeurées par les explosions, elles arrachaient les traits les reliant aux lourdes batteries d’artillerie. Les canassons s’enfuyaient hennissant au milieu des tirs d’obus et des rafales d’avions.
C’était de braves quadrupèdes, des auxiliaires précieux et des amis fidèles du fantassin.
j) Transport :
Il faut savoir que 20 000 hommes nécessitaient 45 tonnes de ravitaillement divers par jour. Munitions, fourrage, habillement, nourriture, moyens d’attaque et de défense arrivaient constamment de l’arrière. Attelages, camions, side-cars déversaient un invraisemblable bric-à-brac ramené des Grosslagern (dépôts centraux). Les munitions (cartouches, obus pour artillerie), les rations pour chevaux (5 kg de foin, 5 kg d’avoine, 5 kg de paille par jour et par bête), l’habillement, les effets d’hiver, les outils de terrassement, les planches de coffrage et jusqu’au dernier clou transitaient de main en main pour alimenter le Stellungskrieg, la guerre de position ou les chaudrons ambulants (wandernde Kessel).
k) Die Kettenhunde : "les chiens de chaîne".
Tel est le surnom si décrié dont on affubla la Feldgendarmerie (prévôté ou police militaire) !
Leur tâche s’annonçait difficile : devoir avec peu d’effectifs contrôler de vastes terrains, être astreint à de nombreuses obligations, ce qui entraîna nécessairement auprès de la population civile comme chez les militaires, de nombreux excès de zèle et d’infractions. Habillés d’ordinaire en tenue orange, ils la troquèrent contre l’uniforme de l’armée mais avec un signe visible de reconnaissance : un insigne orbiculaire de souveraineté sur lequel figurait l’inscription Feldgendarmerie et qui était porté avec une chaînette autour du cou des intéressés.
Il y avait deux autres signes distinctifs : un emblème "Ordnungspolizei" et cousue au même bras gauche une bande brune portant le titre "Feldpolizei". Le peloton de gendarmerie relevait directement du Général de Division (Divisionskommandeur). Un officier (Lieutenant ou sous-lieutenant) et 36 hommes disposant de 7 voitures, d’un camion LKW (Lastkraftwagen), de 6 motos et de 2 side-cars, armés de pistolets et de pistolets-mitrailleurs, régnaient en petits groupes sur les arrières de la division.
Maintien de l’ordre, sécurité des lieux, police de route étaient trois de leurs principaux devoirs.
Ils effectuaient des patrouilles pour constater la bonne tenue des soldats, menaient des rondes dans les gares pour vérifier les congés des permissionnaires, intervenaient activement pour réprimer des actes délictueux chez les civils, cherchaient des déserteurs et des insoumis, s’impliquaient pour rétablir la discipline et repousser la panique, regroupaient les hommes débandés sur des lignes de résistance, créaient un "dépôt central" pour troupes dispersées. Concernant la sécurité, ils identifiaient les personnes, traquaient les espions, saboteurs et partisans, fouillaient les prisonniers lors des grands rassemblements de captifs dans les zones de combat.
Dans les situations très critiques, ils devaient protéger l’état-major de la division. Régler la circulation demandait une grande implication : respect du code de la route certes, mais également fluidité de circulation à assurer, franchissement de ponts et de passages étroits lors des mouvements de troupes.
Ils étaient tout puissants, leurs droits étaient considérables. Tous les hommes de la Wehrmacht, (également les officiers) devaient justifier de leur identité même devant un gendarme subalterne. Les fins limiers pouvaient fouiller pièces, objets et personnes, vérifier l’intérieur de véhicules et les paquetages. Ils avaient le droit d’arrêter hommes et sous-officiers (les officiers uniquement en flagrant délit) et pouvaient exceptionnellement faire usage de leurs armes. Sans leur implication musclée, la pagaille se serait inévitablement installée sur les axes de circulation comme dans le secteur des combats.
l) Le conseil de guerre (das Kriegsgericht) :
Un assesseur (officier de l’état-major de la division) et un monsieur bons offices du côté du prévenu participaient aux débats. Cet officier expérimenté en droit assurait la défense de l’accusé.
Le conseil de guerre, que ce soit par ignorance de son rôle exact durant les cinq années de conflit ou par esprit de méchanceté après la fin des hostilités, a été vilipendé pour son arbitraire par de nombreux détracteurs.
Pourtant il n’y eut que 12 245 condamnations à mort, dont 6 000 exécutions durant la guerre, ce qui représente pour une armée forte de 3 millions de soldats, un taux de 2 pour mille. Il est vrai que les exécutions capitales durant les derniers mois de guerre (sous forme de lynchage bâclé ou de pendaison arbitraire, réglé par un peloton d’exécution hâtivement constitué, après un simulacre de procès ou sans attendre la décision de la justice) ont terni cette honorable institution.
Les délits graves et les fautes pénales furent souvent commués en sanctions disciplinaires. Ainsi, les actes répréhensibles tels l’éloignement non autorisé, la désobéissance, le refus de monter en ligne, l’insoumission (cas des Alsaciens-Lorrains), l’insubordination, la lâcheté devant l’ennemi, le départ précipité de son unité lors d’une attaque, la transgression du devoir militaire, l’automutilation, le vol de biens appartenant à la Wehrmacht, la félonie ou la trahison, le remplacement ou la dégradation du potentiel militaire, le pillage, le viol, les exactions (vol, meurtre) à l’encontre des civils méritaient des sanctions allant graduellement de la prison jusqu’à la peine de mort. Les fautes légères étaient à purger au front en liberté conditionnelle et les cas les plus graves, dans des régiments disciplinaires.
Le tribunal statuait également sur les affaires mêlant des civils aux activités d’espionnage, à leur aide aux partisans ou à leurs agissements nuisant aux intérêts de la division.
m) Les tanks ennemis
La finition du T.34 laissait fort à désirer. Et pourtant le monstre constitua une surprise énorme pour les Allemands dès les premiers mois du conflit. Par rapport aux Panzers allemands, le tank russe leur était supérieur dans tous les registres, hormis l’absence de la radio. Ses chenilles très larges s’adaptaient à tous les terrains et réduisaient le risque de son enfoncement jusqu’à la caisse. Le blindage était épais ; le moteur très robuste rendait les incendies à bord très rares. Les Russes, à travers une rationalisation simplifiant au maximum la finition de ces engins allaient les produire en masse avec un défaut crucial, l’absence de communications radio.
Les équipages, de peur d’offrir une cible trop parfaite lorsqu’il s’agissait de communiquer à distance par fanions, préféraient fermer les tourelles et foncer en avant, dans l’inconnu, et sans liaison tactique de soutien, avec pour issue fréquente la destruction du char orchestrée par d’habiles Panzerknacker (croqueurs de chars).
n) Les unités de la garde (dem Stalin Seine, ceux de Staline).
Les soldats d’élite russes étaient redoutés par les Allemands. Mieux équipés, ils constituaient le fer-de-lance des offensives russes. L’habillement russe s’était amélioré : le pantalon en coton était ample avec des pièces de renfort cousus sur les genoux. Les bottes étaient étoffées de cuir (à part la toile graissée de la tige).
Le vêtement de pluie pouvait faire office de toile de tente. Coiffés du casque d’acier, portant un havresac rustique et la toile de tente roulée autour du cou, ces soldats fanatiques étaient superbement armés.
Le fusil-mitrailleur Degtiarev de 9 kg doté de boîtes-camenbert de 77 cartouches tirait en automatique.
Les décorations furent nombreuses (Insigne de mitrailleur distingué, Insigne de la Garde pour valeur héroïque prouvée au combat, Ordre de la Gloire 3ème classe, Médaille de la valeur militaire).
o) Les tireurs d’élite
Lors de la guerre des positions, les Russes étaient passés maîtres dans l’art d’entretenir un climat d’insécurité constant. A l’improviste, ils canardaient les positions ennemies ou s’ingéniaient grâce à leurs snipers à s’offrir des sentinelles allemandes bien imprudentes. La patience du tireur russe durant le guet était proverbiale : observant le panorama derrière un bouclier de tranchée grâce à l’oeilleton percé dans le blindage, il excellait dans l’art d’envoyer une balle mortelle dans la tête du pionnier allemand, ne craignant pas le froid, planqué dans des caches insolites (arbres creux, souche d’arbre, meules de foin, carcasse éventrée de cheval...), parfois même il se ceinturait au faîte de l’arbre en raison du froid hivernal. Imperturbable, il attendait sa victime insouciante et qui était à mille lieux de penser au sort macabre qui l’attendait (cf. récits de Joseph Muller et de René Says).
p) Les partisans
Les organisations clandestines se formèrent rapidement, en luttant contre l’agresseur par tous les moyens possibles. Les guérillas, peu nombreuses au début, apportèrent une aide précieuse à l’armée soviétique.
Les unités de partisans agissaient sur les arrières de l’ennemi : saccage du réseau ferré, coordination des missions avec les opérations militaires, massacre des collaborateurs nazis, destruction de ponts, de lignes téléphoniques.
Les nazis s’efforçaient de briser la résistance qui gangrenaient les territoires occupés par d’inqualifiables représailles : villages incendiés, sonderkommandos chargés du nettoyage des Juifs, pendaison des communistes.
La résistance russe contribua de toutes ses forces à la défaite finale du nazisme.
q) Les orgues-de-Staline
Les katiouchkas (ou lance-roquettes) tiraient des projectiles autopropulsés installés sur des rampes montées sur camion. L’allumage se faisait électriquement à partir de tuyères accouplées de 6, 12, 32 éléments.
Dans un carré de 300 mètres de côté, tout était haché menu.
Le régiment d’infanterie était ainsi constitué :
- état-major,
- train du régiment,
- unités spéciales : pionniers, cavaliers, agents de renseignements, musiciens,
- 3 bataillons (formant 12 compagnies numérotées de 1 à 12),
- 13ème compagnie de protection,
- 14ème compagnie de chasseurs de chars,
- 1 colonne légère de fantassins, le tout formant 75 officiers, 493 sous-officiers et 2 474 hommes.
(La 8ème compagnie se lit 8./Inf. Rgt. 1. Le IIIème bataillon du Gren. Rgt 12 se lit III./Gren. Rgt. 12).
Le bataillon d’infanterie (Btl) était une unité tactique de combat.Le bataillon disposait d’un commandeur, de 13 officiers, d’un employé (le comptable) et de 846 sous-officiers et hommes de rang (ajoutez-y 131 chevaux).
Le bataillon comprenait :
A) L’état-major (Bataillonstab mit Unterstab).
B) L’échelon de service de renseignements et d’informations (Nachrichtenstaffel).
C) Une section de fantassins-pionniers (Infanteriepionierzug).
D) 3 compagnies de protection, (3 Schützenkompanien).
E) Le train de combat (Gefechtstross).
F) Les services de ravitaillement 1 et 2 (Verpflegungstross 1 et 2).
G) Le train d’équipage (bagages et équipements) (Gepackstross).
H) La compagnie d’armes lourdes (Maschinengewehr Kompanie).
A) Etat-major en combat et durant les attaques :
L’état-major était étoffé comme suit :
- Le Bataillonskommandeur (der Major),
- L’aide de camp (der Adjutant, à ne pas confondre avec l’adjudant, der Feldwebel),
- L’officier d’ordonnance (der Ordonnanzoffizier),
- Le médecin,
- Le vétérinaire, tous officiers.
1) L’échelon de commandement (le commandant, son officier d’ordonnance, 2 cavaliers en appui, 2 estafettes-cavaliers qui disposaient d’une binoculaire) se trouvait soit sur le terrain, soit dans le poste de commandement (Btl. Gefechtsstand) où il y avait en permanence l’aide de camp, un secrétaire, un dessinateur. Le Major prenait les décisions, impliquait les services de renseignements, recueillait les données, les interprétait pour dispatcher et ventiler les groupes vers les avant-postes, cherchait et maintenait les liaisons sur la ligne de front avec les voisins de gauche et de droite.
2) Der Adjutant, auxiliaire précieux du chef de bataillon, faisait chaque soir son rapport à l’état-major du régiment (comportement de l’ennemi, activité personnelle de la troupe, événements, pertes, utilisation et réserve de munitions, etc...). Il aménageait l’endroit idéal pour l’observation nécessaire au bataillon, s’arrangeait pour transmettre au mieux ses appels par liaisons téléphoniques, listait tous les mouvements sur la carte d’état-major (les positions des troupes, les relevés et les cotes) transcrivait des mots-clés sur son bloc-notes (pour pouvoir mieux les analyser et les rendre lisibles lors des comptes-rendus), s’entretenait à tout moment avec son supérieur sur l’évolution de la situation.
Son secrétaire rédigeait les ordres écrits et les instructions pour les annoter dans le KTB (Kriegstagebuch, journal de marche) tandis que le dessinateur reportait sur le plan des lieux les positions, les zones battues par l’artillerie, la HKL (la Hauptkampflinie = principale ligne de front d’attaque).
3) L’officier d’ordonnance était l’assistant (l’adjoint) de l’Adjutant. Il dirigeait la liaison avec les armes lourdes, était l’officier chargé des liaisons importantes avec les voisins respectifs et enfin responsable du train de combat. Lors du déménagement du PC (poste de commandement), il restait en place en quittant les lieux le dernier, en attendant l’installation nouvelle.
4) Des mini-postes de commandement éparpillés accueillaient les divers gradés, -ensemble ou séparés-, dans des positionnements différents : il s’agissait du chef de la section des mitrailleuses lourdes, des 2 secrétaires, des 2 toubibs, de l’officier de liaison avec l’artillerie, des commandants de sections subordonnées ou ajoutées au bataillon. Tous ces postes éparpillés (pour éviter les coups directs tuant l’organe directeur) se trouvaient à portée de voix. Le chef des armes lourdes veillait à mettre à l’abri l’état-major (lorsque ce dernier venait en visite sur le terrain) et analysait chaque renseignement concernant les pertes humaines, les bêtes, les défections et pannes, les réserves en munitions, les stocks d’armes. Il veillait à insuffler le dynamisme, l’assistance morale aux hommes éprouvés et "combattait" la propagande ennemie.
5) Les médecins s’occupaient dans leur registre de l’état général des hommes. Blessés, malades sérieux étaient ramenés vers les postes de secours, les hôpitaux de campagne. En prévision des attaques ennemies et de leurs conséquences meurtrières, les toubibs devaient procéder rapidement à l’aménagement de lieux de soins. En plus de deux infirmiers, le médecin-chef recourait à huit auxiliaires pour le brancardage. Les deux médecins inspectaient la viande et la nourriture également. Ils disposaient de deux montures sellées.
6) Le vétérinaire veillait sur les chevaux, les soignait, les requinquait.
7) Un adjudant (Feldwebel) était responsable de l’aménagement et du démontage du P.C., du camouflage, de l’observation et de l’alerte aériennes, de l’implication des estafettes et des coursiers (6 cyclistes, 2 motocyclistes et 2 side-cars).
B) Service de renseignements et d’informations
Chef : Adjudant (Feldwebel),
2 équipes de téléphonistes, 4 équipements de radio-téléphone, 1 chariot aménagé avec l’équipement lourd radio.
Missions : assurer la liaison avec les compagnies voisines, les sections internes.
C) La section de pionniers-fantassins :
Cette section était composée de soldats confirmés qui constituaient la réserve du bataillon. Surnommée "la fille à tout faire", elle était là pour aider le bataillon où cela sentait le roussi (ouvreurs de route, briseurs d’obstacles, ouvriers, combattants, techniciens).
¾En version offensive : débarrasser rapidement les axes de passage de tous les obstacles artificiels (arbres, mines, entonnoirs) et surmonter les difficultés naturelles (sentiers boueux, marais) pour aménager des voies de circulation.
¾Durant l’attaque : aménager des passages dans le réseau de barbelés, détecter les mines, baliser les sentiers dans les champs de mines, assurer l’approvisionnement en moyens et en armements, neutraliser les bunkers.
En défense : creuser des tranchées, des abris. Poser du barbelé, verrouiller le secteur par des mines contre les tanks. Tendre du fil-piège, installer des postes de tir, camoufler des sentiers.
¾En retraite : retarder et bloquer l’approche ennemie par minage, par destruction, par sabotage de réseaux et par embuscades.
Outillage : compresseurs, tronçonneuses, chalumeaux, projecteurs et nécessaire complet pour terrasser et creuser.
Matériel d’obstruction : les rouleaux de barbelés (S-Rollen) pouvaient être étirés rapidement sur une largeur de 6-8 mètres et constituaient un obstacle circulaire conséquent. Les K.Rollen au fil lisse avaient la même fonction.
Les rouleaux classiques devaient être déroulés et accrochés aux chevaux de frise et autres piquets pour constituer un réseau défensif. Le fil de fer lisse avait l’avantage de constituer un fil-piège (faire trébucher, prévenir, auto-commander les explosifs).
Les explosifs : le TNT (Trinitrotoluol) facilement stockable, transportable et insensible à l’humidité pouvait être coupé, tassé et préparé pour servir de charge en poudre variable, à son tour conditionnée dans des enveloppes différentes suivant l’effet désiré.
Il fallait arriver à faire détonner l’explosif par frappe, coup, étincelle, flamme ou filament incandescent.
Ainsi l’allumette, la mèche, le détonateur à retardement, la mèche lente qui parcourait 1 cm par seconde même sous l’eau, l’amorce explosive, la mèche détonante pour explosifs reliés développaient une forte chaleur initiale laquelle provoquait alors la détonation.
D) 3 compagnies :
Une compagnie (Kpie) comprenait en ordre de bataille : 2 Officiers, 21 Sous-officiers, 178 Hommes.
Le chef de compagnie (capitaine ou lieutenant) avait sous ses ordres un peloton de compagnie (Kompanietrupp), 3 sections (Schützenzug, voir description plus loin), 3 Panzerbüchsentrupps (pelotons de lutte anti-chars), 1 Gefechtstross (train de combat), 1 groupe de ravitaillement n°1, 1 groupe d’approvisionnement n° 2, tous les deux chargés de l’intendance, enfin 1 Gefechtstross (train d’équipement).
La compagnie pouvait être impliquée de plusieurs façons : - en rangs serrés ou disséminés pour monter à l’attaque, - en ligne de défense sur des zones à protéger, - en troupe de choc pour percer le dispositif ennemi, - en soutien avec d’autres Cies pour fermer des secteurs, tenir des points stratégiques.
L’adjudant-chef de compagnie était surnommé la "mère de la compagnie", le "juteux" (Spiess), le patron à tout faire à l’arrière. Voilà quelques-unes de ses prérogatives :
- discipline, ordre, surveillance et distribution de rôles des trains d’équipage,
- correspondance, comptabilité, rapports (décès, etc...),
- logis, permissions, sauna. Il montait également en ligne.
Il va sans dire que tout ce bel ordonnancement prussien fut souvent battu en brèche par les vicissitudes de la guerre. Les troupes décimées ne représentaient plus sur le papier que la moitié ou le tiers de leur effectif. Il leur fallait retourner au feu avec les rescapés.
Son armement :
16 pistolets-mitrailleurs, 12 fusils-mitrailleurs, 44 pistolets, 130 fusils, 3 Panzerbüchsen (fusils lance-grenades), 3 mortiers légers + 1 cheval de selle, 12 à 18 chevaux de trait, 8 vélos, une moto Solo Krad, 1 side-car (appelé Beiwagen (ou B Krad) et 3 camions.
Peloton de compagnie : 1 adjudant, 4 agents de liaison, 2 estafettes à bicyclette, 1 palefrenier avec vélo, tous avec des fusils, 1 sous-officier infirmier avec vélo, 1 infirmier avec pistolet.
10 pavillons aériens (pièces de tissu rouge-blanc, dimension 1,50 m) signalaient aux avions amis les gains grappillés sur le terrain. Les carrés d’étoffe devaient, après leur survol, être rapidement enlevés pour ne pas signaler à l’aviation ennemie les positions conquises. Placés à des endroits judicieux, à l’abri du regard adverse, ces drapeaux étaient des signes de reconnaissance très utiles.
E) Le train de combat :
- 1 maître-fourrager (nourriture et santé des bêtes)
- 1 maître-armurier + 1 aide (réparation, test de nouvelles armes, transformation d’armes ennemies récupérées, dépôt et stock de munitions).
- 1 maître-forgeron + 1 aide (cloutage des fers aux sabots des chevaux été comme hiver, aide au vétérinaire).
- 1 sous-officier anti-gaz (stock de recharges, entretien des masques). Le grade devint inutile puisque les gaz ne furent jamais utilisés.
- 1 infirmier sous-officier,
- 2 cuisiniers et 2 aides. Les charrettes étaient équipées suivant la nature des besoins.
F) Deux services de ravitaillement
Secrétaires, fourrier, intendant, comptable =Zahlmops qui avait un emploi dangereux car ce "civil" réceptionnait en tous lieux et par tous les temps l’argent de la solde, géraient l’intendance et les biens du bataillon.
Le comptable distribuait la solde, à même dans les tranchées, s’occupait à approvisionner la cantine (Marketenderei) et les subsistances de la compagnie.
Les services disposaient de 2 charrettes, de 2 camions 3 tonnes, et d’un side-car (avec conducteurs attitrés).
G) Le train d’équipage
1 sous-officier
1 camion (chauffeur + ouvrier artisan).
H) La compagnie d’armes lourdes (MGK : Maschinengerwehrkompanie) :
La MGK était à la disposition de chaque chef de bataillon et comportait 3 officiers et 174 hommes de rang et sous-officiers, plus une "caravane" de 58 chevaux. Elle renforçait par le tiers de son effectif chacune des trois compagnies et, parmi les 3 bataillons, on octroyait aux trois sections lourdes les numéros 4, 8 et 12 (les compagnies étant répertoriées de 1 à 3, de 5 à 7 et de 9 à 11 dans chaque régiment d’infanterie). L’unité détenait des mitrailleuses (tir en ligne directe et en gerbes) et des mortiers (tirs courbes et inclinés).
La MGK était constituée :
- d’un chef de compagnie (lieutenant),
- d’un sous-officier chargé de l’observation,
- de 2 sous-officiers (goniométrie, pointage, repérage),
- d’un technicien télémètre,
- de 2 agents de liaison cyclistes,
- d’un cavalier-estafette (de surcroît clairon),
- d’un palefrenier.
Voici la structure de l’équipe de renseignements propre à la MGK :
- 6 soldats chargés de la communication avec un conducteur menant une charrette chargée de 6 postes de radiotéléphone ainsi que tous les réseaux de fil nécessaires à relier les compagnies.
Les trois sections lourdes (constituées chacune de 2 Schützenzug) étaient dirigées par un sous-lieutenant. 12 mitrailleuses dotaient les sections. Un charretier voiturait les impedimenta offensifs.
Les deux sections de protection (Schützenzug) étaient conduites chacune par un sergent, deux chefs servants de pièce et de 4 x 2 manieurs de mitrailleuses.
Une quatrième section de mortiers lourds dépendait elle d’un autre sous-lieutenant : 6 mortiers, le dispositif de réglage à distance et par radio, les 3 équipages nécessaires pour le tir (10 hommes x 3), les charrettes portant le stockage des armes, les munitions et le paquetage des hommes, les remorques pour transbahuter les caisses remplies de 48 torpilles ailées de mortier dont on en soutirait 15 pour une première ventilation aux équipes, voilà le domaine sur lequel régnait ce Leutnant.
Les mitrailleuses lourdes (schweres Maschinen Gewehr) détenaient en tir rasant droit la principale frappe de feu de l’infanterie. Employée en toute occasion, cette "colonne vertébrale" luttait contre tous les dangers encourus par les fantassins dans les tranchées. Les sMG annihilaient toute pénétration de l’adversaire, grâce à la polyvalence de l’arme.
Après un barrage de tirs d’artillerie ou une pluie de coups de canon, la sMG éjectait ses balles sous forme de tir permanent contre les meurtrières des bunkers adverses et les nids hostiles. Elle pouvait également couvrir un large terrain du fait de ses "balles promenades" circulant à l’entour, en gerbes fluctuantes sur des rassemblements ennemis ou sur des sections attaquant ou refluant. Avec une réserve de tir approchant les 20 mn, l’aboyeuse dominait les points stratégiques, les rives des fleuves, les défilés.
Dès le début du combat, les Gewehrführer (les chefs de groupe) s’emparaient chacun de la hausse de pointage et d’une caisse de munitions tandis que les tireurs n°1 agrippaient leur mitrailleuse, les tireurs n°2 leur affût. Les pourvoyeurs n° 3 et n° 4 portaient chacun 2 caisses de munitions (ce qui représentait d’emblée 1 500 coups). Les mortiers lourds (Granatwerfer) lâchaient des tirs plongeants, indirects ou courbes. Moins pratiques sur des cibles mouvantes et en rase campagne, ils devenaient indispensables pour entretenir l’insécurité sur les avancées du front ennemi ou sur ses arrières, cadrer et anéantir les fantassins ennemis dans leur trou. Protégés et camouflés, ils devaient rapidement contrecarrer l’installation de l’ennemi, mais constamment être déplacés pour ne pas se faire repérer en offrant une trop facile cible à des ennemis perspicaces.
Les mortiers lourds s’empilaient en 3 parties (tube 18,5 kg, plaque 18,3 kg et bipied 18,9 kg) portées chacune par un homme. Deux aides portaient 2 caisses contenant 3 x 4 torpilles (22 kg). A cause du poids excessif de l’arme, il allait de soi que l’équipe pouvait être attardée loin à l’arrière, et plus d’une fois les servants des sMG suppléèrent le retard, l’absence ou la fatigue des mortiersards exténués. Bouclier de soutien, le mortier rendit d’inimaginables services et devint une arme irremplaçable jusqu’à la fin de la guerre.
Schützengruppe (le groupe de protection) :
1 chef de groupe (Gewehrführer) et 9 tireurs.
Le tireur n° 1 était un tireur confirmé, le meilleur. Il portait le sMG 42 de manière libre avec une cartouchière de 50 coups, ainsi qu’un pistolet. En sus, il trimbalait le matériel pour réparation, avec la culasse de réserve, le nécessaire de nettoyage de l’arme et une paire de lunettes de soleil.
Le tireur n° 2 portait au combat 4 cartouchières à 50 coups (2,450 kg x 4) et une caisse de 300 cartouches (11,530 kg), plus son pistolet et un canon de rechange. Le Schütze Zwo était l’aide attitré du tireur n°1 et le remplaçait en cas de mort. Le tireur n° 3 était le pourvoyeur. Il portait deux caisses de 300 coups chacune.
Les autres membres du groupe étaient des tireurs armés de fusils. Ils portaient des étuis de 45 cartouches. Deux ou trois grenades à main étaient accrochées à la ceinture ; des "grenades-oeufs" étaient planquées dans les diverses poches.
Puissance de tir : 1 mitrailleuse, 2 pistolets, 7 fusils + grenades.
Lors des combats, le groupe était échelonné tous les dix mètres. S’il était expérimenté, il se protégeait mutuellement en faisant le coup-de-feu, en lançant des grenades. Son cri de guerre "Hurrah" était bien des fois démoralisant pour l’adversaire.
Quatre groupes de protection n° 1, 2, 3, 4,les Schützengruppen, étoffaient un régiment.
Le Schützenzug (section de protection) qui comprenait 50 hommes était commandé par un lieutenant ou un adjudant-chef. Le chef de section disposait d’une mitraillette, d’une paire de jumelles, d’un étui de cartes, d’une boussole et d’une lampe de poche.
La section spéciale (Zugtrupp) se répartissait comme suit :
Un sous-officier, 3 estafettes (dont 1 tireur d’élite), 1 infirmier (armé d’un pistolet) reconnaissable à sa croix-rouge et portant l’indispensable trousse de secours et la Labeflasche (bouteille de réconfort) un peu plus grande que la gourde. Sur le front de l’Est, l’infirmier au brassard voyant fut souvent pris pour cible et tué.
Comme outillage le Zugtrupp détenait des pinces pour barbelés, un pistolet à fusées, un lot de drapeaux-fanions pour signaux optiques. Le pistolet à lucioles éclairantes (Leuchtpistole) servait grâce à sa palette de couleurs (blanche et autres) d’éclairage sur le terrain, de reconnaissance mutuelle, de liaison, de tirs d’entente, de signal de feu. Ce pistolet pouvait même en tir direct détruire des nids de mitrailleuses ou des bunkers.
Composition du groupe anti-chars (Granatwerfergrupp) :
1 lance-grenades léger calibre n°5, 4 mitraillettes, 5 pistolets mitrailleurs (MPi), 11 pistolets, 34 fusils, 1 lance-grenades, 60 grenades à main, 50 "oeufs" constituaient l’armement total d’une section de chasseurs sans oublier les cartouches au nombre de 1048 coups par Maschinenpistole (MPi), de 4 600 par mitrailleuse, de 2 040 pour les fusils. Le chef de section portait un fusil, des jumelles et une caisse de 10 grenades. Le tireur n° 1 transportait le bouclier, le tireur n° 2 tenait le tube ; les deux hommes étant armés chacun d’un pistolet.
Voici les commandements :
« Tireur 1, êtes-vous prêt au tir (Feuerbereit) ? 250 (mètres). Un tir » ordonnait le chef de section.
- Paré pour le tir ! Feuer frei, tir lâché » répondait le tireur.
Au vu du résultat mitigé ou peu probant réalisé sur la cible, le chef de section précisait à nouveau : « 80 (mètres) vers la droite, 60 (mètres) plus court. Nouveau tir. Etes-vous paré ?
- tiré...abgefeuert ! » concluait le tireur.
A chaque section appartenait un chariot (Gefechtsfahrzeug) qui transportait le mortier, les grenades, les outils de tranchées, les trousses de nettoyage, les rouleaux de barbelés, le camouflage et toutes les munitions non portées par les hommes. Devant les prémices du combat, l’ordre tombait : « Geräte frei, libérez le matériel de combat. »
Les fantassins se pressaient pour aller récupérer leurs biens.
Lors de l’attaque, la section s’ouvrait en coin inversé (3 pelotons devant, le dernier derrière = Breitkeil).
Sur ses gardes, la section pouvait également se déplacer en coin pointu (1 peloton à l’avant = Spitzkeil) pour éviter toute surprise d’encerclement. Les sergents se trouvaient au milieu des rangs pour donner des consignes, appeler, ordonner, siffler... Au vu de ses pertes humaines, plus d’une section devint par nécessité troupe de choc.
Panzerbüchsentrupp (peloton de lutte anti-chars) :
Chef de section avec vélo, 3 engins avec 2 serveurs munis chacun d’un pistolet.
Tireur 1 : fusil anti-char,
Pourvoyeur 2 : 2 étuis de 10 fusées,
Train de combat : 1 adjudant-chef avec pistolet et vélo, 1 sergent responsable du train avec fusil et vélo,
1 sous-officier armé d’un pistolet, responsable du matériel, 3 conducteurs sur siège de cocher (vom Bock) avec charrette à attelage double (4 chevaux), 1 charrette à 2 chevaux pour cuisine roulante (avec bac de 150 l d’eau) conduite par 2 conducteurs (l’un en selle et l’autre assis sur siège), 2 cuisiniers et 2 aides tous armés de fusils.
Peloton, équipe de ravitaillement n° 1 :
1 sergent-fourrier, 1 soldat (assis) menant une charrette tirée par deux chevaux.
Peloton, équipe de ravitaillement n° 2 :
1 sous-officier responsable des subsistances, 1 motocycliste,
1 chauffeur et son aide pour rouler le camion de 3 Tonnes, tous les cinq, étant armés.
Train d’équipement (Tross) :
1 sous-officier comptable, 1 aide-comptable, 1 cordonnier, 1 tailleur, 1 motocycliste, 2 camionneurs et leurs aides. Le 1er camion était équipé d’un bureau, de la réserve d’habits et de l’outillage à main. Le 2ème camion contenait les bagages, les havresacs. Le train était logé 3 à 5 km à l’arrière du front.
Le fourrier et le sous-officier des subsistances s’occupaient de l’acheminement régulier du ravitaillement, de la nourriture et des biens d’équipement. Le tailleur, le cordonnier et le sellier ne chômaient pas vu la charge de travail. Tous étaient surnommés des Trossknechte (valets d’armée = soldats du train).
Un mot sur les cochers dont les tournées avec les chevaux tournaient au cauchemar : abris à construire, attaques en piqué des avions, recherche de fourrage dans la contrée, fers à poser, traits et selles à réparer lors des haltes. Les tirs ennemis et les attaques d’avions surprenaient l’équipage sur la Rollbahn, dans des chemins glaiseux, enneigés. L’acheminement sous haute tension des chevaux pressentant le danger et taillant la route à travers champs à la moindre odeur de poudre tenait de l’épique.
Armes :
a) pistolet à balles lumineuses : hauteur : 80 mètres avec durée d’embrasement de 6 à 15 secondes dans la nuit.
Lucioles à parachutes : durée 1 mn. Le jour, la vision des couleurs portait à 2,5 km.
Couleurs des balles lumineuses et leur signification :
Luciole blanche : Eclairage nocturne pour visualiser le terrain.
Balle traçante blanche : Toujours maître de notre position. Tenons notre secteur.
Balle traçante rouge (1 ou 2 étoiles) : Attaque ennemie, ou tir vers l’ennemi, ou tir de barrage demandé.
Balle traçante verte (1 ou 2 étoiles) : Allonger le feu de notre artillerie.
Balle traçante violette : Danger de tanks.
Balle émettrice de fumée : Ici attaque de tanks.
Balle siffleuse : Alarme de gaz.
Gerbes d’étincelles blanches, rouges, vertes : signes convenus avec l’artillerie lors d’attaque ou de repli avec les troupes d’assaut.
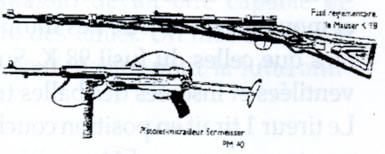 b) Fusil 98 K :
b) Fusil 98 K :
Arme de fantassin, le 98K était l’arme principale, mais aussi une arme d’entraînement semi-automatique tirant 5 cartouches. Très bon fusil dans le tir sur cible, en tir rapide, d’extrême précision (ne déviant pas). Baïonnette montable.
On le surnommait «Femme-du-soldat (Braut des Soldaten) ou flingot (Knarre). » Il était utilisé également comme fusil de précision dont les modèles Z f 41 (grossissement 2 x 1/2) et Z f 42 (grossissement 5 x) par les tireurs d’élite. Arme sûre (visée à 2 000 mètres).
c) Maschine Pistole 40
Le pistolet-mitrailleur était apparemment une arme de qualité, mais il était sujet à des défaillances liées à l’humidité, à la saleté ou au froid qui provoquaient des enrayements.
Le cran de sûreté laissait à désirer : le fait de poser un peu lourdement le M Pi 40 par terre pouvait libérer un coup de feu (d’où, par mesure de précaution, une lanière insérée pour coincer davantage le cran). Le ressort du magasin se bloquait lorsque les balles trop serrées du chargeur s’y concentraient (il fallait en réduire le nombre).
d) La grenade à manche, dont l’origine remonte déjà à la 1ère guerre mondiale, détenait un manche creux en bois (avec ficelle à tirer) surmontée d’une amorce, d’un détonateur et d’un pot en acier léger rempli de poudre.
Il fallait d’abord dévisser le couvercle de sûreté au bout du manche et insérer un détonateur pour l’armer (scharfmachen) puis tirer la cordelette.
On améliora le modèle initial en ajoutant au pot métallique un mantelet d’acier quadrillé pour accroître l’effet déflagrant qui provoquait l’éparpillement meurtrier de centaines d’éclats acérés. La grenade servait également comme arme efficace lors de l’investissement des bunkers ou la destruction de réseaux de barbelés. On "collait" plusieurs grenades ensemble (geballte Ladung) pour accroître leur effet dévastateur.
e) Fusil-mitrailleur (lMG ou leichtes Maschinengewehr 34)
Le lMG pouvait tirer au coup par coup ou par rafales. Monté sur deux pieds escamotables et rabattables, il fallait pour maintenir la précision sur cible, décocher des mini-rafales de 3 à 6 coups. Stabilisée par le bipied, cette arme était idéale pour les cibles à grande et moyenne distances. Les munitions étaient les mêmes que celles du fusil 98 K. Sur les bandes étaient ventilées et insérées des balles traçantes. Le tireur 1 tirait le plus souvent en position couchée ; il pouvait également appuyer son FM sur l’épaule du tireur 2, lequel maintenait fermement le bipied sur le devant de sa poitrine. Dans ce cas, l’arme était utilisée contre les avions volant en rase-mottes.
Lors du changement du tube dilaté par la chaleur provoquée par les rafales continues, des gants ou une pince s’avéraient nécessaires (manoeuvre de remplacement rendue difficile la nuit). La fragilité et l’inconstance de l’arme étaient dues à la poussière, au sable et à la neige. Sa fabrication avait un coût élevé. Poids : 12,1 kg.
f) Mitrailleuse lourde (sMG 34, schweres Maschinengewehr 34)
La MG 34 pouvait être utilisée en version légère (lMG) ou lourde (sMG). Il suffisait alors de la positionner sur un affût-trépied. Grâce au recul maîtrisé de l’arme, le tireur pouvait allonger son tir et tirer de façon continue.
Le tireur 2 portait l’affût tripode de 18,1 kg, la hausse de pointage de 3 kg et l’étui contenant le tube du canon de rechange. Le tireur n° 1 avait deux manières de tirer :
- à vue directe, il fauchait tout entre "germe et épi" (Kimme und Korn, viser pleine mire). La lunette de visée en accentuait la précision.
- en système de pointage indirect, le mitrailleur abrité dans la tranchée tirait sans visibilité, grâce au cercle de pointage (Richtkreis) et grâce à la hausse. Les gerbes de balles, par le biais de ces dispositifs, avaient une tendance naturelle à "s’envoler". Sur une distance de 1 200 m, cette ascension donnait une hauteur de 8,5 m et de 42 m sur 2 km. L’ennemi qui s’avançait au loin était maintenu à distance et les propres camarades établis en 1ère ligne évitaient d’être tirés comme des lapins, les balles passant au-dessus de leurs têtes.
L’arme détenait également ein Tiefenfeuerautomat (poignée basse automatique) qui éjectait tel le mouvement ondulatoire des vagues, les gerbes de balles éparpillées dans tous les sens. Ce dispositif sécurisant protégeait le tireur tapi dans sa tranchée lorsque pleuvaient les balles au-dessus de lui.
Les bandes souples de 300 cartouches étaient casées dans des caisses (portées par le pourvoyeur n° 3) mais on pouvait également utiliser les chargeurs rigides à 50 coups.
g) Mines :
Les Teller-Minen 35 (mines plates avec leurs 5 kg d’explosif) étaient utilisées comme armes anti-blindés. Les S-Minen (Schützen-Minen 41) ou mines de défense contenant 200 g d’explosif étaient engagées principalement contre l’infanterie. Le fait de marcher sur le détonateur enterré propulsait la mine à 1,50 m de haut ; elle explosait alors en libérant 350 billes à l’entour dans un cercle de 50 mètres. Rangées à des intervalles réguliers ou enfouies au libre choix dans une profondeur de terre de 10 à 20 cm, les mines constituaient des barrières redoutables jumelées au rempart défensif (artillerie et armes à feu).
Un plan de minage indiquait l’emplacement et le passage réservé aux patrouilles et aux troupes d’assaut. Les pionniers étaient obligés de déminer à la main le champ adverse. Baïonnette, fil de fer épais, baguettes biseautées étaient employés pour la recherche. Il existait des détecteurs électromagnétiques qui dégageaient un son strident à 30 cm de la localisation mais ces appareils ne réagissaient pas devant des mines cachées dans des caisses en bois (Holzkastenminen). On visualisait les couloirs libérés avec des bandes de papier blanc.
h) Panzerbüchse 39 (fusil anti-chars)
Arme individuelle longue de 127 cm, pesant 12,7 kg. Munie d’un bipied, elle pouvait être portée sur l’épaule ou tenue à la main par une poignée. Le tireur devait bien la caler au creux de l’épaule, l’engin avait une force de recul supérieure aux fusils. Elle était chargée avec une balle unique et avait une capacité de percer un blindage de 25 mm d’épaisseur à 300 mètres de distance.
Arme considérée comme trop faible dans la lutte anti-char.
Le canon 7,5 cm (schwere PAK 40 (Panzerabwehrkanone) avec 5 servants.
Le canon antichar 75 était un modèle agrandi du canon de 50 (5 cm) avec désormais un affût long ou court au diamètre interne "regrossi" tirant uniquement des obus contre blindés.
Une chenillette RSO (RaupenSchlepper Ost) tirait la pièce.
L’obus anti-char avec noyau d’acier (Stahlkern) était capable de perforer :
- sur une distance de 100 mètres, un blindage d’une épaisseur de 120 mm,
- sur une distance de 500 mètres, un blindage d’une épaisseur de 104 mm.
La Panzergranate avec noyau dur (Hartkern) avait encore une bien meilleure perforation :
- sur 100 mètres elle perçait 135 mm de blindage ; sur 500 mètres, 115 mm. Seul inconvénient, le poids du canon 75 le rendait peu maniable. L’emploi d’hommes et de tracteurs pour tirer ou déplacer l’engin s’avérait illusoire lors de combats. D’innombrables canons restèrent embourbés aux mains des Russes. Si les canonniers étaient efficaces sur les bunkers et face aux positions à conquérir, ils devaient également user de beaucoup de courage devant les monstres d’acier lorsque retentissait le cri : «Feindpanzer greifen an !Chars ennemis devant nous ! » que lançait l’infanterie alertant l’arrière par fusée violette ou par émetteur-radio. Consciencieusement, les artilleurs dirigeaient au plus près leurs obus destructeurs et plus d’un malheureux canonnier fut tué derrière son bouclier, sinon écrasé par la charge des T 34 qui submergeaient servants et pièce.
Lutte anti-chars
Les munitions et armements anti-chars utilisés dès l’entrée en guerre contre la Russie s’avérèrent vite dépassés et incapables de neutraliser les carapaces d’acier des forces blindées russes. Dans un premier temps, l’avance fulgurante des troupes allemandes avait occulté cette défection d’armes perforantes. Comme le Russe continuait de moderniser son parc blindé, ses offensives de masse obligèrent les ingénieurs allemands à imaginer de nouveaux moyens de réplique sur un front de guerre à rallonges.
La Panzerabwehr (la défense anti-char) classique avec ses canons de 88, son artillerie, ses propres tanks et les Stukas ne suffirent plus à lutter d’égal à égal avec les unités blindées soviétiques. L’infanterie et ses unités spécialisées (Panzerjäger) furent impliquées et formées à cet effet. Obligés d’abord de trouver une parade à des incursions localisées de T.34, des soldats intrépides avec les moyens du bord réussissaient tant bien que mal à arrêter l’irruption des mastodontes.
Homme contre blindé : la lutte fragile de la carcasse humaine contre la bête d’acier s’entoura bientôt de moyens performants pour rééquilibrer l’inégalité. Des cours d’instruction accélérée furent dispensés à l’arrière au Panzerknacker (croqueur de chars). Chaque fantassin devait être capable de neutraliser et détruire des tanks.
Un mot d’ordre le stipulait : être prêt à tout instant pour la lutte anti-char (cf. récit de Jean Ernst).
La Kampfpistole Z, une arme-miracle, ne devait en aucun cas tomber entre les mains ennemies : il s’agissait d’un pistolet lance-fusées muni d’un tube rayé renforcé. Ce lanceur composite pouvait notamment expédier des Nebelpatronen (fumigènes), des Würfkörper 361 (grenades à main munies d’un tube à charge propulsive) mais surtout des Panzer-Würfkörper 42 (armes de jet à charge creuse thermo-fusible contre les blindés, cf. Ernst Jean).
Destruction des tanks russes
Le KW1 pesait 43,5 tonnes et disposait d’un canon de 7,62 cm. A titre de comparaison, le T.34 affichait 26,3 tonnes et 2-3 mitrailleuses. Il y avait plusieurs moyens de neutraliser ou de détruire les blindés ennemis :
a) de manière passive : lancer des obus fumigènes, se terrer dans des trous individuels très profonds.
Consigne : surmonter l’effroi, ne jamais bondir et se sauver, mais se rouler dans les tranchées face à un tank.
b) attitude normale à adopter : retenir ou séparer l’infanterie d’accompagnement, il fallait une parfaite connaissance des modèles de tanks (points forts et faibles, armement, ouvertures, angle mort).
c) de manière active : maîtrise de soi et adresse lors du lancer de grenades, approvisionnement en matériel adapté pour combat rapproché (sauts et bonds, grimper sur les chars).
Matériel improvisé :
a) pour lutter contre les monstres T.34 :
- provoquer feu et fumée pouvant être dégagés par du foin, des branches humides, de la paille mouillée saupoudrés d’essence ou d’huile qu’on enflamme sur place (voire qu’on allume par balles traçantes).
- balancer des chiffons imbibés d’essence ou du matériel facilement inflammable sur la proue (l’avant) du tank.
- projeter de la boue, des peintures, de la chaux sur les écoutilles ouvertes du tank, ou à défaut des sachets de poussière, de farine, de ciment pour aveugler le pilote.
b) lutte contre des tanks à l’arrêt :
- grimper sur le mastodonte
- cacher la vue du tankiste et ses appareils de visée avec des toiles de tente ou des couvertures.
- perforer avec de longues tiges de fer les bouches à feu des mitrailleuses et les hublots (épiscopes).
- ouvrir à l’arraché le couvercle du tank avec hache, levier ou pied-de-biche et tirer au pistolet à l’intérieur.
- bloquer le fût du canon avec un bout de bois, de pierre, ou des mottes de terre ou y introduire une grenade.
Moyens pour gêner et embarrasser la progression des blindés russes :
Pour réduire la vitesse d’un tank, afin de l’arrêter et faire débarquer l’équipage, on utilisait :
- les grenades fumigènes (durée 2mn 30) à jeter dans la direction du vent pour faciliter l’approche du combattant.
- le pot fumigène tendant un rideau de fumée devant les canons et mitrailleuses (ou, à défaut, des grenades jumelées et assemblées avec de la ficelle et du fil de fer).
- le Blendkörper 1 H et le 2 H amélioré étaient constitués d’une ampoule-poire en verre contenant deux liquides séparés. Lors de la brisure, le mélange répandu formait une brume asphyxiante d’une durée de 15 à 20 secondes. Les ventilateurs et les ouvertures absorbaient ces gaz qui forçaient l’équipage à se rendre.
L’idéal était de projeter la fiole sur le devant du monstre.
Les moyens paralysants consistaient à détruire les chenilles, le capot du moteur et l’enflammer.
Pour ce faire, 3 moyens :
a) par explosifs :
- les grenades assemblées par bricolage étaient décapsulées et reliées à celle du milieu par un détonateur ou par un cordon auto-inflammable qu’il suffisait d’allumer et de jeter dans les chenilles.
- les pétards avec charge explosive d’un kilo étaient utilisés de la même façon. Ils servaient également à détruire les armes d’un tank. Il fallait les assembler et les relier par deux à l’aide d’un fil et les balancer de part et d’autre du fût du canon ou de la mitrailleuse de bord que le souffle de l’explosion arrachait alors.
Pour détruire la grille en claire-voie abritant le moteur, une chaîne de grenades reliées faisait l’affaire.
b) par des moyens incendiaires :
- Les bouteilles type cocktail-Molotov étaient emplies de 2/3 d’essence et d’un tiers d’huile.
Elles étaient obturées avec des mèches ou des bourres bien imprégnées d’essence et munies de bâtons allumeurs qu’on craquait, avant d’être propulsées sur l’habitacle du moteur (elles pouvaient aussi être allumées par auto-inflammation provoquée par le tir d’une fusée).
- Les bidons d’essence remplis à moitié d’essence. Au préalable on les avait percés et refermés avec des coins de bois. Lors du jet sur l’arrière du tank, une grenade était balancée sur le bidon qui volait en éclats en propageant les flammes partout.
c) par des moyens de destruction :
- Les charges concentrées de 3 kg (trois "pétards" liés) perforaient 6 cm d’épaisseur. Il était nécessaire d’en manipuler 2 ou 3 lots pour percer l’épaisseur d’acier des tanks imposants.
- Les mines plates T 35 (Tellerminen) d’un poids de 9 kg étaient amorcées par un cordon détonateur à retardement (10 secondes) ou par un Sprengkapselzünder programmé à 7 secondes.
Ces mines étaient jetées à partir de trous d’hommes dans les chenilles. Seuls, des fantassins bien entraînés pouvaient les lancer sur des tanks en action.
Une manière astucieuse consistait à les placer à l’endroit supposé du passage et lorsqu’un tank approchait, on hâlait la mine avec un fil de fer depuis la tranchée. Une planche, genre rampe à mines, sur laquelle étaient cloués plusieurs engins obstruait le couloir d’entrée des T 34 ; on pouvait également la traîner à partir de ficelles ou de fils vers les monstres en action. Lors de la neutralisation d’un tank russe par déchenillage, il suffisait d’une charge placée près de la tourelle pour l’arracher de l’habitacle. La place de choix était l’arrière du véhicule blindé, là où se situait le moteur. L’explosif était muni de crochets d’ancrage en fer et de chiffons pouvant mieux s’accrocher et ne pas glisser sur la cuirasse.
- Livrée dès l’automne 1942, l’hypercharge creuse (H3 Hafthohlladung) à effet explosif et à pression acoustique, de forme cylindrique et terminée en entonnoir, comportait une poignée et un trépied aimanté. Un détonateur à embout situé dans la poignée faisait exploser la charge entre 4,5 et 7 secondes après la manipulation. L’engin de mort était fixé de préférence sur les parties lisses du blindage, les ventouses magnétiques étant placées vers le haut. Il fallait prévoir des crochets ou des chaînettes propices à s’enferrer sur les tanks ennemis enduits de terre ou cimentés qui se présentaient immunisés contre le magnétisme. Cette charge infligeait un trou de 5 cm de diamètre dans de l’acier épais de 14 cm.
- La Panzerfaust apparut vers juillet 1943. Cette fusée anti-char d’une bonne efficacité arriva au compte-gouttes. Une compagnie n’en détenait que deux durant l’été 1944. Cette arme légère, portable, était appréciée dans les combats rapprochés au milieu du raffut. La "tête" garnie d’une charge creuse était propulsée par de la poudre noire casée dans un tuyau d’acier. Dès sa sortie, la tête volante s’auto-amorçait, propulsée par la charge de poudre. Les restes enflammés d’une partie de la charge, expulsés vers l’arrière, contrebalançaient le recul.
Le rétrojet de la flamme s’avérait dangereux : aucun arbre ni mur ou autre obstacle ne devaient entraver l’expulsion. L’emplacement du tireur localisé au milieu du nuage était très vite repéré : il lui fallait déguerpir.
Les Panzerfauste "gross" étaient les plus performants : 15 cm d’acier pouvaient être percés grâce au pouvoir d’intrusion fusible du projectile. Le bazooka (Ofenrohr = tuyau de poêle) était servi par deux hommes.
La torpille s’insérait par l’arrière. Arme dangereuse à cause de la sortie de flamme. Cible atteinte à 200 mètres.
Manfred Herz (cf. son récit) précise : « Les charges creuses pouvaient être tirées à partir de la Panzerfaust (cartouche à poing) à 90 mètres et du Ofenrohr (avec sa boîte à fusées blindées) à 100 mètres, distance jusqu’où elles étaient efficaces. La Panzerfaust -contrairement à son usage- fut utilisée contre l’infanterie.»
En ce qui concerne les armes à propulsion (Do-Wefer), il s’agit d’assemblages simples, du genre caisses d’emballage montées sur rails. Les six fusées sont lancées électriquement. Elles partent en trajectoire haute et tombent en hurlant sur une grande surface d’où le nom de « Stuka à pied ».
Attitude du destructeur de chars :
1) embrumer le paysage,
2) s’approcher au plus près,
3) jeter des bouteilles enflammées sur le moteur,
4) jeter la charge de préférence dans les chenilles,
5) balancer des grenades dans les ouvertures,
6) en aucun cas, se sauver devant un tank.
Calme, sang-froid, force de caractère, intrépidité assurent la réussite, surtout si l’abordage se fait en équipe de trois (le protecteur, l’aveugleur et le destructeur).
La bravoure humaine était récompensée par la médaille "Panzervernichtungsabzeichen".
« ... Il va chercher jusque dans la gueule du canon une gloire passagère. » William Shakespeare
 Survivre au jour
Survivre au jour
le jour à Tambow
Faut-il rappeler que les Alsaciens-Mosellans dérouillèrent au camp 188 ! Des milliers de leurs carcasses anonymes dorment agglutinés dans les charniers de la forêt-nécropole de Rada, à 12 km de Tambow-ville.
Tambôôve ! Deux syllabes qui sonnent le ré et le mi du glas. Parfois soixante morts en une nuit ! Morts de ? Les rescapés pourraient mieux que quiconque égrener leurs lents supplices : famine, sous-nutrition, vermine, sévices, travail forcé en forêt, dans la tourbière et à l’écluse, maladies radicales entassèrent les dépouilles dans la morgue n° 22 du camp 188, mais également dans la baraque 112 de la quarantaine.
22, les flics ! Une police au comportement tyrannique mettait au pas les Français bordéliques. Maintien de l’ordre et discipline qui font la grandeur des armées, voilà les deux manivelles qui firent tourner la machine concentrationnaire supervisée par Ioussitchev, le commandant russe. L’existence raisonnable qu’avaient connue les 1500 avant leur départ pour l’Algérie, devint, hélas, après le 7 juillet 1944, une pâle photocopie du modèle précédent. Le camp dit des Français, au fil du temps abhorré qui passait si lentement, s’apparenta dès lors plus à la descente aux enfers. L’hiver rigoureux trouva les captifs complètement dépourvus. Les sandales-godillots trempés par le froid polaire s’apparentèrent à des instruments de torture. Retirer les chiffons pourris permettait de découvrir des pieds gangrenés de parfaits cadavres ! L’affaiblissement de la résistance humaine dû à cette promiscuité, la marque olfactive de la décomposition émanant de la morgue et l’odeur méphitique du Bouc dans les tanières, où les rats pouilleux cohabitant avec les abjectes légions de parasites transportaient les épidémies et mordaient à tout va vivants et macchabées, ajoutèrent au stress des vaincus. A la déception de ne pas partir vers Alger s’additionnèrent embrigadement idéologique, épuisements, adversités en tout genre, vexations, maladies, morts, surpeuplement, favoritisme de quelques-uns et exploitation de milliers d’autres.
Voilà réunis les ingrédients explosifs qui allaient envenimer l’après-Tambow. La perte de contrôle de l’appareil policier par le Club qu’on accusa à tort ou à raison de tous les maux dès le rapatriement, fut le résultat de la séparation du politique avec le militaire voulu par la direction russe du camp ce qui fit, entre autres, émerger le rôle très discutable et criminel de certains sergents-flics, garde-chiourme aux mains couvertes d’ignominie, Ndr.
.
« Camps de Jassy et de Minsk (lazaret) puis de Tambow. Mauvais hébergement, quarantaine, mal nourri, corvée de travail à la limite des forces restantes, quelques vidanges de latrines, manque de soins médicaux, conditions hygiéniques déplorables. Activité au kolkhoze, typhus soigné au lazaret. Rapatrié le 27 octobre 1945 (oedème dans les jambes, 47 kg au retour). » Boeglen Paul, né le 23. 07. 1923

« Camp de Kiev (mort de camarades), à Orsk (typhus, pleurésie avec fièvre et délire au lazaret, dysenterie 2 X, tourbière, kolkhoze, tuiles en bois). Transporté à Tambow avant de rentrer en France, je n’y ai passé que deux mois et tout était nettement mieux que dans l’Oural (nourriture, soins, etc…) c’est tout dire ! » Brenner Louis
« Camp de Kamenetz Podolsk avant de passer par Kiev, Orsk et Tambow.
Atteint du typhus avec fièvre très élevée, je n’avais plus le sens du toucher dans les doigts et j’étais presque aveugle. Sans réaction aucune, je ne pouvais plus attraper les poux et punaises. Oedèmes et poids de 40 kg au rapatriement. » Clos Alfred
«Fantassin français j’ai été capturé dans les Vosges le 15 ou 16 juin 1940. Evadé deux fois d’un stalag en Allemagne, j’ai été repris avec mon beau-frère, décédé maintenant. Instruction militaire menée en Lituanie. J’ai connu les camps de Memel, de Riga, de Nichni-Volotchek, de Moscou, de Tambow (avec des travaux effectués dans la tourbière, en forêt et dans un canal surnommé le canal de la mort) et enfin d’Odessa. Dans les trains, nous avons survécu sans eau ni nourriture, en étant fouillés sans arrêt par les soldats russes. J’ai connu au lazaret de Tambow la gale, l’œdème dans les jambes et le ventre, la perte de dents. La nourriture, le froid, les camarades qui mouraient ou qui partaient pour Kirsanow sans revenir ont été de durs moments à vivre. J’entends toujours les dawaï, dawaï, po piet, po piet, vite, par cinq. J’ai enduré ma captivité durant un an moins quelques jours. » Dauphin Marius
« J’ai été battu par un garde russe lors de la corvée de bois dans la forêt de Rada ». Diesch Célestin.
« Fantassin dans la Wehrmacht, j’ai été traumatisé par l’attaque des Stalinorgel et les massacres en particulier. J’ai été capturé dans une tranchée près de Vitebsk par un officier russe en mars 1944.
Dans les wagons de transport, des menaces de mort ont été proférées par des Polonais volontaires dans l’armée allemande. Suite à un accident survenu au camp de Tambow, j’ai perdu connaissance durant trois jours.
De nombreux camarades y sont décédés. Je pense toujours à l’abattage des arbres en forêt, aux privations de nourriture et à la vie dure passée au camp. Au bout de 18 mois de captivité, j’ai été rapatrié le 6 novembre 1945, pesant 43 kg avec des oedèmes dans les jambes et au ventre. » Epting Charles, né en 1918
« Tambow : manque de nourriture, cris des malades la nuit dans le lazaret, ces misères vous tiennent encore éveillé quarante ans après les faits. J’ai œuvré dans l’usine de tracteurs à 6 km de la ville de Tambow.
J’ai été libéré en octobre 1945. » Faller Eugène René, né le 05. 11. 1919
«15 janvier 1943, appelé comme fantassin, instruction en Pologne. 15 juillet 1943, départ pour le Mittelabschnitt où j’ai récolté une blessure à la jambe et à l’épaule droite provoquée par des éclats d’obus.
Je me suis évadé le 4 août 1944 durant les combats de Byalistock, avec la peur au ventre. J’ai été maltraité plusieurs fois. Nous avons végété trois semaines dans des wagons-à-bestiaux, presque sans nourriture, avant d’arriver à Tambow : abattage d’arbres en forêt, peur du lendemain, éternelle faim. J’ai été admis au lazaret (eau dans les jambes). J’avais un frère dans l’armée allemande. » Fichter Alfred, né en 1921
«A Tambow, la peur et la frayeur existèrent toujours du début jusqu’à la fin de la captivité. Je suis resté au cachot une semaine, puis j’ai passé trois semaines au lazaret où tous les jours disparaissaient quelques malades. J’ai participé une fois à la corvée de latrines sans compter le reste (faim, froid, parasites, morpions).
J’ai été libéré le 20 octobre 1945, avec 42 kg et de l’eau jusqu’au ventre.
Mon frère a également été prisonnier en Russie. » Fornoff Georges, né le 30. 09. 1925
« J’ai été interné le 28 août 1944 en Bulgarie puis remis aux Soviétiques. Notre colonne devait faire des marches de durée presque insupportable, sans voir de but à ces promenades homicides. Tambow : pénurie de nourriture, absence d’hygiène et manque de repos dû aux puces et punaises, assistance des derniers instants auprès de camarades qui auraient autrement agonisé dans l’indifférence. A cause de deux bouts de doigts de pied gelés, j’éprouvais des difficultés pour me déplacer. J’ai été rapatrié le 23 octobre 1945. » Fromageot Etienne
« J’ai été capturé à Pillau en Prusse-Orientale le 25 avril 1945.
Je suis passé par le camp de Walk en Estonie avec arrivée le 20 mai à Tambow. Durant l’abattage d’arbres, je me suis un jour égaré du commando-bois pendant plusieurs heures en plein orage.
Je suis tombé en dépression lors des premiers départs pensant devoir rester à jamais en Russie. Je n’ai été libéré que le 19 octobre 1945 (perte de dents, eau dans les jambes, 54 kg). » Fuchs Edouard, né en 1919
« Dans les baraques perdues au milieu des bois, saturées de puces, de poux et de punaises, nous étions couchés sur des rondins de bois, sans feu ni couverture en hiver. » Gauer Henri, né le 15.02.1913
« J’ai été fait prisonnier le 27 octobre 1944 près de Autz.
Je me suis évadé au cours d’un combat, en profitant de l’absence du sous-officier. Etant prisonniers, nous avons marché quelques kilomètres et nous avons été enfermés au-dessus d’une étable. J’ai d’abord séjourné au camp de rassemblement à Minsk. Alité au lazaret n° 7 de Tambow durant l’hiver 1944-45, j’ai constaté un matin que mes deux voisins étaient décédés. Mon meilleur camarade qui n’arrivait plus à avaler sa ration de pain m’a demandé d’échanger son pain contre mon café, ce qui signifiait la mort pour lui. Je l’ai supplié de faire moitié-moitié et de garder l’espoir qu’un jour nous retournerions de nouveau à la maison. Ce dernier a été rapatrié quelques jours avant moi. Malheureusement, en arrivant à mon domicile fin octobre 1945, j’ai appris par des collègues que ce camarade était mort au cours du transport de retour. Mon frère a fait la guerre en Italie. »
Gautner Julien, né le 28. 10. 1925
«….. A Tambow, lorsque nous ne pouvions pas abattre la norme de bois en forêt, les gardes nous battaient. » Geschwind Edouard
« Je suis passé par les camps de Vilna puis de Tambow (travaux dans le futur cimetière, abattage d’arbres et terrassement du sol). J’ai vu des camarades gravement malades mourir par faute de soins et de nourriture. » Gousse Jean-Pierre, né en 1916
« 15 mois de captivité à Tambow : travail dans la tourbière. Je pesais 40 kg à mon rapatriement, j’avais de l’eau dans les jambes, j’ai déploré la perte de dents à mon retour en France. » Grass André, né en 1925
« A Tambow, j’étais plein d’oedèmes, atteint de pneumonie et de dysenterie, aveugle la nuit. Mon Dieu, tout ce que j’ai vécu au lazaret pendant ma pneumonie ! Mauvais traitements, maladie, mort de camarades. Je pensais ne jamais plus revoir la famille. J’ai dû travailler à l’écluse. J’ai été rapatrié le 25 octobre 1945. » Greder Alphonse
« J’ai été prisonnier durant plus de 24 mois, j’ai connu plusieurs camps avant celui de Tambow. Nous avons signalé la présence de camarades morts dans les wagons en débarquant en gare de Rada, les malheureux n’avaient pas pu supporter les durs aléas du trajet. J’ai été transféré de Tambow vers l’hôpital de Wolsk avec des camarades français mourants. Le catalogue de mes maladies signale : otite, pleurésie, scorbut, paludisme, oedèmes, pneumonie. J’ai fait partie d’un commando de travail en ville et à l’écluse. J’ai séjourné à la caserne Reuilly à Paris le 21 octobre 1945. Grentzinger Lucien, né en 1914
« J’ai été capturé le 2 février 1944 à Dnieprovetchenka, sur le front Sud. De tout notre bataillon encerclé, il en est resté six blessés, dont quatre qui furent ensuite massacrés par des Mongols surexcités. Les deux seuls rescapés alsaciens dont moi-même, nous avons été transférés dans un camp près de Kharkov. Lors des marches, les retardataires qui ne pouvaient plus suivre étaient fusillés. J’ai été soigné au lazaret de Kiev pour typhus.
A Tambow, la besogne était très éprouvante surtout dans la tourbière et dans la forêt.
J’ai été rapatrié le 25 octobre 1945 après 21 mois et demi passés en captivité, avec des oedèmes dans les jambes et accusant un poids de 47 kg. » Gross Marcel
« Tambow : la mort permanente rôdait au camp avec son cortège de camarades décédant par suite d’épuisement, de faim et de mauvaise hygiène. J’ai travaillé en forêt, avec abattage d’arbres au programme. »
Guillaume Paul, né en 1924
« Tambow et son cahier de doléances : avec la baraque des morts, les corvées, notamment les waters à vider, le rassemblement journalier de l’appel par –40°C, pendant parfois deux heures, le froid, le travail à l’écluse…» Haag René, né en 1923
« L’événement le plus éprouvant fut la mort de nombreux camarades, j’en ai trouvé certains, morts au lever.
J’ai travaillé à l’écluse. J’ai été rapatrié en septembre 1945 accusant un poids de 46 kg. »
Haas Guillaume, né le 4. 3. 1914
« Fait prisonnier le 8 mars 1945 à Schmendkau (région de Dantzig), j’ai profité de la déroute de mon unité pour rester sur place et me rendre. J’ai transité par le camp de Polodsk puis par celui de Tambow.
Les cadavres ambulants eurent à souffrir de la faim, de la soif, de la vermine, du manque d’hygiène et des mauvais traitements. Le chargement des morts pendant la nuit, la découverte de fosses communes dans la forêt de chênes, ce sont des cauchemars qui me suivront dans la tombe.
J’ai été rapatrié le 3 octobre 1945 avec mes 34 kg. » Halbeisen Jean, né en 1926
« J’ai transité par les camps de Landsberg an der Warthe, de Posen, d’Orcha et de Toropesch avant de débarquer à Tambow et de passer par le lazaret. J’avais peur de rester à jamais en Russie, (corvées de latrines, mauvais traitements, camarades mourants, affaiblissement par insuffisance de nourriture et sa mauvaise qualité). J’ai trop travaillé dans de terribles conditions en forêt, au kolkhoze et au façonnage des tuiles en bois. Je suis retourné au pays le 28 octobre 1945 avec des oedèmes et la perte de dents. Des camarades sont morts lors du transport de retour. Pour mon bien, je ne veux plus parler de ces événements. » Halle Joseph, né le 25. 03. 1927
« J’ai été fait prisonnier le 25 juillet près de Kovno (Kaunas). Nous avons effectué trois jours de marche vers Vilna, sans nourriture et en souffrant de la soif, par une grande chaleur estivale. Les prisonniers à bout de forces étaient tués par les gardiens du convoi.
Au cours des dix-sept jours de trajet passés dans le train de Vilna à Tambow, il faisait très froid dans les fourgons dépourvus de chauffage, et nous n’avions que du pain sec et un seau d’eau par wagon et par jour !
J’ai effectué de durs travaux au commando de l’écluse avec des menaces de mort et de déportation à l’appui. Les baraques malsaines et sombres, les puces et punaises, les corvées, les barbelés, le manque de nourriture, le grand froid, les gardiens et les chefs du camp, chacun d’entre nous en a connu leurs méfaits. » Hartmann Paul
« Parti le 1er février 1944 dans le Mittelabschnitt, j’ai été capturé le 29 juin à Bobruisk. Nous avons marché 15 jours sans la moindre nourriture. Au cours de mes trois premières semaines de captivité, j’ai contracté une pneumonie. On m’a laissé sans soins : j’ai même été maltraité par un médecin-major allemand.
A Tambow, j’ai fait ce qu’on appelle des travaux forcés à la tourbière. J’ai été soigné pour typhus au lazaret. »
Hartmann Paul, né en 1915
« J’ai été soigné au lazaret de Brest-Litovsk pour dysenterie, puis je suis passé par le camp de Minsk avant de débarquer à Tambow où j’ai bossé dans la tourbière et la forêt. J’ai été enfermé au cachot cinq jours, dénoncé injustement par un chef lorrain. Départ de Tambow le 8 septembre, arrivée chez moi le 21 octobre 1945, pesant 48 kg. » Hassenforder Marcel, né en 1922
« Après un passage par Stotze, je suis arrivé dans l’Oural à Alabay où j’ai souffert de dysenterie. A l’entrée du camp de Tambow, au moment du départ, on nous a pris tout le ravitaillement, c’est-à-dire de la nourriture prévue pour une dizaine de jours destinée à couvrir nos besoins alimentaires jusqu’à Odessa (certains M-N ont pu partir avec les prisonniers français de 1940 récupérés par les Ruses en Prusse-Orientale, Ndr) et pour passer ensuite en Afrique du Nord. Je suis retourné au pays natal le 29 août 1945. » Haumesser Marcel
« Après le camp de Saporoshje, j’ai rejoint celui de Tambow. J’ai éprouvé une grande peur lorsque j’ai été forcé de creuser en hiver de grands trous pour enterrer par cinquantaine les camarades défunts. Après mon travail à l’écluse, j’ai été admis au lazaret (eau dans le ventre). J’ai été rapatrié en août 1945 avec un poids de 45 kg. »
Hazard J., né en 1921
« Après avoir vécu le bombardement sur Dresde le 14 février, j’ai été envoyé au front. J’ai combattu sur la frontière polonaise. Après notre capture le 8 mai 1945, nous avons longuement marché sur 500 km sans manger ni boire. J’ai séjourné au camp d’Auschwitz avant de venir à Tambow où j’ai travaillé au kolkhoze.
Faim, maladie, gale, poux étaient omniprésents. Je suis revenu malade de la peau et pesant 38 kg. »
Herbrech Etienne, né en 1927
« Instants inoubliables vécus le soir de Noël : j’ai rangé les corps de mes camarades dans la baraque des morts. J’ai travaillé en forêt et au kolkhoze. Je pesais 37 kg à mon retour. » Hirsinger Henri, né en 1920
« Notre convoi est parti de Focsani, en Roumanie. Serrés dans le wagon au point de ne pas pouvoir nous asseoir, nous avons passé trois semaines dans ce cercueil ambulant sans manger ni boire. J’étais en compagnie d’un Strasbourgeois et d’une soixantaine de Hongrois. Rongés par la vermine, nous avons aussi souffert du froid. Il y eut plusieurs morts. J’ai séjourné dans les camps de Tcheliabinsk (Oural) et de Tambow. J’ai côtoyé la misère, les puces, les camarades morts à côté de moi au lazaret. Il fallait soutenir et guider les camarades aveugles qui se traînaient dehors pour aller aux latrines la nuit. J’ai travaillé dans un sovkhoze. Après mon retour en octobre 1945, j’ai mis plus d’un an à me débarrasser de la gale, c’était très éprouvant. » Holtz Georges
« J’ai été fait prisonnier le 1er juillet 1944 dans le secteur de Bobruisk, étant encerclé pendant la retraite. J’ai été puni injustement plusieurs fois par les Russes. A Tambow, j’ai travaillé à l’écluse et au kolkhoze. Captif durant 16 mois, j’ai été libéré le 20 octobre 1945 (perte de dents et œdème généralisé constatés). » Hummel André
« Parqués dans une usine à ciel ouvert à Brest-Litowsk où il n’y avait rien à manger, nous avons connu, après un long voyage en train glacial, sans couverture, le camp de Tambow (pour ma part, j’ai travaillé en forêt et au kolkhoze). Damnée corvée de chiottes ! Tous les jours, on sortait les morts, entassés sur un chariot.
En janvier-février 1945, par tous les temps (froid, neige ou pluie), nous partions en corvée le matin dans l’obscurité jusqu’au soir, avec un peu de thé et du pain. Il faisait à nouveau nuit lorsqu’on rentrait.
J’ai été rapatrié le 22 octobre 1945, avec de l’eau dans les jambes. » Huntziger Fernand, né en 1923
«Fantassin formé en Allemagne, je suis parti sur le front en juin 1944. L’explosion d’une grenade m’occasionna une blessure à la poitrine. Faits prisonniers avec d’autres camarades en mars 1945 près de Thorn, les Russes nous ont cloîtrés dans une cave. On avait peur qu’ils nous tuent. Le lendemain, on nous a donné un seau d’eau avec quelques morceaux de pommes de terre. « Tovarich goujati ! » Le camp de rassemblement se situait en Lituanie. A Tambow, on a cru qu’on ne rentrerait jamais plus en Alsace.
Le vol de ma gamelle à soupe m’a marqué. Comment avaler le précieux liquide distribué sinon en attendant le bon vouloir d’un copain daignant me prêter son récipient ? J’ai travaillé au kolkhoze avant d’aller au lazaret tenter de soigner ma nyctalopie. Je pesais 48 kg au retour le 21 octobre 1945.
J’ai un frère né le 4 juillet 1923 qui est tombé en Pologne. » Hutter Armand, né le 21. 01. 1921
« Le 18 janvier 1943, instruction de fantassin en Tchécoslovaquie. Départ le 13 août pour le front central. Faits prisonniers le 13 septembre 1943 à Krupetz, il nous a fallu marcher plusieurs jours sans boire ni manger.
Le camp de Tambow et les tâches au-dessus de nos forces dans la tourbière, en forêt et à l’écluse rendaient les hommes squelettiques. On extrayait de la baraque des morts les cadavres pour les enterrer en forêt. Neige et froid nous ont gelé mains et pieds.
Prisonnier durant 26 mois, j’ai été libéré le 6 novembre 1945. » Isner Lucien, né en 1923
«Le 30 octobre 1943, j’ai été appelé dans l’infanterie pour être instruit en Pologne avec chasse aux partisans à Kielce. Départ pour le front russe le 7 mai 1944 dans la région de Tarnopol. Après les bombardements par l’aviation et par les orgues-de-Staline, nous sommes restés 20 à 25 rescapés sur notre compagnie forte de 120 hommes. J’ai été capturé le 21 juillet à Zborow en restant sur place. On nous a administré des coups de crosse et de fouet pendant la marche. Quelle galère de devoir vivre à 120 personnes dans des wagons fermés, prévus pour 80, sans air ni lumière ! J’ai séjourné dans les camps de Tchernigov et de Tambow. J’ai eu les deux pieds gelés. J’ai effectué des travaux forestiers et fermiers dans un sovkhoze administré militairement mais qui impliquait également des internés russes. Les maladies nous guettaient et nous disposions de peu d’eau ; durant les nuits, nous étions entassés dans des baraques dépourvues de lumière. J’ai perdu connaissance au moment du rapatriement (24 octobre 1945), dans le train près de Varsovie. » K. A., né en 1925
« J’ai été soigné au lazaret de Tambow pour cause de typhus. Le jour précédant le départ des 1500, on m’avait retiré du contingent sans doute pour avoir contesté l’autorité des chefs français. J’ai été plusieurs fois puni de corvées de latrines, j’ai travaillé en forêt. Nous avons surtout souffert des manques de nourriture et de soins, du froid, des puces, des punaises, des poux et des corvées supplémentaires. Que penser de la situation du camp et des baraques sinon qu’elle était désastreuse ! J’ai été rapatrié le 28 août 1945 après 22 mois de captivité (jambes enflées par l’œdème). » Kammerer Raymond, né en 1919
« Capturé le 30 avril 1945 après mon évasion, j’ai assisté à l’exécution de prisonniers. J’ai passé six mois à Tambow, (impliqué dans le commando de la forêt et au kolkhoze). Si l’on manquait singulièrement de nourriture, par contre on était saturé de punaises et de puces !
Oedémateux, je pesais 45 kg au retour pour une taille de 1,80 m. » Kayser Martin, né en 1926
« J’ai été capturé le 7 juillet 1944 à Stoboda en Russie, lors d’une patrouille de reconnaissance.
J’ai travaillé en forêt de Tambow. J’ai vu mourir mes amis à côté de moi. J’ai deux frères qui ont fait la guerre en Russie et qui ont été faits prisonniers ; l’un d’eux est porté disparu. » Keim Lucien, né le 11. 03. 1925
« Après le séjour d’un trimestre dans le camp de Stanislau en Galicie, j’ai vécu trois semaines de transport en wagon avec 80 personnes à bord avant d’arriver à Tambow. J’y ai séjourné 9 mois. Forêt, kolkhoze et atelier de fabrication de tuiles en bois m’ont vu défiler dans leurs espaces respectifs. J’ai passé deux semaines au lazaret (diarrhées, oedèmes plus la faim, aveugle). Nous avons enduré et supporté difficilement l’hiver avec ses – 23°C, sans vêtement et sans chauffage. J’ai participé plusieurs fois aux corvées de chiottes et au commando des cadavres (Leichenkommando). J’ai été libéré le 20 octobre 1945, (avec un poids flatteur de 62 kg au demeurant, car gonflé par l’eau dans les jambes). » Kellhofner Aloyse, né le 19. 04. 1923
« Sur le chantier dépendant du camp de Brest-Litowsk, des coups de matraque tressée avec du fil de fer nous ont été généreusement distribués. Je suis arrivé à Tambow en juin 1945. Après cette date, je n’ai plus été affecté à une corvée. Je suis rentré avec le 1er convoi (35 kg, perte de dents, eau dans les jambes). Pendant toute la durée de la captivité, j’avais peur de ne jamais plus pouvoir rentrer. » Kiefer Michel, né en 1925
« Fantassin allemand appelé le 18 mai 1943, j’ai été affecté en septembre dans le secteur de Vitebsk. J’ai eu deux pieds gelés dont la gravité a entraîné une amputation des doigts de pied.
Je me suis rendu aux Russes à Pilo le 25 avril 1945. Après une halte dans les camps de Koenigsberg et de Rubinsk, je suis arrivé à Tambow où j’ai vécu avec la peur et ses traumatismes psychiques qui ne se racontent pas. J’ai travaillé en forêt.
Rapatrié le 25 octobre 1945, je pesais 40 kg. » Kinné Joseph, né le 02.02.1924
« Après le passage au camp de Posen, j’ai été admis au lazaret de Voronej. Il n’y avait presque rien à manger au camp de Tambow. J’ai travaillé en forêt et dans un kolkhoze. Mon rapatriement a eu lieu le 24 octobre 1945. » Klein Jean
«A Tambow, j’ai été puni de plusieurs corvées de latrines. Je suis passé par le lazaret pour soigner mon typhus. La perte de tous mes camarades de la classe 1925 de mon village. Qui pense à la douleur des parents éprouvés ? Ne plus jamais passer par là ! J’ai été rapatrié en France le 21 octobre 1945.» Klein Joseph, né en 1925
« 20 février 1944, instruction comme Sanitäter (infirmier) en Prusse-Orientale et départ pour la Lituanie le 28 juillet 1944. Evadé des lignes allemandes, je n’ai rien eu à manger ni à boire pendant les marches forcées. Je suis resté prisonnier 15 mois à Tambow et dans d’autres camps de rassemblement avant d’être libéré le 20 octobre 1945. Faim et soif ont accompagné notre dur labeur quotidien. Au retour, je pesais 46 kg, les oedèmes gonflaient mes jambes et mon ventre. Mon frère a été également prisonnier des Russes. » Koeberlé Xavier, né en 1921
« Après la capture, nous avons marché de jour et de nuit, sans repos ni nourriture. A Tambow, s’effectuait tous les matins le ramassage des corps de camarades décédés pendant la nuit. Un chef m’a imposé une corvée de latrines. J’ai travaillé en forêt et fabriqué de tuiles en bois. Je suis resté sept mois en captivité, j’ai été rapatrié par train sanitaire en novembre 1945 (oedèmes dans les jambes et le ventre). » Kroepffle Adalbert, né en 1909
« Capturé à Putiwol, je suis resté prisonnier durant deux ans (abattage d’arbres entre autres occupations). Rapatrié de Tambow le 1er septembre 1945 vers la France, j’accusais un poids de 42 kg (il me faut préciser la perte de dents, mes œdèmes dans les jambes, et le fait d’avoir été aveugle la nuit). »
Kubler René né le 05. 11. 1920
« J’ai été capturé à Torun en janvier 1945. Gare aux retardataires éprouvant des difficultés pendant les marches forcées ! Il fallait toujours se tenir en tête des colonnes sinon ! J’ai vu mourir beaucoup de prisonniers dans un état lamentable et je vous répète à mon jeune âge ! La faim a été l’épreuve la plus difficile pour nos corps d’adolescents. J’ai abattu des arbres en forêt de Rada. J’ai été rapatrié en septembre 1945. »
Kurtz Gilbert, né le 28. 04. 1927
« Capturé le 10 janvier 1945 à Slubitz en Pologne pendant la retraite, j’ai connu les camps de Brest-Litowsk et de Tambow. Dans les wagons-à-bestiaux nous étions entassés sans eau et avec très peu de nourriture. J’ai vu des camarades mourir, victimes de jeûne absolu, ça remue. J’ai été dans une baraque où de jeunes soldats se sont amusés à tirer à travers la porte. J’ai été rapatrié le 19 octobre 1945 (typhus, jambes enflées, perte de dents ultérieure). » Lacour R.M., né le 17. 10. 1925
« Les conditions climatiques étaient épouvantables durant l’hiver 1944-45. J’ai travaillé à l’écluse. »
Lang Aloyse, né en 1912
« Nous avons enduré faim et soif pendant la marche qui nous a menés en quatre jours des environs de Minsk à Vilna. Tambow : j’ai enduré la faim, la dysenterie, le dur travail dans la tourbière, l’hiver mémorable 1944-45. La mort de tous ces camarades, quel gâchis de la vie humaine !» Langolf Jean-Paul, né en 1924
« Tambow avec ses stations dignes d’un chemin de la Croix : la maltraitance, la mort de camarades, l’injustice des kapos alsaciens, la soif, le manque d’eau, les poux, les punaises, les travaux en forêt et au kolkhoze. »
Lantz Valy, né en 1917
« J’ai été fait prisonnier le 16 mai 1945 à Pavilosta en Courlande, une semaine après la capitulation !
Nous n’avons rien eu à boire pendant les cinq jours de voyage qui nous a menés du camp d’Autz à celui de Moscou. C’était l’été, nous étions 100 hommes par wagon.
J’ai été victime d’une très forte dysenterie à Tambow, ce qui m’obligeait continuellement à filer aux cabinets. Malade de la sorte, je n’avais pas faim, je ne grignotais même plus mon pain, tant j’étais affecté. D’ailleurs, je n’ai jamais été au réfectoire, ayant toujours préféré manger ma minable croûte dans la baraque. J’ai refusé d’aller à l’infirmerie. Voir la baraque 22 (la morgue) et constater que j’étais aussi maigre que les morts, ça vous secoue ; même les plus intrépides étaient tout retournés. Je ne sais rien de ce que j’ai fait dans le wagon du retour lors de mon rapatriement (avec 42 kg sur la balance).» Lecomte Louis, né le 16. 05. 1925
« J’ai vécu dans les camps de Minsk, de Gorki et de Tambow. Promiscuité dans les baraques, camarades sous-alimentés, attente devant le point d’eau, mauvaise nourriture, vermine, punaises, poux, ont plombé mon séjour. J’accusais le poids de 39 kg à mon rapatriement le 3 octobre 1945. » Löhsl Henri Gaston, né en 1925
« L’unité s’est rendue le 8 mai 1945 en Courlande sous les vociférations des femmes russes et les jets de pierres. Je suis passé par le lazaret de Vilna. Je suis devenu journaliste-traducteur au camp de Tambow. L’insoutenable visite de l’infirmerie, le ramassage des morts le matin, ces visions-là resteront à jamais gravées.
Avec le recul, je pense que cette expérience dangereuse et douloureuse, dont on aurait pu se passer, était enrichissante intérieurement et m’a permis de méditer néanmoins sur le sens de la Vie et les vraies valeurs humaines ; ce fut aussi une occasion unique pour apprendre à connaître les hommes tels qu’ils étaient réellement, surtout en captivité. J’ai été rapatrié le 23 octobre 1945. » Lohstetter Willy, né en 1916
«Au camp de Reduitzanow, on a volé mes vêtements pendant mon sommeil. A Tambow, nous transportions les corps de camarades qui mouraient quotidiennement dans une baraque où étaient entassés les cadavres.
Nous devions endurer le manque de nourriture et le froid pour nous rendre au travail, au réfectoire, aux latrines. J’ai participé au ramassage de bois et travaillé au kolkhoze. Une broncho-pneumonie me laissa inconscient quatre jours….. » Louis Gaston
« Appelé le 10 juin 1944 dans l’infanterie, j’ai été affecté sur le front le 19 septembre puis capturé le 24 janvier 1945 en Pologne. Abattre des arbres en forêt de Rada a été l’un de mes boulots. J’ai été libéré le 1er septembre 1945 avec des oedèmes dans les jambes et le ventre. » Maeder Paul, né en 1927
«J’ai été fait prisonnier à Husi le 25 août 1944. Privé de manger et d’eau, j’ai été battu lorsque j’ai dit que j’étais Français. En passant dans plusieurs camps de transition, au début de la captivité, on s’est trouvé sans abri pendant presque un mois. Après le lager de Litsichansk, j’ai connu Tambow et sa désormais légendaire malnutrition. Je suis passé au lazaret à cause de la malaria. J’ai été libéré le 25 octobre 1945, (avec perte de dents et oedèmes). » Marx Marcel, né en 1921
« J’ai combattu à Orcha, mais j’ai été capturé fin juin 1944 à Bobruisk, étant encerclé pendant la retraite. Lors des marches forcées sans nourriture et surtout sans eau à boire, j’ai constaté amèrement que la soif est encore plus terrible que la faim !
Après le camp de Bobruisk, j’ai été hospitalisé au lazaret de Winprisk pour y soigner les séquelles de ma blessure de guerre survenue en mai. En forêt de Tambow, j’ai participé à l’abattage d’arbres et je me suis ressourcé au kolkhoze. Insuffisance de nourriture, mort journalière d’Alsaciens causée par le manque de soins, comportement abusif des chefs français envers leurs malheureux camarades sans défense, hygiène déplorable, incompréhension des Russes vis-à-vis des incorporés de force avec leur préférence manifeste donnée aux Allemands, impossibilité de pouvoir écrire à nos familles par l’intermédiaire de la Croix-Rouge et rétention d’informations concernant l’avance des troupes alliées et le déroulement de la guerre ont contribué au malheur des captifs. Mon rapatriement a eu lieu le 3 septembre 1945, je pesais 45 kg. » Metzger Edmond, né en 1917
« Fait prisonnier au sud de la capitale polonaise le 16 janvier 1945, j’ai transité par les camps de Pulawy, de Segesa avant de filer à Tambow (avec abattage d’arbres et façonnage de tuiles au programme). Les malades dans les baraques, le travail, le rien à manger ou le presque rien, le manque d’affection et l’absence de nouvelles de la famille ont terni le tableau. J’avais très peur de ne pas pouvoir rentrer en France après le départ du premier convoi d’août 1945. » Meyer Alfred, né en 1925

« Affecté dans la région d’Orel en février 1943, j’ai déserté le 30 juin 1944 dans le secteur bouleversé de Bobruisk. Dans le 1er camp à Astachko, j’ai travaillé dans l’écluse. J’ai participé à la construction d’un canal à Nichni-Wolotschek. Aveugle la nuit à Tambow, j’ai séjourné dans la baraque des convalescents après mon retour du commando-bois. Le fait de voir mourir des camarades par défaut de toutes mesures d’hygiène et de médicaments a été moralement épouvantable. »
Meyer Gérard, né en 1924
« Après les séjours rapides dans les camps de Byalistock et de Minsk, on a déploré durant le transport vers Tambow la perte de beaucoup de copains. J’ai contribué à la fabrication de tuiles, aux réparation et construction de baraques. Particulièrement éprouvante était la mort des copains. J’ai été rapatrié le 12 août 1945. »
Muller Ernest, né en 1922
« J’ai connu les camps de Wolhau, d’Oppeln. A Tambow, l’abattage d’arbres puis le travail à l’usine de wagons ont figuré sur mon programme de captif exploité. Tous les jours, je voyais qu’on enterrait des morts. J’ai été libéré le 27 octobre 1945, avec de l’eau dans les jambes et dans le ventre. » Muller Joseph Jules, né en 1925
« J’ai été capturé le 18 avril 1945 à Francfort-sur-L’Oder. Après une marche forcée et pénible qui n’a pas arrangé le moral, nous avons été entassés par centaines dans des wagons pendant 8 jours. Passages successifs par les camps de Posen, de Landsberg, puis dans un camp près de Moscou et enfin de Tambow (abattre des arbres en forêt). J’ai quelquefois été puni de corvées de latrines, j’ai séjourné au lazaret pour y soigner dysenterie et maux d’intestins. Travail dur et peu de nourriture rimaient ensemble. Tous les jours beaucoup de camarades mouraient de maladies ou par faiblesse. Mon frère a été incorporé dans la Wehrmacht. » Muller Léon, né en 1912
« Une longue captivité de 25 mois m’a vu transiter par les camps de Kharkov, de Riabov et d’Arsk avant d’arriver à Tambow-Rada. Que de morts pendant le transport de la gare de Rada à Arsk (Kazan) ! J’ai été hospitalisé à Orsk pour mes pieds qui avaient gelé au 2ème degré entre Kharkov et Tambow, par –25°C dans le wagon, mais aussi pour dysenterie et infection des bronches. Des camarades sont morts devant moi. On finissait par s’y habituer. A Riabov, près d’Ijevsk, j’ai travaillé dans une tourbière (perte de connaissance), en forêt et au kolkhoze. J’ai eu l’occasion d’écrire sur une carte du Croissant rouge turc : elle n’est jamais parvenue à mes parents. J’ai subi une fois un interrogatoire sévère mené par le politruk de Rada. Dans la tourbière dépendant du camp 188, j’ai été puni d’une nuit passée au karzer pour m’être éloigné du chantier.
Patienter durant les interminables proverkas par – 35°C (appel-contrôle), attendre la maigre pitance du matin jusqu’au soir, se réveiller le matin avec les morts à côté de soi, endurer les douleurs dans les pieds gelés, l’incertitude concernant la distribution de pain et de soupe, la faim, la faction de planton devant la baraque par –40C°, les corvées de tinette, la brutalité des kapos et des Russes, les fouilles, le bania (ablution avec une écuelle d’eau !) en hiver, les maladies, voilà résumé notre vécu horrible là-bas ! Lors des appels et durant les sorties de corvées de bois, nous avons reçu des coups de pied et de poing sur la tête. Les chefs français n’avaient pas besoin de référer aux Russes pour maltraiter ou incarcérer leurs co-détenus.
Qui peut se représenter le calvaire de 25 mois de captivité passés en Russie ? Ceux qui l’ont effectivement vécue se taisent. A notre rentrée, en a-t-on parlé à Paris ? Mais de nos jours, face au battage médiatique, les prisonniers comme Kaufmann, ex-otage du Liban, ont eu droit aux larges échos de la presse écrite et parlée. Nous, notre condition est restée sans voix. » Nachbauer François
« J’ai été incorporé le 30 septembre 1943 dans la Luftwaffe (passage par Romorantin). Affecté au front russe le 12 novembre 1943, j’ai pris du service à Minsk le 2 mars 1944. J’ai combattu sur le front à Bobruisk où j’ai été fait prisonnier le 28 juin 1944 après m’être échappé des lignes allemandes. Camps de Urjupinsk et de Tambow (travail en ville). J’étais responsable de corvées. Je suis rentré le 21 octobre 1945. »
Nicard Jean, né le 11. 02. 1914
« Le 26 juin 1943, départ dans l’infanterie. Trois mois après, j’ai été affecté dans la région de Smolensk, avec, à la clé, des combats contre les partisans à Minsk. J’ai été blessé au genou. Mes derniers combats se sont déroulés à Gravas où j’ai été fait prisonnier le 25 août 1944 en traversant les lignes russes.
A Tambow, j’ai connu le travail au kolkhoze, les privations, l’internement, le matraquage. Le rapatriement a débuté le 12 septembre 1945, 47 kg. » Nichtke Lucien
« A Tambow, j’ai participé à la réparation de voies de chemin de fer. Je suis rentré en novembre 1945, pesant 40 kg environ, avec des oedèmes partout. » Oliger Robert, né le 20. 04. 1925
« Le 22 avril 1944, j’ai été appelé dans l’infanterie à Thorn et envoyé en novembre sur le front de Memel. Capturé en février 1945 entre Tilsitt et Ragnit, j’ai vécu six mois à Tambow en faisant connaissance avec les fléaux de la faim, de la soif, des poux. J’avais des blessures ouvertes aux jambes. J’ai trimé en forêt. »
Pfleger Laurent, né en 1911
« Passage par les camps de Pensa et de Tambow (kolkhoze, fabrication de tuiles). Froid, malnutrition, maltraitance commise plusieurs fois par les chefs français. » Printz Nicolas, né en 1916
« Ne plus revivre les combats ! J’ai séjourné dans les camps de Stanislau et de Tambow. Pendant des heures, il fallait faire la queue pour un peu d’eau ; les kapos, soi-disant français, nous renversaient nos boîtes. J’ai travaillé en ville. La faim, la peur du lendemain ! J’ai été libéré le 18 novembre 1945. » Ravaux L., né en 1923
« Tambow : j’ai travaillé au kolkhoze et au commando-bois. Comment ne pas évoquer le lent dépérissement de l’être humain réduit à l’état de la bête avec son seul souci permanent : la nourriture, la faim et toujours la faim ? » Rech Raymond
« Capturé le 11 mai 1945 en Tchécoslovaquie, j’ai travaillé en forêt de Tambow puis j’ai été contraint et forcé de turbiner aux corvées de latrines en compagnie la faim, la soif et les célèbres puces. J’ai soigné le typhus au lazaret. J’ai été libéré le 3 septembre 1945. » Riff Albert, né le 10. 06. 1922
«Passage par le camp de Bougourouslan dans l’Oural puis séjour calamiteux dans celui de Tambow (travail au kolkhoze). Heures affreuses durant toute la captivité, mort des camarades. Il n’y avait rien à manger, j’ai eu droit aux corvées de latrines, j’ai vu des camarades enterrer les nôtres.
J’ai été libéré le 25 octobre 1945. » Ringenbach Henri, né en 1923
« J’ai été capturé le 8 mai 1945 dans la région de Mitau. Marches forcées pénibles. J’ai connu les camps de Riga et de Tambow (travail en ville, au dépôt de chemin de fer). Vision des camarades malades à en mourir, manque de ravitaillement. Retour le 23 octobre 1945. C’était une chance d’avoir pu survivre après avoir enduré une si mauvaise captivité. » Schaffhauser Victor, né le 11. 09. 1912
« Nous avons mis huit jours pour parcourir en train les cent kilomètres de trajet entre Rembersdorf et Brest-Litovsk, entassés à 80 personnes par wagon.
Camps de Brest-Litovsk (lazaret) et de Tambow. J’étais en quarantaine à côté du lazaret, ce n’était pas beau à voir les copains sur le point de mourir. J’ai travaillé en forêt. Rapatrié en septembre 1945. »
Schappler René, né en 1926
«Affecté sur le front après la capitulation des Hongrois, je suis passé par la Pologne et la Prusse-Orientale au gré des combats et des retraites. J’ai été capturé le 22 janvier à Schroedersburg en étant encerclé.
J’ai vécu neuf mois de captivité à Tambow (abattage d’arbres en forêt). Admis au lazaret pour y soigner le typhus, je ne puis oublier la cruelle faim et le manque d’hygiène.
Mon frère était prisonnier en Russie. » Schaub Joseph, né le 14. 07. 1912
« Le 14 octobre 1942, envoi dans les Gebirgspionier en Autriche. En février 1943, départ pour Stalino. Derniers combats en Tchécoslovaquie où j’ai été capturé le 10 mai 1945.
Tambow : travail en forêt et façonnage de tuiles en bois. » Schiele Henri
« Capturé près de Memel le 29 janvier 1944, j’ai été maltraité plusieurs fois par les Russes. J’ai dû travailler dans les autres camps.
Tambow : commando-bois. » Schillinger Pierre, né en 1925
« Je suis passé par les camps de Stenstowa (pas d’activité car j’étais soigné pour dysenterie, les forces partaient mais le moral aussi), de Stanislau (menuiserie, gare) et de Tambow (chercher du bois dans la forêt plus autres activités forestières ainsi qu’au kolkhoze et en ville). Pour aller au WC, il fallait courir à l’autre bout du camp. Au cours du trajet retour de Tambow vers Francfort-sur-L’Oder, 75 gars ont été enterrés le long de la ligne de chemin de fer. » Schoenstein Frédéric, né le 7. 10. 1911
« Tambow : dysenterie, corvées, maladies, hygiène, poux et puces, physionomie des copains lorrains effrayante à voir. » Schreiber Gaston, né en 1923
« J’ai séjourné dans le camp de Kotla Jaerwe avant d’arriver à Tambow. J’ai pris part à l’abattage d’arbres en forêt et travaillé dans l’atelier Tracteur Rémonté à Tambow-ville. J’ai été rapatrié au pays le 20 octobre 1945, accusant un poids de 41 kg. » Schutz Jean, né en 1920
« J’ai été capturé le 7 octobre 1944 quelque part en Prusse-Orientale en m’échappant du front.
Tambow : j’ai travaillé en forêt, dans un kolkhoze et dans une usine. J’étais toujours dehors pour trimer, j’ai passé seulement l’hiver au camp (avec quelques corvées de chiottes à mon actif). On n’avait pas beaucoup à manger, même à l’extérieur du camp. J’ai toujours ressenti une peur intérieure, celle de ne plus revoir mon pays. Retour au pays le 20 octobre 1945. » Schwartz Henri, né en 1924
« J’ai séjourné huit mois à Tambow avec de l’abattage d’arbres au programme ; au retour, nous avons passé un mois dans des wagons à marchandises. Je suis revenu à Mulhouse le 2 septembre 1945.
J’ai un frère qui est mort en Russie. » Schwartz Lucien
« Camps de Kiew et de Tambow (usine de tissage). J’avais froid pendant les corvées de bois et je grelottais au moment où j’étais couvert de gale. A partir du mois de mai 1945, j’ai travaillé dans l’usine de tissage, durant 12 heures par jour jusqu’au jour de ma libération. La faim obsédante m’obnubilait. J’ai été libéré le 21 octobre 1945, (perte de dents, eau dans les jambes, typhus). » Schwob Marcel, né en 1923
« Tambow : j’ai surtout participé à l’abattage des arbres et à l’écluse. J’ai été puni une fois de corvée de chiottes pendant trois jours. » Stachle Jean, né en 1925
« Mars 1944, période d’instruction en Pologne, service en Lituanie. Derniers combats à Arida, capturé en juillet 1944. Camp de Tambow, travail au kolkhoze. J’ai été libéré 14 mois après (11 septembre 1945). »
Stich Roger, né le 11. 09. 1926
« Camps de Mitau, de Borissov et de Tambow. Avant tout, j’éprouvais fort le mal du pays, la nostalgie de la maison. Voici les événements communs subis par tous mes camarades de captivité : manque d’hygiène et de soins médicaux, corvées de bois, rigueurs de l’hiver, absence de nouvelles de la famille, rigueur des chefs (policiers, chefs de bataillons et de baraques), couchage sur la planche nue sans matelas ni couverture pendant six mois d’hiver, vêtements élimés, chaussures inexistantes.
J’ai été membre de la chorale (directeurs Rosenblatt et Mitschi) après mes quatre mois passés en quarantaine. J’ai été rapatrié par avion de Braunschweig à Paris le 27.08.1945, je pesais encore 39 kilos. »
Stienne Lucien, né en 1911
« Capturé le 3 octobre 1944. Après le séjour dans le premier camp qui fut bombardé durant trois semaines, nous connûmes également des bombardements durant les longues marches vers l’arrière et subîmes des maltraitances commises par les soldats russes. J’ai soigné le typhus au lazaret de Tambow. J’ai travaillé dans le commando-ville. J’ai tout vécu dans un état second (la faim, le froid, les punitions injustes, les corvées de bois, le cachot, plusieurs corvées de latrines). Je suis rentré au pays natal le 10 septembre 1945 (48 kg, aveugle la nuit, œdème général). Mon cœur n’a pas cessé de battre la chamade pendant toute la rédaction de ce questionnaire. »
Tabouret Roger, né en 1924
« Capturé le 8 mai 1945 à l’Armistice. Lors des marches, j’avais peur de la réaction vindicative des unités blindées. Camps de Riga et de Tambow (usine de wagons, fabrication de tuiles en bois). Le travail et la faim.
J’ai été rapatrié en France le 21 novembre 1945. Mon frère n’est plus rentré de captivité. »
Tempel Joseph, né en 1916
« Tambow : travail en forêt, au kolkhoze, en ville. Aveugle à cause de la faim, j’ai perdu mes dents durant la captivité, j’ai souffert de la typhoïde. Peur de mourir, faim, froid, double hantise de ne plus revenir au pays et revoir la famille ont peuplé mes nuits de cauchemars. Le 26 novembre 1945, je pesais 42 kg au retour. »
Thill Jean, né en 1922
« Tambow : J’ai vu des voitures entières chargées de prisonniers, complètement nus, conduits dans les fosses communes par les gardes russes ! 100 morts par jour en moyenne dans ce camp ! Un camarade était tombé dans la fosse à merde. Revenu dans la baraque où nous étions, il ne put ni se laver ni se changer ! J’avais toujours la peur d’être désigné pour partir en commando ou aller en corvée. J’ai abattu des arbres en forêt, j'étais charpentier au camp. Revenu dans mes foyers en septembre 1945, je pesais 40 kg, j’étais plein d’œdèmes (jambes et ventre). » Thill Paul

« Tambow : corvée de neige. J’ai été libéré le 23 octobre 1945 après six semaines de transport. » Thirion Georges, né en 1925
« Capturé le 26 juillet 1944 à Ostromeczewo-Plenta après mon évasion des lignes allemandes, j’ai passé un mois à Brest-Litowsk, un autre mois à Bobruisk et onze mois à Tambow (travail en forêt). Le 29 août 1945, ce fut le retour (43 kg, perte de 18 dents chez moi). » Unger Paul, né en 1922
« 5 camps de passage (dont un lazaret), Kaunass (Panzerwerk, piste d’atterrissage, atelier de mécanique) avant d’arriver à Tambow (forêt). Cauchemars de peur pour la survie. Je suis resté inconscient un jour et une nuit en apprenant la mort de mon frère à Tambow. Rapatrié avec 40 kg et de l’eau dans les jambes. J’ai connu toutes les misères de la guerre au lieu des joies de la jeunesse. » Vetter René, né en 1926
« Avant d’arriver au camp, j’ai été frappé à la tête et j’ai récolté des coups de crosse dans le dos. Les quinze jours durant lesquels j’ai souffert de la diarrhée, je n’ai rien pu manger, même pas du pain. Le travail était épuisant dans l’écluse. J’ai été rapatrié le 12 novembre 1945. » Vogel Nicolas, né en 1923
« J’ai été capturé le 11 août 1944 comme déserteur. A Tambow, j’étais employé comme cordonnier. La mort d’un camarade m’a marqué. J’ai été rapatrié le 15 août 1945 (40 kg au retour, eau dans les jambes). »
Von Hoff René, né en 1921
« L’invasion des puces, les appels interminables et fatigants vu l’état de faiblesse des prisonniers, l’impossibilité de faire sa toilette, le manque d’eau, les baraques perméables aux infiltrations de pluie dégoulinant sur les captifs durant le sommeil, l’évacuation matinale des morts de la nuit, le manque de camaraderie et de solidarité, c’est simplement ça, Tambow !
Sur le trajet retour à Brest-Litovsk, j’ai été enfermé pendant une heure dans le wagon d’un train garé sur une voie contiguë à la nôtre pour avoir dérobé dans ce train un morceau de fil de fer dont j’avais besoin dans mon wagon. Cet isolement a provoqué en moi une peur bleue parce que notre convoi de rapatriement pouvait partir à chaque instant sans moi. Heureusement j’ai été libéré avant son départ ! Retour au foyer le 25 octobre 1945. »
Walter Robert, né en 1923
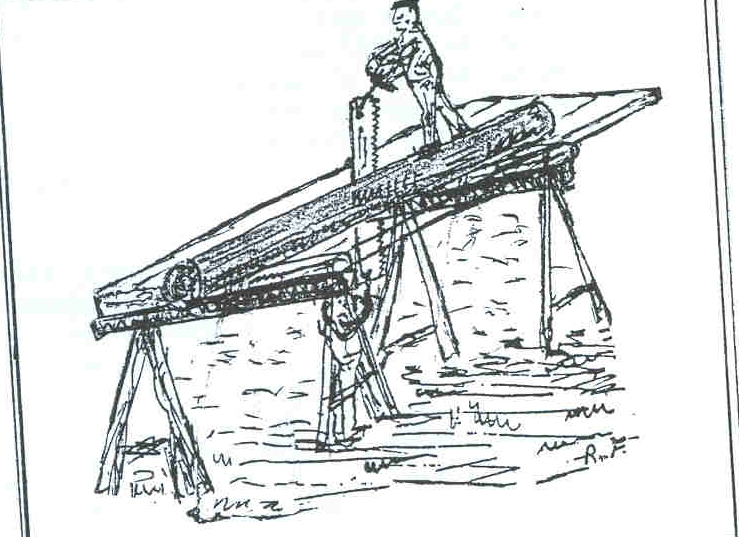 « Après le camp de Minsk, j’ai connu
celui de Tambow. En forêt, j’ai été menacé par une sentinelle avec sa baïonnette ;
j’ai séjourné au lazaret après ma blessure occasionnée au pouce droit pendant
les travaux de bûcheron. A deux reprises, j’ai trouvé un voisin de droite mort
à mon réveil. Drôle de choc !
« Après le camp de Minsk, j’ai connu
celui de Tambow. En forêt, j’ai été menacé par une sentinelle avec sa baïonnette ;
j’ai séjourné au lazaret après ma blessure occasionnée au pouce droit pendant
les travaux de bûcheron. A deux reprises, j’ai trouvé un voisin de droite mort
à mon réveil. Drôle de choc !
Libéré le 21 octobre 1945, j’étais resté une année sans nouvelles de la famille. Violoniste, j’ai arrêté la musique à mon retour de Tambow. J’avais deux frères prisonniers en Russie.» Walzer René
« Passages dans les camps de Debica, de Pržemysl et de Tambow. Très malade de la dysenterie, j’ai souffert de la faim et de la soif au lazaret de la quarantaine. J’ai été choqué par la mort de camarades survenue dans tous les camps que j’ai traversés ; il y eut beaucoup de promesses non tenues évoquant la prochaine rentrée dans nos foyers, j’ai surtout connu la faim et la soif. J’ai été rapatrié le 21 octobre 1945. » Weinmann Henri, né en 1923
« Camps de Riga et de Tambow (réparation de baraques).
Effroi de voir tous les matins des camarades décédés à mes côtés, peur de figurer à mon tour parmi les prochains, faim, froid, manque d’hygiène, attente incertaine du rapatriement, mortalité élevée parmi les camarades. »
Weiss Albert, né en 1920
« Transféré d’un camp situé à la frontière tchèque, j’ai atterri à Tambow. J’ai transporté des morts dans les fosses communes et j’ai travaillé également dans les kolkhozes. J’étais dans un grand état de faiblesse générale due à la dysenterie aiguë et aux rhumatismes articulaires. J’ai été rapatrié en France en octobre 1945. »
Wignell Paul, né en 1925
« J’ai été capturé le 5 avril 1944 à Ohrei en Bessarabie, après m’être échappé des lignes allemandes. Passage par le camp de Stalino avant d’arriver à Tambow : l’abattage d’arbres, la faim, le froid, l’eau dans les jambes. J’ai été plusieurs fois maltraité par les Russes. » Wir Paul, né en 1915
« Après le camp de Kiev, je suis passé au lazaret de Tambow pour y soigner pleurésie et dysenterie. La faim, la fatigue, les souffrances. J’ai été libéré le 28 août 1945 (poids de 39 kg, perte de dents, jambes enflées).
Campagne de Russie d’un frère. » Zerfuss Amédée, né le 25. 08. 1921
« 4 mois à Nishni-Taghil (Oural) et 10 mois à Tambow (hiver passé au lazaret, puis à l’atelier couture). »
Zeyer Léon, né en 1925
« En fin d’été 1944, la quarantaine et sa période d’instruction politico-militaire à Tambow ont été suivies par le creusement des fosses communes, situées au dehors du camp. Comme la pluie provenant des orages traversait le toit de la baraque, il fallut évacuer notre gourbi. Nous avons dormi sur des planches, sans couverture, sans nous déshabiller, pendant toute la captivité. La soif, la faim, autres fléaux ! Durant l’hiver avec ses – 40°C, il fallait sortir chercher du bois en forêt. La morgue n° 22 était pleine de morts qu’on empilait comme du bois, faute de place. Sur le chemin de retour, fin août 1945, alors que je pesais encore 39 kg, je fus hospitalisé à Braunschweig, pour cause de dysenterie. » Ziegelmayer Georges, né en 1922
« Tambow : j’ai effectué des travaux en forêt, au kolkhoze et participé à la construction de ponts. »
Ziegler Gustave
« Passage par le camp de Kiev. Tambow (tourbière et forêt), lazaret (typhus). »
Zurbach Maurice, né le 05. 08. 1925
Les prisonniers alsaciens-mosellans de la IIème guerre mondiale
Quelque cent millions de soldats s’affrontèrent durant la seconde guerre mondiale sur de nombreux fronts de guerre, avec notamment l’Extrême-Orient et surtout l’Europe comme principaux théâtres d’opérations. Rien que de l’Atlantique à l’Oural, plus d’un tiers de tous ces combattants furent tués ou broyés par la dure loi du talion des combattants. En atterrissant en captivité, cinq millions d’entre eux environ moururent derrière les barbelés.
Englobés dans un vaste programme d’anéantissement et d’asservissement réciproques, les Sowjet Union Kriegs-gefangen tout comme les Voennoplennye issus de la Wehrmacht et des forces défaites de l’Axe, - sans oublier les cosaques, les traîtres à la solde de Vlassov, les Ostarbeiter et les Hiwis catalogués comme félons par le Kremlin- payèrent un lourd tribut à la folie furieuse des deux idéologies hitlérienne et stalinienne.
Les épreuves endurées par les incorporés de force d’Alsace-Moselle s’inscrivent également dans cette double dramatique. On estime à 22 000 le nombre de ces Malgré-Nous disparus au combat et à 20 000, ceux morts en captivité, ce qui représente pratiquement le tiers des 132 000 requis de force. Au regard de cette guerre, aucun autre département de l’Hexagone n’a connu une telle hécatombe de sa jeunesse sacrifiée !
Aux 9 millions de morts de l’Armée Rouge, additionnés aux pertes civiles russes plus que triplées, le total des morts recensés en Union soviétique se chiffre entre 27 et 32 millions, soit cinq fois le prix humain payé par l’Allemagne ! Rappelons aussi que sur les 4 500 000 P.G. soviétiques capturés, moins de deux millions revinrent vivants des camps nazis et que des milliers de ces traîtres repassèrent dans le broyeur tyrannique du goulag.
A leur tour pris dans les filets de l’Armée Rouge, environ quatre millions de captifs allemands dont un million de civils furent récupérés comme forces vives pour participer à la reconstruction du pays dévasté et se retrouvèrent disséminés dans les camps concentrationnaires de l’URSS, dans les commandos-bataillons de travail et dans les bagnes de forçats qui essaimèrent du cercle polaire à l’inquiétante Sibérie.
Khranit vetschno, à conserver indéfiniment ! car telle était la mention annotée sur les dossiers judiciaires des victimes du goulag. Cette sentence (prikaz) de Staline, grand Saigneur devant l’éternité, martelait que les prisonniers de guerre devraient se souvenir longtemps de leur calvaire et de leur temps de rédemption passés en Russie. Il fallait, pour les fiers vaincus de ce feu IIIème Reich qui s’était voulu millénaire, que le tourment barbare enduré par la captivité frappât leurs descendances jusqu’à la quarantième génération !
On ne s’attaque pas impunément à l’URSS sans devoir en payer le prix ! Les grognards de Napoléon en avaient fait la cruelle expérience en s’avançant dans un pays-souricière dont ils ne trouvèrent plus la trappe de sortie ! Berezina de malheurs et de souffrances ! Molotov avait confirmé les craintes des prisonniers de Stalingrad en déclarant qu’aucun Allemand ne reverrait son pays tant que la reconstruction de la ville martyre n’aurait pas été achevée. Les Voennoplennye firent ainsi connaissance avec le monde communiste, secret et brutal.
Double système concentrationnaire avec le Goulag et le Gupwi
Lénine avait dit : « Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas ! » Dès 1919, dans les camps de redressement, l’activité des forçats russes, ces antibolcheviques sanctionnés durement pour leur refus de se couler dans le moule rouge et d’adhérer aux doctrines marxistes, tout comme la mise-en-boîte ultérieure des prisonniers de guerre, étaient régentées par les bases du régime du Travail, 1er commandement de la Table de la Loi du Labeur. Le Soviet Suprême, promoteur du développement tout azimut de l’URSS, chercha à travers ses programmes quinquennaux à tenir la dragée haute au Capitalisme. Dognat i pregnat, dépasser et produire !
Ce leitmotiv déraisonné consistait à injecter la matière humaine, au travers des camps de rééducation par le travail, dans la construction pharaonique de la Grande Russie et ainsi dépasser le libéralisme yankee. Idéal outil d’entrave et carcan disciplinaire pour museler les ennemis du régime soviétique, la captivité se transforma aussi en source d’enrichissement du pays sur le dos de ces infortunés sous-produits de deuxième classe. Bosseurs de premier ordre, des millions de détenus essaimèrent en Sibérie pour y développer l’empire soviétique. Steplag, Kouzbass, Karaganda, Kolyma devinrent les stations-orgueils du Matérialisme où le zek détenu n’était qu’un bien matériel comme un autre, bon à être utilisé jusqu’à la corde avant d’être jeté au rebut.
A l’image du Goulag devenu au fil des décennies staliniennes une réussite économique, les services du NKVD qui dépendaient du Ministère de l’Intérieur exercèrent également un contrôle total sur le Gupwi, ce second système concentrationnaire réservé aux trois millions de prisonniers de guerre de la Wehrmacht et à environ un million d’internés civils allemands (femmes, enfants et vieillards) pêchés par l’Armée Rouge.
Avec les chaotiques conditions de la vie carcérale, avec le manque de soins en sus du travail forcé, cet attrape-tout captif conduisit à un holocauste sans pareil. Plus de 5 000 camps (comprenant des Teillager, des camps de regroupement au front et des bataillons de travailleurs) allaient parsemer cet immense archipel de la Désolation.
Incorporation de force dans les serres de l’aigle du Reich : En un rappel historique succinct, il apparaît judicieux de retracer le pourquoi et le comment du drame de la captivité des incorporés de force alsaciens-mosellans. Saignée à mort à Stalingrad, la Wehrmacht cherchait de nouveaux hommes-ressources.
Les ordonnances des Gauleiter Wagner pour l’Alsace, Bürckel pour la Moselle et Simon pour le Luxembourg furent promulguées vers la fin août 1942, en violation du droit international. Elles rendaient obligatoire le service militaire dans l’armée allemande. Si le drame régional des 132 000 Muss Soldaten est fort méconnu chez les Français de l’Intérieur, il est aussi vilipendé par les victimes du nazisme qui ont cru voir dans ces appelés forcés de dociles serviteurs à la solde de Hitler. Qu’il y ait eu quelques brebis galeuses dans nos trois départements de l’Est, nul ne le conteste mais il faut alors, aussi, dire haut et fort que leur nombre représente infiniment moins que les milliers d’antibolcheviques français venus de la métropole étoffer à travers la presse fanfaronne de Vichy les rangs des Waffen S.S. ! L’immense majorité de ces jeunes Schpountz fut envoyée sur le front de l’Est comme Kanonenfutter. Beaucoup furent faits prisonniers par l’armée soviétique, soit au combat, soit après évasion des lignes allemandes. Tract en main, les courageux transfuges espéraient survivre en participant à la lutte dans les rangs alliés. Une grande partie des Alsaciens-Mosellans, des Belges et des Luxembourgeois fut regroupée dans le camp 188 de Tambow. Appelé pompeusement camp des Français, cet home-de-la-décomposition-humaine avait la particularité d’héberger plusieurs autres nationalités, -la plupart étaient des ressortissants des armées défaites de l’Axe- et il vit même arriver des captifs japonais durant l’automne 1945.
Tambow ne fut toutefois pas le seul Lager de détention ; en effet, de nombreux Malgré-Nous séjournèrent dans une ribambelle de camps établis du cercle polaire aux confins de l’Oural, sans oublier les camps européens gérés par les tentacules de l’Armée Rouge en Pologne, en Roumanie ou en Hongrie.
Victimes de deux dictatures qui s’étripèrent monstrueusement, les Zwangsrekruten d’Alsace et de la Moselle, soldats-du-trop-tard et du-trop-peu, vécurent leur Golgotha, étranglés dans les intraitables serres de l’aigle nazi d’une part et écrasés de l’autre par les griffes de l’oUrss’. Nous savons qu’au jeu du chat et de la souris, la proie lacérée par les griffes meurt souvent saignée à petit feu ou cherche désespérément à échapper à son triste destin. Inébranlables face à leur détresse, des milliers de gars de l’Est revinrent au bercail, lessivés moralement et physiquement, après avoir été libérés des crocs de la Bête geôlière.
Passant en revue leur douloureuse rétrospective, trop longtemps passée sous silence après guerre, les enfants des rives de la Moselle et du Rhin, lâchés par la lâche France de Vichy, en voulurent à la Nation d’avoir sacrifié leur jeunesse anéantie dans la honteuse abdication de l’Armistice. L’incorporation de force nazie, sous menace de déportation à l’encontre de la famille en cas de désertion du fils, n’étant pas seulement une violation des Droits de l’Homme mais également un crime de guerre, il eût été tout indiqué que ceux qui furent contraints de s’y résigner et de par là, capturés sur le front russe, bénéficiassent du statut de déportés par la Wehrmacht ! Mais aucun gouvernement français après la Libération ne se soucia de l’établir, au vu de leurs malheurs vécus qui auraient dû inciter la République à s’intéresser avec bien plus d’estime à cette catégorie de victimes de guerre.
Issus des modèles de démocraties contraires au léninisme, les prisonniers français payèrent un lourd tribut à la russianité et à ses sortilèges corrosifs : obéissance, endoctrinement, sévices et travail de force conduisirent à leur chemin de croix. Certaines dépositions recueillies par le 2ème Bureau à Chalon-sur-Saône en automne 1945, au moment du rapatriement des captifs français, nous donnent un bref aperçu des exactions commises par les troupes soviétiques assoiffées de vengeance. Les rapports secrets concernant les conditions épouvantables de la détention, auxquelles ne furent pas étrangers certains fieffés kapos alsaciens-mosellans, relèvent encore d’une prescription dissimulatrice. N’ayant pris aucune ride et avec une acuité identique aux révélations des dossiers secrets, les récits de notre questionnaire médical, épluchés 60 ans après les faits, restent tout aussi suggestifs.
Syndrome de stress post-traumatique
Dans l’International Handbook of traumatic stress syndromes (edited by John P. Wilson and Berverley Raphael, Plenum press New York, 1993), nous retrouvons dans le chapitre n° 21 un thème médical traitant des désordres post-traumatiques du stress chez les prisonniers de guerre d’Alsace-Lorraine de la IIème guerre mondiale qui survécurent à leur captivité en URSS. Les docteurs M.-A. Crocq, F. Duval, J.-P. Macher du centre hospitalier de Rouffach et K.D. Hein de l’université de Michigan Medical School ont étudié, au travers d’un questionnaire auquel ont répondu 819 vétérans rescapés d’Alsace et de Moselle, la dureté carcérale, la sévérité doctrinaire et les désordres psychiques causés par leur détention en URSS sous d’extrêmes conditions.
Un questionnaire avec 117 items en bi-langue (allemand et français) fut envoyé à cet effet à plus de 2 000 membres de la Fédération des Anciens de Tambow et internés en Russie (F.A.T.). Sur les 819 réponses obtenues, deux témoins furent enlevés du lot car leur détention ayant duré plus de quatre ans ne répondait pas au cas précis de l’échantillonnage des questions proposées. Cette étude poussée qui analyse à fond les caractéristiques biographiques des rescapés (âge au moment de l’incorporation dans la Wehrmacht, encasernement et formation militaire, temps passé sur le front de l’Est, durée de la captivité) démontre bien que la longueur de l’emprisonnement conditionne le PTSD des captifs (Presence of Post Traumatic Stress). N’étant pas praticien, je ne chercherai pas à m’étendre sur le sujet mais il est bon de rappeler les souffrances morales et psychiques (flash-back, rêves récurrents, épouvantes nocturnes, cauchemars persistants, isolement, attaques de panique, effrois, phobie sociale) qui ont affligé maint retour et empoisonné l’existence des tiers. « Les souvenirs intrusifs peuvent être déclenchés par des stimuli associés à la captivité : soupe très liquide, paysage de forêt enneigé, nouvelles télévisées concernant des otages. « Les sujets se réveillent en sueur, avec des palpitations » relève-t-on encore dans le rapport. L’étude pathologique entreprise en 1988 par les Docteurs Crocq, Sailhan et Barrois, détermine que les survivants présentent encore et toujours, des séquelles psychologiques de répétition et des troubles anxieux chroniques : ces névroses d’effroi, cendres encore chaudes des braises de l’enfer vécu et qualifiées à bon escient de névroses de guerre ont, dans beaucoup de cas personnels, débordé les capacités de défense physiques et morales de l’individu et l’ont conduit parfois prématurément à sa disparition.
Dans le questionnaire abondamment fourni traitant de la captivité, l’épluchage des récits retrace pleinement l’atmosphère infernale subie par le terrible système concentrationnaire soviétique. Toutes les récriminations et l’exaspération latente des quelque 800 témoins qui ont rempli lesdites rubriques, même divulguées six décennies plus tard, restent très suggestives sur les traumatismes endurés d’alors. A contrario, sans doute aurions-nous entendu un tsunami d’horreurs si l’on avait pu, dès 1945, enregistrer les doléances des 20 000 rescapés alsaciens-mosellans ! (Sur les 40 000 Malgré-Nous faits prisonniers, Pierre Rigoulot estime à 50 % la mortalité de nos compatriotes après la capture). Cette investigation étalée à livre ouvert, c’est un drame ravivé à la Zola où les malheurs vécus demeurent effroyables malgré l’injure du temps qui a clairsemé le rang des survivants.
Ravages du corps, ruines de l’âme ! Des veuves n’ont pas hésité à prendre la plume pour retranscrire le lamento de leur conjoint. Je n’ai pas voulu épiloguer sur les névroses psycho-traumatiques consécutives à la frayeur que continuent d’éprouver certains rescapés, restés captifs dans les phantasmes concentrationnaires qu’ils traînent avec eux. Cette enquête médicale m’ayant été confiée par le président Jean Thuet après que le Dr. Crocq en eût retiré les éléments pour conforter sa thèse sur la névrose de guerre, je me suis permis, avec leurs accord et appui réciproques, à rapporter texto les drames et traumatismes vécus par les captifs, malgré le scrupule qui m’a longtemps fait hésiter à mettre à la lumière du jour les patronymes des témoins, un peu sans leur aval. Que ces derniers me pardonnent cette liberté au nom de la crédibilité des faits et du service à la Mémoire ! J’ai voulu humblement mettre ma contribution au service de nos trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour restaurer la dignité passée des Malgré-Nous.
Rouss’pétances ! Dès leur rapatriement, des Malgré-Nous rescapés confièrent à leurs proches et à la plume leur mal-vivre carcéral et les conditions de survie extrême auxquelles ils furent soumis. Mais leur diffusion dépassa rarement la sphère régionale. Un peu à l’image de la goutte de phosphore qui s’incruste dans les chairs et qu’il faut plonger dans un bain d’eau pour éteindre ses effets, oui longtemps, trop longtemps, la captivité vécue fit taire ses brûlures de l’Histoire en plongeant les rescapés dans le monde du silence.
Le maréchal Joukov, commandant la zone Est de Berlin, avait dit à un captif de Creutzwald, revenu en 1951, au moment de son transfert vers la zone Ouest d’oublier et de se taire. Schweigen und vergessen !
Mais heureusement, on ne bâillonne pas ainsi la Mémoire sous forme de rodomontades verbales. Soljenitsyne, dans le style d’un précurseur courageux de la Glasnost, avait osé le faire en son temps en écrivant : « l’Archipel du Goulag est une terre sans écriture et la tradition orale s’interrompt avec la mort des habitants. Seuls quelques embruns épars vous les dépeignent parfois, éclairés par la lumière réfléchie de la lune, à peine perceptibles… Que votre mémoire soit votre unique sac de voyage. Retenez tout ! Souvenez-vous de tout ! Seules ces graines amères auront peut-être la chance un jour ou l’autre de lever. » Forts de son conseil et un peu grâce à ce questionnaire aidant, 817 incorporés de force, avec leurs réminiscences au goût de fiel, ont voulu, eux aussi, à travers leurs témoignages, évoquer les annexes infernales. L’un d’eux a même eu cette affirmation pour dire que l’Enfer de Dante était un charmant paradis comparé aux Lager qu’il a connus.
Cayenne et géhenne réunis
Dans les griffes de l’oUrss, les braves survivants ont épilogué sur leur incorporation de force mais surtout sur leur captivité dans un questionnaire révélateur des souffrances endurées. Qu’en ressort-il de ces témoignages au couteau que le temps peine à cicatriser ? La via dolorosa débouchant pour des milliers sur un Golgotha mortel !
Le marche-ou-crève de l’animal humain dans les colonnes de désolation ramenées de l’arrière du front éliminait de nombreux éclopés, victimes des gardes qui liquidaient par fureur d’âme et par soif de vengeance les plus affaiblis. Il valait mieux rester proche des hommes d’escorte pour éviter le rentre-dedans d’hystériques tankistes ou échapper à la noire colère des civils armés de fourches, hostiles lanceurs d’avoinée de pierres ou écumants postillonneurs de crachats. Durant les trajets en wagon, le sadisme des konvoïs consistait à distribuer des harengs fumés et du pain dur en plein été ; cette ration sèche déshydratait encore davantage l’organisme car la soif demeura de loin le pire ennemi du bétail humain. Un seul seau par wagon ! car trop de boisson distribuée aurait provoqué bousculade et pagaille monstre au grand déplaisir de l’escorte chargée de ramener l’ordre ! On léchait en conséquence les ferrures intérieures que la condensation avait perlées d’humidité bienveillante. Le transport par voie ferrée véhiculait une hygiène déplorable ; l’affaiblissement physique s’aggravait avec le syndrome de l’enfermement. Enjambant les cadavres empilés qui avaient servi de calfeutrage au froid glacial, tombant sur le ballast dès la porte coulissante ouverte, des êtres qui avaient presque cessé de l’être, au visage émacié, remerciaient le Ciel d’avoir réussi miraculeusement à supporter les aléas catastrophiques du trajet interminable. Mais le pire ne faisait que venir !
La matière humaine malaxée à l’idéologie communiste allait progressivement se transformer en cadavre ambulant et en carcasse du non-être. Pour ces cadenassés de la vie captive, les calamités, pires que les plaies d’Égypte que peuvent endurer des prisonniers, y assaillirent des milliers de reclus. La présence de mouchards cassait l’homogénéité des groupes et l’esprit de camaraderie.
Le dosage alimentaire entretenait juste le travailleur épuisé tandis que l’habillement riquiqui couvrant les bêtes d’infortune s’avérait inadapté aux conditions atmosphériques. La crasse enveloppait, à l’image des écailles de poisson, la peau des tordus par les souffrances. Tous les témoins sont unanimes pour affirmer que la faim et la soif furent une réelle horreur. En guise de repas, les pains spongieux et la soupe aqueuse parfumée aux chiures de punaises constituaient bien souvent le seul mets lorsqu’il en restait suffisamment dans le chaudron, après les vols et les détournements perpétrés par des spécialistes zapzerapeurs (voleurs) et certains entretenus du système. Hooliganées contre de la vodka et de la mahorka (tabac) par des intendants corrompus ou par des gardiens témoignant leur répugnance profonde à allouer des rations à leurs ennemis jurés en pensant à leurs propres familles affamées, les vivres, rares de surcroît, bi-passaient souvent dans des circuits parallèles de distribution. Quenelles-au-bout-de-la-fourchette-de-papa-Staline, les captifs allaient servir de chair-à-industrie dans de titanesques chantiers dignes du travail d’un Romain. Nos pantins, robotisés par le système concentrationnaire, furent attelés au formidable bond-en-avant de la Machine infernale. Routes, villes, canaux, voies, tourbières, usines, combinats, kolkhozes parsemèrent les exils intérieurs de cette retraite en Russie profonde.
Classés comme Stalinspferden (Pferd=cheval), les portefaix rompus à toutes les charges, sucés aux quatre veines, s’identifiaient aux crevards, ces individus vidés, exsangues, aux extrêmes limites de résistance qui mouraient au bout de 2-3 jours de présence au lazaret. A Karaganda, le mineur hanté par la peur de ramper dans le trou terrifiant des veines de charbon, ne laissait rien paraître sur sa gueule noire de l’effroi vécu, au sortir du puits archaïque. Faute d’avoir manifesté une attitude honnête envers le travail sacré, le condamné voyait sa portion de survie réduite au vu de la norme non atteinte. La loi du débrouillard culotté et individualiste qui faisait semblant ou qui bossait le moins possible dominait dans le SYSTEME vénal du Gupwi. Il en résultait un sabotage économique permanent et largement déficitaire au regard de la planification quinquennale. Le faire-semblant ronronnait de bien-être fausset, on pigeonnait à merveille et sans scrupule son prochain. On truandait l’autre ; la norme non atteinte allait réclamer une charge supplémentaire de travail aux larbins de service. S’apercevant très vite que le gaspillage dépassait largement les seuils de rentabilité exigée par les stakhanovistes de la Révolution rouge, chaque captif arnaqué cherchait à devenir à son tour un routinier partisan du moindre effort.
A côté d’une industrie déraisonnée qui polluait mortellement des contrées entières (la région pelée autour de Kouïbychev par exemple), avec la toufta, ce système vénal de tromperie sur la quantité et la qualité du travail fourni et le primitivisme constaté un peu partout, le Pays s’enfonçait dans la désolation. Faire proliférer du blé aux limites de la toundra gelée, c’était le défi fou lancé par des agronomes cinglés à la Nature et que jetaient fatalistes, les semeurs aux larmes de glace sur la banquise terrestre mordue par le gel. L’absence de mécanisation performante fondait insidieusement la masse captive ; pour la plupart des activités, très pénibles en passant, on employait des instruments primaires qui immobilisaient plus qu’ils n’encourageaient les rendements.
Dans les kremlins boisés, et principalement à Tambow, les ratatinés par le boulot broutaient goulûment leur nourriture de moineau. « Quand un loup a faim, il mange des mouches ! » Ce proverbe russe donnait ici tout son sens à la polyphagie. Sujettes à l’inondation au moment du dégel, les cabanes enterrées et basses, semblant comme écrasées par la misère et la rudesse des matériaux naturels utilisés, en confortaient l’insalubrité. Les vermines au pluriel avaient vite trouvé leurs peaux de prédilection et avec la promiscuité sardinière aidant, elles essaimaient, contribuant encore, de par leur fléau, à exaspérer la susceptibilité des encagés. Pour ne pas être de reste, les maladies s’amplifiaient dans les profondeurs du terreau insalubre. Les carences nutritives dévitalisaient les momies ambulantes et entraînaient la pellagre, voire la démence. Tuberculose, hydropisie et scorbut s’acoquinaient aux autres maladies pour enfler les taux de mortalité. Ulcérations gangréneuses et engelures putréfiées constituaient des voies d’accès faciles pour les bacilles, ces bâtonnets frappeurs du tétanos. Les lazarets de fortune demeuraient malheureusement orphelins des remèdes de première nécessité. Dans les gîtes forcés, la Mort fauchait les rangs. La libération des souffrances terrestres et le glissement lascif vers un état bienheureux d’apesanteur, à l’image du forçat épuisé tombant de lassitude, accompagnaient les râles des agonisants désespérés de ne plus revoir leurs familles. Enterrer les macchabées sous de telles latitudes glacées pour leur dernier voyage sur terre relevait de l’exploit. Sous la lune rousse, le blizzard pétrifiait les cimetières remplis de crevés, avec leurs pieds cette fois bien dans la tombe. Les rafales sauvages hurlaient en cacophonie avec les corbeaux le De profundis in terra en attendant l’arrivée printanière du redoux qui permettait de combler les basses-fosses, aux emplacements effacés à jamais. Manquant de chaleur naturelle et surtout humaine, dans l’air nauséabond générateur d’insomnies élastiques, les effarés broyaient du noir, cédaient aux réflexes du chacun-pour-soi, aux calomnies, aux coups de gueule. Toute situation devenait prétexte à l’empoignade verbale ou musclée des protagonistes ! Le manque de place et d’intimité, le pet de travers, les privilèges et la nervosité provoquaient des épanchements de fiel. Des bagarres explosives laissaient parfois des morts sur le carreau. Les cauchemars-tortures entretenaient le chœur des démons dans les piaules des troufions râleurs. Les sous-alimentés chroniques s’habillaient avec les moyens du bord : le chiffon russe (Fusslumpen) pourrissait à force d’être mouillé dans les galoches trouées, on le remplaçait par des tchétézi, ces chaussures à pneu et à semelle de bois. L’idéologie serinée par les commissaires politiques matraquait le fait qu’il fallait faire payer la dette aux envahisseurs venus les armes à la main et que ce châtiment n’était que juste réparation au Mal commis. A Tambow, certains kapos, chefs de corvée disciplinés au cœur froid comme l’hiver arctique, chargèrent à mort la barque des damnés ! Le Politruk cherchait à extirper l’ordre bourgeois du mental des individus qui, aux yeux du Kremlin, n’existaient pas en tant qu’êtres humains, car ils faisaient partie d’un collectif grégaire qu’une minorité agissante de sous-fifres, roitelets flicards sur le terrain, menait à la baguette et décérébrait. L’embrigadement docile des mercenaires kaki chloroformait leurs agissements et finissait par instrumentaliser leurs actes qui régentaient le bon ordonnancement des camps. Les Ponce-Pilate survitaminés, girouettes vertueuses à la solde de la Bouffe et des avantages acquis, endossèrent à merveille leur rôle de nouveaux chevaliers prosoviétiques. En odeur de sainteté stalinienne, les canailles rampantes abreuvées au lait communiste obéissaient au pied de la lettre aux recommandations carcérales. Pires que dans l’enfer, les sous-ordres, ces gardes diablotins, infligeaient à leurs victimes le régime des punitions et des corvées merdiques. Soumis par un appareil militaro-policier, les galériens souquaient dur à fond de cale tandis que les privilégiés du système étaient installés sur le château arrière. Mais, à côté du camp 188, certes unique en son genre, d’autres camps assimilés à la Mort et au Mal et où sévirent lestement de nombreux affidés, la plupart étant des Allemands serviles inféodés à l’Antifa, devinrent également, grâce à leur gardiennage féroce et violent, des clubs de (la) vacance et du vide.
Agencement du livre
Dans la rapide évocation d’un Malgré-Lui de Puttelange-aux-Lacs, soldat du Kaiser, revenu au bercail en 1921, on apprend au détour de l’article du journaliste à qui il a confié ses impressions, que la situation du pays russe, gérée par les Bolcheviques depuis la révolution d’Octobre de 1917, est catastrophique.
Et 25 ans plus tard, au sortir de la seconde guerre mondiale, le constat d’oppression restait le même pour les Malgré-Nous rescapés : la dictature soviétique n’avait pas varié, elle imposait plus que jamais sa chape de plomb et sa camisole de force sur les neuf fuseaux horaires de son immensité continentale.
Les témoignages sont répartis en trois grands thèmes : la Wehrmacht, l’Armée Rouge et la Captivité où le camp de Tambow tient encore et toujours son rôle d’étouffoir et de trou de Babel.
En s’imprégnant au fil des pages de la montagne russe des malheurs vécus par les recrues forcées, le lecteur comprendra mieux la problématique des Malgré-Nous et leur vie de peu de choses sur le front russe.
Des centaines d’anecdotes ont été collationnées dans ces trois catalogues.
1) L’on ne peut pas comprendre tout à fait la tragédie des Zwangsrekruten si l’on ne s’attarde pas un tant soit peu sur le drill prussien subi dans les casernes et les péripéties vécues dans les différents corps d’armées.
En préambule, huit dépositions personnelles très étoffées évoquent les assauts, les bombardements subis, les corps-à-corps, les retraites égrenant leurs étapes de feu mais aussi l’amer encagement. Leurs parcours du combattant les ont menés des faubourgs de Leningrad aux confins du Kouban. Puis, un grand chapitre fait défiler les épreuves vécues par deux cents incorporés de force, aussi bien sous l’uniforme feldgrau que dans la tunique répressive du captif. En compulsant le registre épistolaire truffé d’événements incroyables de ces réchappés, on imagine un peu mieux les tourments vécus par nos garçons de l’Est de l’hexagone sous les deux bannières totalitaires qui se vouèrent réciproquement une antipathie sans pareille.
2) Quant à l’Armée Rouge, les récits nous commentent qu’elle fonce agressivement vers le sanctuaire nazi, au pas de charge revanchard. Crimes féroces des partisans, atrocités et mauvais traitements systématiques des unités de la Garde, rudes interrogatoires à claques suivis de passages-à-tabac perpétrés par d’ombrageux commissaires politiques, brutalités sanguinaires des Flintenweiber, fouilles musclées, coups de folie des bourreaux, marches exténuantes, déficiences sanitaires et manques de nourriture accentuent l’Épouvante après la reddition.
3) Il m’a semblé utile d’évoquer la création du gupwi, frère secret du goulag que j’ai agrémenté à la fois, avec les tribulations d’un Polonais rescapé, déplacé spécial en Sibérie et le martyre des ressortissants des pays baltes que croiseront nombre de nos embastillés.
Puis, un large inventaire évoque entre autres faits, les transports, la faim, la soif, la vie dans les camps, le travail, l’hygiène, les maladies dans les vallées-des-larmes (in lacrimarum valle), la Mort, les doutes, les espoirs déçus, les face-à-face tendus avec l’autorité et les kapos moutonniers, les condamnations, les histoires incroyables, le rapatriement, auxquels furent soumis nos trompe-la-mort. Harengs en caque, les prisonniers, classés comme matière consommable, se retrouvèrent stockés dans des camps de rassemblement avant d’être ventilés, à des fins de rentabilité par le travail, vers des camps de regroupement identitaire. La lutte pour la survie y devint épique. La corruption exercée par les nantis affamait les dépossédés, la déshumanisation transformait les teints-verdâtres en loups. Îlots de désolation perdus, les camps par où transitaient les captifs dispersés révèlent tous le caractère dramatique de l’avilissement, de la malnutrition, de l’inconfort, des coups durs sans fin et de la malvie.
Tambow reste le pire modèle parmi la liste des camps répertoriés.
« Ce sont les mots qu’ils n’ont pas dit qui rendent si lourds les morts dans leurs cercueils » a admirablement écrit Henry de Montherlant en évoquant le sacrifice des héros morts pour la Patrie. Mais que dire du sort des survivants ? Il leur reste à témoigner de l’Innommable, à être les garants de l’Homme aux yeux de l’Histoire.
Et surtout, que les générations suivantes n’oublient jamais ce qui fut perpétré, afin que cela ne puisse plus jamais advenir ! Epaves mosellanes et alsaciennes à jamais avalées par l’Inconnu, reposez en paix dans vos mausolées fantômes engloutis à jamais dans la poussière des steppes ! Les incorporés de force, à travers leurs poignants récits, veulent, avant qu’ils ne partent discrètement, léguer toute leur Mémoire à la Légende de XXème siècle !
 Laurent KLEINHENTZ, enseignant à la retraite, est Maire de Farébersviller et Conseiller Général de la Moselle. Il est l'auteur de 3 volumes intitulés "Malgré-Nous, qui êtes-vous?", d'un livre diffusé sous le titre "1939-40 Dans la tourmente", d'un ouvrage ayant obtenu le prix Erckmann-Chatrian 2002 "Tambow, la face cachée" (Editions Serpenoise) suivi du livre "Les Barbelés rouges" (Edition Serpenoise) retraçant la vie des prisonniers dans les camps soviétiques.
Laurent KLEINHENTZ, enseignant à la retraite, est Maire de Farébersviller et Conseiller Général de la Moselle. Il est l'auteur de 3 volumes intitulés "Malgré-Nous, qui êtes-vous?", d'un livre diffusé sous le titre "1939-40 Dans la tourmente", d'un ouvrage ayant obtenu le prix Erckmann-Chatrian 2002 "Tambow, la face cachée" (Editions Serpenoise) suivi du livre "Les Barbelés rouges" (Edition Serpenoise) retraçant la vie des prisonniers dans les camps soviétiques.
Né en 1947, il n'a pas connu les affres de la guerre, mais s'est interéssé de près à l'histoire tourmentée de cette terre de Moselle-Est qui l'a vu naître et où les anciens ont tant souffert. Il cherche à informer du mieux possible les générations d'après-guerre, afin que le sacrifice consenti par les aînés pour retrouver la paix ne soit pas oublié.
Cet ouvrage traite de la Libération sous trois aspects: le vécu raconté par les villageois, la version donné par les Allemands et la version retracée par les Américains.
L'attente de la libération face à l'oppresseur nazi paraît bien longue aux habitants de Farébersviller.
Déjà plus de 4 années d'integration forcée!
En effet, qu'il est loin ce premier septembre 1939 fatidique où les chars de Hitler entrèrent en Pologne! Qu'elle semble bien floue cette évacuation faite dans la précipitation sur les chemins de l'Exode! Oui, qu'il apparaît estompé ce fastidieux voyage vers la Charente, dans des wagons à bestiaux !
Au retour de Bonnes Charente le 2 octobre 1940, il a fallu reconstruire avec patience le village sauvagement bombardé le12 mai 1940, subir les contraintes de la Volksgemeindschaft (adhésion à la communauté du peuple allemand) et accepter bon gré mal gré les lois nazies en vigueur.
Mais,apès la défaite de Stalingrad, après l'echec de Rommel en Libye, chacun à Farébersviller et en Moselle sait désormais que la victoire des Alliés n'est plus qu'une question de temps.
En 1943, déjà, les cartes majeurs ont changé de main. On abats les atouts du côté des Alliés: débarquement sur le littoral d'Afrique du Nord puis frappe dans le ventre mou de l'Axe en Sicile.
Le 6 juin 1944, un formidable assaut est lancé contre la forteresse nazie à partir de la Normandie, à travers un débarquement réglé dans les plus infimes détails et ce, grâce à une logistique époustouflante pour l'époque. Malheureusement, les bocages normands sont autant d'obstacles qui entravent la progression alliée.
Parmi les Allemands qui s'arc-boutent, les Grenadiers de la 17ème SS Panzerdivision Götz von Berlichingen vont faire illusion plus de 8 semaines durant, dans les haies du Calvados.
Nous les retrouverons 5 mois plus tard dans ce qui est maintenant convenu d'appeler la bataille de Farébersviller (du 28 novembre au 4 décembre 1944).
Les SS vont utiliser la configuration du terrain, les ruelles et les ruines des maisons pour s'y incruster, gêner sérieusement l'adversaire et surtout vouloirrendre inviolable le sanctuaire sacré du Vaterland. Les villageois, quant à eux, se terrent comme des taupes dans les caves pendants 5 interminables semaines. Ils s'impatientent, car le calendrier de la libération prend un sacréretard sur les prévisions: Patton le fougueux piétine devant Pont-à-Mousson, sur les passages meurtriers de la Moselle et de la Seille.
La boue, la pluie n'arrangent pas leschoses et les fantassins allemands, le dos à la frontière de la Sarre, tiennent tête à la 80ème US. "Question de vie et de mort", a décrété le Führer !
De très durs combats auront donc lieu à Farébersviller.Du côté allemand comme du côté américain, on compte de très nombreux tués, des dizaines de bléssés et beaucoup de prisonniers, tandis qu'on déplore une victime civile le 4 décembre 1944, le jour même de la libération tant espérée...
Only the fish are alive inFarebersviller! Seuls les poissons sont encore vivants à Farébersviller ! déclara un correspondant de guerre américain, consterné par l'ampleur du désastre.

